Mis en conformité avec la graphie académique marquisienne le 26/08/2022.
AVANT-PROPOS
Au court de cette courte période, les nombreux scientifiques embarqués ont exécuté une grande quantité d’illustration magnifiques dont certaines sont exposées dans le texte ; pour les Marquisiens, elles sont d’une importance extrême car elles représentent nombre de leurs ancêtres en donnant des détails précieux sur les tatouages, l’habillement et les armes de l’époque.
Les dates mentionnées dans le texte sont celles de l’ancien calendrier julien en vigueur en Russie jusqu’à la révolution de 1917 à la suite de laquelle les Russes ont adopté le calendrier grégorien qui avançait les dates de 10 jours. Quand Krusenstern aperçoit Fatu Uku pour la 1ère fois le 24 avril, cela correspond en fait au 6 mai.
Les notes numérotées sont de Krusenstern ou du traducteur de l’époque ; elles étaient placées en bas en page, en l’absence desquelles, Jacques Iakopo Pelleau les a replacées immédiatement à la suite de leur renvoi.
Les notes entre parenthèses avec un * sont de Jacques Iakopo Pelleau.
Les nombres de trois chiffres entre parenthèses correspondent aux pages de l’édition de 1824 signalée dans la bibliographie en fin d’article.
Afin de faciliter la lecture du récit, l’orthographe utilisée par le traducteur de Krusenstern en 1821 pour restituer les noms des personnes, tribus, vallées, îles et pays a été conservée dans sa forme originale à la 1ère occurrence ; par la suite, c’est l’orthographe moderne de ces noms propres que Jacques Iakopo Pelleau à choisie.
PRÉAMBULE (Wikipédia)

En français, son nom usuel est Adam Jean, chevalier (ou baron) de Krusenstern. Il servit d'abord sur un bâtiment de guerre anglais en 1793, et par la suite sur des bâtiments marchands également anglais. Il fit les voyages des Indes et de la Chine. Le commerce avec l'Extrême-Orient devint le principal de ses projets et il écrivit un mémoire sur les avantages d'une navigation russe d'Amérique en Chine (l'Alaska était alors russe) et sur le développement qui devait en résulter pour le commerce des peaux exercé par la compagnie russo-américaine. Ce mémoire, négligé par les ministres du tsar Paul Ier, fut bien accueilli par Alexandre Ier, avec le soutien de l'amiral Mordvinov et du chancelier, le comte de Romanzov.
Krusenstern, nommé capitaine de la marine impériale, fut chargé de commander une expédition scientifique et commerciale, avec la mission d'explorer les côtes de l'Amérique russe (c'est-à-dire l'Alaska) et les régions septentrionales de l'Asie. Un envoyé du tsar, M. de Résanov, accompagnant l'expédition, devait, si possible, renouer des relations avec l'empire japonais. L'escadre partit de Kronstadt le 7 août 1803. Elle était composée de deux bâtiments, la Nadejda, signifiant Espoir, ou Espérance, est commandée par Krusenstern, et la Néva est sous le commandement du lieutenant-capitaine Lisianski. Des savants, dont les noms ont acquis depuis une certaine célébrité, Wilhelm Gottlieb von Tilesius von Tilenau (1769-1857) et le baron von Langsdorff (1774-1852), naturalistes, et Johann Kaspar Horner, astronome, faisaient partie de l'état-major. Quelques Japonais, naufragés en 1796 sur les îles Aléoutiennes avaient été confiés au commandant pour être ramenés dans leur pays.
Krusenstern franchit le cap Horn, visita les îles Marquises (* découvertes par les Espagnols en 1595) ainsi que les îles Washington (* les 3 îles du groupe nord, découvertes en 1791 par m’Américain Ingraham) ; il découvrit sur la côte occidentale de Nuku Hiva un excellent port, auquel il donna le nom de Tchitchagov/Tchitchagoff (* Hakauì).
Aux îles Sandwich (*Hawaii), il se sépara de la Néva, commandée par Lisianski. La mission de cet officier était d'explorer la côte nord-ouest d'Amérique. Krusenstern fit voile pour le Kamtchatka ; il y arriva le 14 juillet 1804 et en repartit le 8 septembre. Il chercha vainement, ainsi que l'avaient fait les précédents navigateurs, les îles placées sur plusieurs cartes à l'est du Japon, ces îles d'or et d'argent rendues si fameuses par les récits espagnols. Le 7 octobre, les bâtiments russes étaient en vue de Nagasaki.
L'accueil des Japonais fut tendu. L'ambassadeur et l'équipage furent tenus prisonniers à bord durant tout leur séjour. La poudre et les armes furent consignées à terre. Une flottille de trente-deux jonques cernait le navire et lui interdisait tout rapport avec les habitants. Les Hollandais parurent n'être pas étrangers au maintien de cet isolement sévère et à ces dispositions hostiles. L'autorisation accordée à Laxman, en 1792, pour l'envoi ultérieur d'un navire de commerce, fut tenue pour non avenue. La lettre de l'empereur de Russie avait été transmise à Edo (Tōkyō) : et après un séjour ou captivité de plusieurs mois, le 4 avril, Résanov reçut une réponse négative et péremptoire du souverain japonais. On invita Résanov à s'éloigner au plus tôt pour ne plus revenir, et les Russes furent avertis d'avoir à remettre à l'avenir tous les Japonais naufragés aux Hollandais, qui les renverraient par la voie de Batavia (Djakarta). Ainsi l'ambassade échoua complètement.
Le 18 avril 1805, Krusenstern quitta le Japon. Il voulait faire route entre la Corée et le Japon, et continuer sur la côte nord-ouest de l'île de Nippon (Honshū), la principale de cet empire, les recherches laissées incomplètes par la Pérouse, à cause des mauvais temps. Mais il éprouva les mêmes obstacles, et fut obligé de se rendre directement au détroit de Sangar. Il côtoya le rivage ouest d'Yesso (Hokkaidō), et franchit le détroit de La Pérouse. Enfin il reconnut et explora l'île de Tchoka (ou Sakhaline) et les îles Kouriles méridionales.
Krusenstern contribua grandement à étendre la géographie nautique et physique de ces régions, pour ainsi dire inconnues… Il enrichit également d'observations et de notions nombreuses et d'une grande valeur l'histoire naturelle, l'ethnographie et la linguistique. Par exemple, il regroupa dans un même archipel, les seize atolls qu'il baptisa îles Gilbert (aujourd'hui Kiribati), du nom du capitaine britannique Thomas Gilbert qui les avaient traversées sans les explorer en 1788. Le comte de Résanov quitta le navire de Krusenstern au port de Petropavlovsk, dans le Kamtchatka et s'y signala par sa conduite inhumaine à l'égard d'une colonie japonaise.
Krusenstern, après de nouvelles et importantes explorations dans la région des îles Kouriles et au nord de la Tartarie, vers l'embouchure du fleuve Amour, revint à Petropavlovsk le 29 août et le 30 novembre à Macao, où la Néva le rejoignit le 3 décembre. Les peaux apportées par ce dernier navire furent vendues à Canton pour un prix considérable. Il quitta la Chine le 9 février 1806 et le 30 août il était à Kronstadt, la Néva étant arrivée le 17 août.
Pendant la durée de l'expédition, c'est-à-dire trois ans et douze jours, Krusenstern n'avait pas perdu un seul homme. Ce rare bonheur était moins dû à sa sollicitude paternelle envers ses marins qu'à son éminente capacité maritime. C'est le premier Russe à accomplir un tour du monde.
Krusenstern mourut le 24 août 1846 dans son domaine, le château d'Aß, situé à Gilsenhof (aujourd'hui à Kiltsi) dans le gouvernement d'Estland (actuelle Estonie). Il fut enterré à la Cathédrale Sainte-Marie de Tallinn.
Œuvre
Krusenstern publia la relation de son voyage sous le titre de Voyage autour du monde dans les années 1803-1806, Saint-Pétersbourg, 1810-1812, 4 vol. et atlas de 104 cartes (en allemand). Cet ouvrage fut bientôt traduit dans la plupart des langues de l'Europe. On doit rattacher à ce récit celui de Lisianski : Description d'un voyage autour du monde, Saint-Pétersbourg, 1810.13, 2 vol. in-8° (en russe), traduit en allemand par Pansner, celui de Langsdorff : Observations sur un voyage autour du monde dans les années 1803-7, Francfort, 1812, 2 vol. in-8° avec planches, et l'ouvrage de Tilesius : Fruits pour l'histoire naturelle de la première circumnavigation impériale russe accomplie sous le commandement de Krusenstern, Saint-Pétersbourg et Leipzig, 1813, in-8° (en allemand).
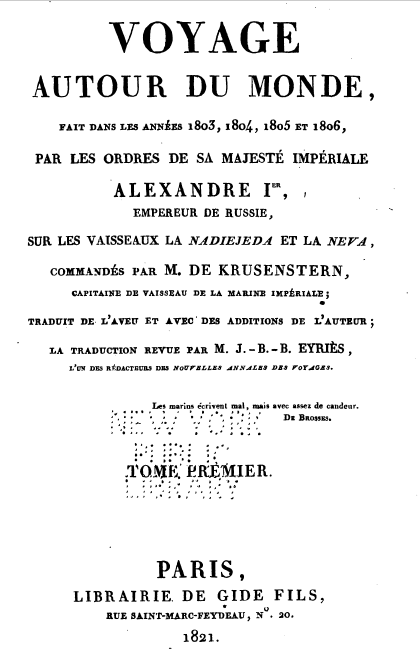
CHAPITRE VI
DEPUIS LE MÉRIDIEN DU CAP HORN JUSQU’À NOTRE ARRIVÉE À NUKU HIVA
Nous doublons la Terre du Feu - Abaissement extraordinaire du baromètre - La tempête sépare les deux bâtiments - Le plan du voyage changé - Nous coupons le tropique du sud - Suite d'observations de la lune pendant 6 jours - Erreur de nos chronomètres - Nous voyons quelques-unes des Marquesas de Mendoza - Nous côtoyons l'île Ua Huna - Arrivée à Nuku Hiva - Nous mouillons au Port d'Anna-Maria.
Nous doublâmes le Cap Horn le 5 mars à 8 heures du matin, quatre semaines après notre départ de Sainte-Catherine. Peut-être n'a-t-on jamais fait cette traversée en si peu de temps. Le vent changeait presque à toute heure du N. E. à l'O. Il continua ainsi pendant plusieurs jours sans être très-fort. Le temps était sombre et nébuleux. Deux fois nous perdîmes de vue la Néva pendant quelques heures. La houle était très-grosse de l'O., et fatiguait extrêmement notre bâtiment. Le 5 mars à 11 heures du matin, M. Horner profita de l'apparition (135) momentanée du soleil pour prendre quelques hauteurs qui donnèrent, pour notre latitude, 59° 58'. Elle était de 60° 09’, d'après la marche du vaisseau. C'est la plus haute latitude méridionale que les vents d'O. nous aient forcé d'atteindre. La longitude, selon nos chronomètres, conclue des mêmes hauteurs était de 70° 15'.
Le 7 mars, le soleil se fit voir à midi. Les observations prouvèrent de nouveau que le courant nous avait poussés, presque directement à l'E., de 15 à 14 milles par jour.
Le 9 mars la mer fut si tranquille, que nous pûmes faire l'expérience de la machine de Hales. A 100 brasses, le thermomètre indiquait 1 ½ degré, à 60 brasses 2 ½, et à la surface de l'eau 2 5/4, tandis que la température de l'air était de 4 degrés. Ce même jour on trouva, par plusieurs azimuts, que l'aiguille déclinait de 27° 40’ à l'E. C'est la plus grande déclinaison que nous ayons observée dans ces hautes latitudes australes. La latitude du vaisseau était alors 59° 20', et la longitude, suivant les chronomètres, 72° 45’.
Le 11 mars, je calculai que nous étions à un demi-degré à l'O. du Cap de la Victoire. Je continuai cependant ma route à l'O., ne me fiant pas à la durée du vent de S. qui soufflait, pour la première fois, depuis que nous avions doublé le Cap San - Juan. Je voulais (136) aussi me mettre hors de la portée des vents d'O. qui dominent dans ces parages jusqu'au tropique, afin de pouvoir, en cas de besoin, gouverner au N. ; ce qui n'était possible que par un méridien plus occidental. Ces raisons me déterminèrent à ne faire route au N. qu'après être parvenu au 80ème degré de longitude. L'exemple du capitaine Bligh m'invitait à prendre cette précaution : car, quoiqu'il fût déjà au 77ème degré de longitude, il ne put doubler le Terre-du-Feu, et fut contraint d'aller au Cap de Bonne Espérance.
Le 14 mars, nous étions par 56° 13’ S. et 82° 56’ O. (d'après le calcul du vaisseau 86° 27') ; nous étions alors à 8 degrés à l'O. du Cap Pillar, le plus occidental de la Terre-de-Feu. Je ne doutais plus de pouvoir le doubler, même par le temps le plus contraire. Je gouvernai donc au N. O. autant que le vent le permettait, en me tenant cependant entre les deux lignes de route du 1er et du 2ème voyage de Cook. Je m'attendais à des vents de S. ; mais nous n'eûmes presque toujours qu'un vent de N., qui, le 16, fut impétueux. Les lames étaient très-hautes, et se croisaient en tant de directions différentes, que le vaisseau en fut plus fatigué que si nous eussions eu une tempête. Le baromètre resta extraordinairement bas pendant plusieurs jours : il fut, le 17 dans (137) la nuit, à 28 pouces 45'. Une seule fois, durant tout le voyage, le 1er octobre de cette année, il descendit aussi bas. Une grosse houle du N. O., et les nuages qui, le 18, arrivaient rapidement du même point, nous annonçaient une tempête. Nous fîmes donc des préparatifs en conséquence ; mais le temps fut très-beau et presque calme. La nuit précédente il était tombé une forte rosée ; on la regarde ordinairement comme l'indice du voisinage de la terre. Il n'est cependant pas vraisemblable qu'il en existe une dans ces parages. Notre latitude était de 55° 46', et la longitude de 89° 00'. Nous trouvâmes, entre plusieurs observations, que la déclinaison était de 19° 59’ 20" à l’E., et l'inclinaison de 75° 30’ S.
Le 21 mars, à 8 heures du matin, nous avions, d'après mon calcul, passé l'ouverture du détroit de Magellan, puisque le Cap de la Victoire, à son extrémité septentrionale, nous restait, dans ce moment, à l'E., à la distance de 650 milles. Nous avions ainsi doublé, en 24 jours, la Terre-des-États et la Terre-de-Feu, par conséquent en bien moins de temps qu'on n'eût pu l'espérer dans cette saison avancée. Le baromètre reprit ici sa hauteur ordinaire. Pendant toute la durée de notre navigation autour de la Terre-de-Feu, il s'était constamment (138) tenu, par tous les temps, à 6 lignes plus bas qu'avant d'arriver dans ces parages. Je continuai de gouverner au N. O. pour ne pas suivre la route parcourue par Byron, Wallis, Carteret, Bougainville, Cook et autres navigateurs plus récents : tous, excepté Cook à son premier voyage, s'étaient dirigés presque directement au N. en sortant du détroit de Magellan. Nous eûmes pendant trois jours un vent de S. très-frais, qui, malgré sa force, n'élevait pas la moindre lame. La mer était aussi tranquille que dans une baie. Le baromètre monta à 30 pouces 3’, plus haut par conséquent que nous ne l'avions encore vu dans toute la campagne. Le ciel cependant restait couvert. Enfin le 24 mars le vent souffla avec violence du N. N. E., puis passa au N. N. O. Les lames étaient si hautes et la bruine si épaisse, que nous perdîmes de vue la Néva. Ce temps sombre et orageux continua, et la Néva ne répondit pas aux coups de canon que nous tirâmes pour signal. Il paraissait donc que nous étions décidément séparés, et j'en fus persuadé lorsque le temps s'éclaircit. Il n'était pas vraisemblable que nous puissions nous rejoindre avant d'arriver à Nuku Hiva (* désormais Nuku Hiva). Notre latitude était, ce jour-là, de 47°09', et notre longitude, d'après les chronomètres, 97° 04’.
( … )
17, 18, 19 avril 1804
(144) Je renonçai donc pour le moment au projet de toucher à l'île de Pâques dont nous étions encore éloignés d'environ 50 milles à l'O. ; quoique je dusse présumer que le capitaine Lisianskoï (* ou Lisianski Youri, commandant le second navire, la Néva), qui ne pouvait connaître ma résolution d'aller directement au Kamtchatka, ferait route pour l'île de Pâques dans l'espérance de m'y rejoindre. Le vent ayant soufflé pendant deux jours de suite du S. E. et de l'E.S.E., nous crûmes avoir atteint les vents alizés ; mais il retourna bientôt au N. E. et au N. N. E. Je changeai ma route d'un ou de deux points, suivant que nous nous rapprochions plus ou moins de celle de Wallis ou de Bougainville. Un matelot se tenait constamment au haut du grand mât pendant le jour, et une autre sur le mât de beaupré pendant la nuit. J'avais promis une gratification à celui qui découvrirait la terre ; elle était de 19 piastres pour le jour, et de 20 piastres pour la nuit.
Le 17 avril, nous coupâmes le tropique du Capricorne par 104º 30’ O. Le temps clair et serein nous permit, le 18 et le 19 avril, de prendre plusieurs distances de la lune au soleil. Celles du 18, réduites à midi, donnèrent pour notre longitude 106° 51'23", et celles du 19, 198° 04’ 12". Le chronomètre d'Arnold, nº 128, indiqua le premier jour 107° 20° 52", et le second jour 108° 29'15. (145) Ainsi, par la moyenne, 27’ 46" trop à l'O. La déclinaison de l’aiguille, au 18 avril par 22° 20' de latitude, était de 5° 49’ ; et au 21, par 20° 58’ de latitude et 108° 46 de longitude 5° 12' à l'O. La déclinaison ayant peu varié jusqu'aux îles Sandwich, c'est-à-dire étant restée entre 5 et 5° 1/2 à l'E., j'en ferai rarement mention.
Le 22 avril, après avoir essuyé de violents coups de vent qui se succédèrent rapidement du N. E et du S. E et déchirèrent quelques vieilles voiles, nous rencontrâmes par le 20° 00' de latitude le véritable vent alizé de l'E. S. E. qui, tantôt plus frais, tantôt plus faible, mais toujours accompagné de beau temps, nous conduisit jusqu'aux îles Washington.
La chaleur augmentait beaucoup : le thermomètre de ma chambre, l'endroit le plus frais du vaisseau, monta jusqu'à 22° ½, et celui qui était sur le pont, à l'ombre, à 25°. Nous profitâmes de ce beau temps continu pour prendre, pendant six jours consécutifs, une suite de distances de la lune au soleil. Ces observations sont importantes en ce qu'il en résulte pour les îles Washington et les Mendocines (* autre nom des Marquises du sud-est) une latitude différente de celle qui a été assignée à celles-ci par Cook, et aux premières par Marchand et Wilson. Nos observations méritent de la confiance par leur concordance (146) et d'autant plus que la plupart ont été calculées sur les tables de Burg. Elles nous ont fait reconnaître une erreur de 1º 00’ 5" à l'O. dans le chronomètre n°. 128 : erreur qui se trouve dans toutes nos déterminations chronométriques de longitude des 6 et 7 mai.
Je dirigeai ma route de manière à me trouver à égale distance entre l’île Fatougou (Hood’s Island de Cook) (* désormais Fatu Uku) et Ouahouga (Riou’s Island d'Hergest) (* désormais Ua Huna) : on doit dans cette position pouvoir voir les deux îles. Dans la nuit du 5 mai, nous éprouvâmes un violent orage accompagné d'une grosse pluie et de fortes rafales : le ciel s'éclaircit un peu dans la matinée ; mais il resta pourtant si nébuleux, qu'il fut impossible de prendre aucune distance lunaire. À midi, notre latitude était de 9° 26' S. ; la longitude, d’après les chronomètres (corrigée par nos dernières observations), fut de 137° 08’ O : le vent alizé soufflant grand frais nous fîmes 6 petites voiles pendant la nuit. Au point du jour, nous aperçûmes l'île Fatu Uku qui nous restait au S. 50° O. à la distance de 35 à 38 milles. Cette île est haute, mais petite : ce n'est qu'un rocher tronqué à peu près horizontalement à son sommet et un peu incliné du nord au sud. À son extrémité septentrionale, on aperçoit, mais faiblement, une séparation entre deux hauteurs. Sur la carte de Cook, on voit (147) à la côte du S. quelques rochers que nous n'avons pas aperçus ; mais nous en avons vu plusieurs sur les côtes du N. O. et de l'O. : quelques-uns sont assez hauts et entièrement ronds, tandis que d'autres ont une forme pyramidale. Ils sont éloignés de l'île de 250 à 500 toises. Cook n'a pu les voir à cause de leur situation. Ne s'étant pas avancé au-delà de 9° 20’ N., il avait alors cette île à l'O.S. O.
À 6 ½ heures nous vîmes aussi l'île Ohivaoa, nommée la Domenica par Mendaña (* Désormais Hiva Oa). Nous la prîmes d'abord pour l'île Motane (San Pedro de Mendaña) (*désormais Motane/Mohotane/Mohotani) : nous avions sa pointe E. au S. O. de la boussole et le milieu au S. 70° 30' O. La vue de cette île répond très-bien à la description que Cook en donne ; mais à la distance de 35 milles où nous nous trouvions, il nous fut impossible de l'examiner plus particulièrement.
À 7 heures nous avions son extrémité E. au vrai S. Au moment même, M. Horner et le lieutenant Löwenstern prirent la hauteur du soleil, et trouvèrent, en corrigeant l'erreur des chronomètres, sa longitude de 138° 21' 30" : nous ne pûmes voir assez distinctement la pointe O. de cette île.
À 8 heures, je gouvernai à l'O. N. O. afin d'avoir à midi l'île Ua Pou à l'O., ce qui était le moyen le plus sûr d'en déterminer (148) exactement la latitude. À 10 heures, nous l’aperçûmes à l'O. ¼ N, et quelques minutes après, le milieu de l’île Fatu Uku se trouvait directement au vrai S. Sa longitude, d'après nos observations, est de 138º 29’ 30" ; elle diffère de 18’ 30’’ de celle de Cook, qui est de 138° 48’. Nous trouvâmes aussi, d'après la liaison de nos angles et de nos relèvements, la latitude de 3 minutes plus septentrionale.
Au moment même de la culmination du soleil, nous aperçûmes un double pic dans l’île Ua Pou à l’O. vrai et à la distance de 18 milles. La hauteur du méridien, observé très exactement avec des sextants de Trougthon et de Ramsden, par M. Horner, le lieutenant Löwenstern et moi, donna pour latitude 8° 55’ 58’’ qui est donc celle de ce double-pic, lequel me parut situé entre le N. et le S., quoique peut-être, un peu plus dans cette dernière direction. L'île Fatu Uku, que nous perdîmes bientôt de vue, se trouvait à midi au S. 18° O.
Je prolongeai alors l’île Ua Huna à la distance de 6 à 7 milles, laissant, de temps en temps tomber la sonde sans trouver fond à 100 brasses. Cette île est d'un aspect remarquable ; elle s'élève de l'E à l'O. à une hauteur considérable, présentant dans son centre une assez grande montagne, presqu'entièrement à pic à l'O. : ce n'est qu'à une petite distance à l'O. que l'on découvre le double pic. Lorsque nous eûmes l'extrémité de l'île au NO ¼ O., le double pic disparut et la montagne du milieu se présenta comme une grande coupole, sur le flanc occidental de laquelle on remarquait une élévation pyramidale. On voit à la côte du S. deux enfoncements, où il serait possible de mouiller ; mais on n’y serait pas assez à l'abri des vents. La partie occidentale de l'île me sembla la plus fertile car, quoiqu'elle soit assez haute, elle est plus unie que l'orientale, où des rochers escarpés forment une suite de pics séparés par des vallées profondes. Ces pics la font un peu ressembler à la Terre-des-États (* ?), sans cependant lui donner une apparence si âpre.
On voit en avant de la pointe O. de l’île, un gros rocher isolé d'environ un mile et demi de circonférence. Entre ce rocher et l'île git une grosse masse de roches, plate et semblable à une pierre tumulaire. L’île, après s'être insensiblement abaissée, se termine à l’O. par un rocher escarpé, très-saillant et obtus. On prétend que, derrière ce rocher, il y a un bon port ; nous ne pûmes nous en assurer. Nous eûmes beau côtoyer cette île à une petite distance et par un vent médiocre, aucune pirogue ne parut, et nous ne vîmes pas un seul insulaire. Nous aperçûmes cependant de la fumée en divers endroits. (150)
Aussitôt que nous eûmes la pointe de l'île au N., M. Horner saisit le moment de prendre la hauteur du soleil pour déterminer la longitude d'après les chronomètres ; elle se trouva, avec la correction, de 139° 05' 00". Cette île se dirige de l'E. N. E. à l'O. S. O. : sa longueur est de 9 milles. Sa forme s'accorde assez avec les dessins qu'en ont donnés le lieutenant Hergest et l'astronome Gooch ; cependant, la partie méridionale n'est pas la même dans l'un et dans l'autre. Hergest, au reste, ne s'est approché que du côté occidental. Le centre de l'île Ua Huna est, d'après nos observations, par 8° 54'30" S. ; selon Hergest, il est par 8° 50 50" S. et 139° 09’ 00’’ O.
À 5 heures après midi, nous découvrîmes l'île de Nuku Hiva (*Désormais Nuku Hiva) ; mais la brume qui l'environnait nous empêcha de pouvoir estimer au juste la distance. À 6 heures, je fis serrer toutes les voiles, à l'exception du grand hunier. La carte d'Arrowsmith qui m'inspirait plus de confiance que celle d'Hergest, marquant 27 milles pour la distance de Ua Huna à Nuku Hiva, je gouvernai au N. après avoir fait la moitié de ce chemin ; mais après une heure de marche, je me trouvai si près de terre, que je fus obligé de revirer au S. Il en résulte que la distance est mal indiquée, et notre calcul nous en a convaincu. Elle n'est en effet que de 18 milles, prise depuis la côte occidentale de Ua Huna jusqu'au Cap-Martin, pointe S. O. de Nuku Hiva. Hergest la porte à 20 milles et Wilson à 24. Je ne comprends pas pourquoi Arrowsmith a rejeté les déterminations d'Hergest, qui méritait cependant quelque confiance en qualité d'élève de Cook et d'astronome. Il est vrai qu'Hergest n'est pas toujours très-exact : cependant, il l'est bien plus que Marchand et Wilson. Sa carte de Ua Huna était la seule qu'Arrowsmith pût copier, puisque Marchand n'avait point vu cette île et que Wilson ne l'avait peut-être aperçue que de loin. Je ne connais rien du travail de l'Américain Ingraham qui, le premier, a découvert Ua Huna, ni de ses compatriotes qui ont ensuite vu cette île.
Au point du jour, je gouvernai sur la pointe S. E. de l’île Nuku Hiva, éloignée de 15 milles au N. O. Nous avions l'île Ua Pou au S. O. à la distance de 24 milles. Ses pics nombreux lui donnaient l'apparence d'une vieille ville avec beaucoup de hauts clochers. À 10 heures, nous étions en face de la baie de Home (*Hooumi), nommée par Hergest Comptroller's bay (* La Baie du Contrôleur qui baigne les vallées de Hooumi, Taipivai et Hakapaa.) ; je mis en travers, et envoyai le lieutenant Golovatcheff avec le pilote prendre des sondes. Le Cap-Martin et la pointe occidentale de la baie, surtout le premier, se distinguaient par leurs formes saillantes et hachées. Un gros rocher noir (152) situé à ½ mille à l’O. du Cap-Martin, est aussi un signe très remarquable pour reconnaître Comptroller’s bay. Quoique cette baie soit assez à l’abri des vents, elle ne paraît pas très-commode. Nous vîmes quelques insulaires courir çà et là sur le rivage ; cependant il ne vint point de pirogue, quoique le vent fût faible, ce qui nous donna une mince idée de leur navigation : notre séjour ne nous a pas fait changer d’opinion.
Nous n’avons pas trouvé fond à 2 milles de terre. Bientôt après, la sonde rapporta 500 brasses, fond de sable fin. Cette profondeur ne diminuait que de 15 brasses, car on en trouve encore 55 près de la côte. Après avoir expédié les canots, je prolongeai la terre à 1 mille de distance de plus, sans voir le port nommé Port-Anna-Maria par Hergest. La côte n’offre qu'une suite presque continue de rochers perpendiculaires, auxquels aboutit une chaîne de montagnes qui s'étend dans les terres. L'aspect sombre de ces rochers n'est égayé que par de belles cascades qui, à peu de distance l’une de l'autre, se précipitent dans la mer d'une hauteur de 1000 pieds. Nous découvrîmes au sommet d’une de ces montagnes un bâtiment carré en pierre ressemblant à une tour peu élevée, sans toit et entouré d'arbres. Je le pris d'abord pour un moraï ou un cimetière ; mais n'ayant rien vu (153) de pareil dans le moraï de la vallée Tayo-Hoae (* Désormais Taiohae) que nous visitâmes pendant notre séjour, je crois que c’est une espèce de fort, quoique nous n’ayons pu tirer des insulaires aucune lumière sur ce point. La curiosité avait sans doute attiré une partie des Naturels que nous apercevions sur les rochers les plus près du rivage : la plupart cependant s'occupaient à pêcher à la ligne.
À 11 heures, nous aperçûmes à l'O. une pirogue qui venait à nous ; elle était conduite par huit rameurs et avait un balancier. Nous ne fûmes pas peu surpris de lui voir hisser un pavillon blanc. Ce signe de paix nous fit soupçonner la présence de quelque Européen ; nos suppositions furent bientôt confirmées : c'était un Anglais ; mais il nous fut impossible au premier coup d'œil de le distinguer des indigènes dont il avait pris entièrement le costume, qui ne consiste qu'en une ceinture autour des reins. Il me montra le certificat de deux capitaines américains à qui il avait été utile pendant leur séjour, surtout pour leurs provisions d'eau et de bois, et qui attestaient sa bonne conduite.
J'acceptai ses services avec plaisir, car j'étais bien content de rencontrer un aussi bon interprète. Ignorant entièrement la langue du pays, je n'aurais pu sans son secours former sur cette île que des conjectures souvent erronées. Cet Anglais, nommé Roberts, (* En réalité, le beachcomber anglais ; Edward Robarts – voir bibliographie) nous raconta (154) qu'il était à Nuku Hiva depuis sept ans, après en avoir passé deux autres à Santa-Christina (* Tahuata) ; les matelots d'un vaisseau marchand anglais, révoltés contre leur capitaine, l'y avaient déposé, parce qu'il avait refusé d'entrer dans leur complot. Il avait épousé récemment une parente du roi (* une ses sœurs, Hinaoaiata), et ce mariage lui donnait une grande considération : elle le mettait à même, ajouta-t-il, de nous rendre d'importants services. Il nous avertit en même temps de nous défier d'un Français qui, ayant déserté d'un navire anglais, vivait aussi à Nuku Hiva depuis quelques années. Il nous le dépeignit comme son ennemi mortel, qui employait tous les moyens possibles de le dénigrer auprès du roi et des insulaires, et qui même avait plusieurs fois attenté à sa vie. Est-il possible que la haine innée des deux nations, l'une contre l'autre, se montre même en ces lieux séparés de l'Europe par la moitié du globe !
Pendant mon séjour à Nuku Hiva, je fis tous mes efforts pour réconcilier ces deux hommes. Je leur exposai avec force les motifs puissants qui devaient les engager l'un et l'autre à vivre en bonne intelligence. Transportés par leur destinée au milieu d'un peuple qu'ils peignaient eux-mêmes comme faux, perfide et cruel, ils ne pouvaient que, par leur union intime, employer avec prudence la supériorité de leurs connaissances (155) à se soutenir contre l'île entière ; tandis qu'au contraire, la manière dont ils vivaient ensemble les exposait chaque jour l'un et l'autre à être la victime de leur malheureuse discorde. Ils me promirent de se réconcilier et se donnèrent même la main en ma présence en signe de paix ; mais l'Anglais me dit en face du Français qu'il ne pouvait compter sur un raccommodement sincère, puisqu'il avait déjà prié plusieurs fois son adversaire de vivre de bon accord ensemble, sans jamais y avoir réussi. Il ajouta avec emphase qu'il serait plus facile de mettre à flot cet îlot (en montrant un rocher au bord de la mer), que d'inspirer à Joseph Cabri (1) des sentiments d'amitié pour lui.
(1) C'est ce même Joseph Cabri, qui, venu en 1817 à Paris, y faisait voir ses tatouages pour de l'argent. (Note du traducteur.)
À midi, nous mouillâmes dans le port d'Anna-Maria, par 16 brasses, fond de sable fin et de glaise, à la distance d'environ un demi-mille de la côte du N. et un quart de mille de celle de l'E., ayant la petite île Moutonoe (* l’îlot-sentinelle Motunui), qui forme le côté occidental de l'entrée, au S. 30° O., et l’île Mattaou (* l’îlot-sentinelle Mataùapuna), située à la côte orientale droit au S. ; la petite rivière qui nous fournissait de l'eau mous restait au N. O. (156)
CHAPITRE VII
SÉJOUR À NUKU HIVA
Commerce d'échange avec les insulaires. – Manque absolu de viande - Visite au Roi – Arrivée de la Néva – Mésintelligence avec les indigènes – Ils courent aux armes – Seconde visite au Roi – Pacification – Moraï – Découverte du port de Tchitchagoff – Description de la vallée Hakauì – Départ pour les îles Sandwich.
___________________
À peine avions nous laissé tomber la première ancre que nous fûmes environnés de plusieurs centaines d’insulaires qui nous offraient des cocos, des fruits à pain et des bananes. Nous n’avions à leur offrir en échange que des morceaux de vieux cercles de fer de cinq pouces de longueur dont j’avais fait provision à Cronstadt. Un de ces morceaux était le prix ordinaire de cinq cocos ou de trois ou quatre fruits à pain. Les insulaires paraissaient y mettre une grande valeur ; mais une hache ou une cognée était le comble de leurs vœux. À la vue du plus petit morceau de fer, ils témoignaient une joie enfantine, qu'ils exprimaient par des éclats (157) de rire. Ils montraient d'un air triomphant ce trésor à leurs camarades moins heureux. Cette joie prouve qu'ils n'avaient eu que bien peu d'occasions d'acquérir un métal si précieux. En effet, Robarts nous dit que depuis sept ans on n'avait vu, à Nuku Hiva que deux navires américains.
Ayant appris que les cochons étaient rares dans l’île, je déclarai que je ne donnerais des haches et des cognées que pour un de ces animaux, les vivres étant le principal objectif de ma relâche. J'avais expressément défendu, dès notre arrivée, à tout mon monde, d'échanger la moindre chose contre des curiosités du pays, avec promesse de permettre ce trafic, quelques jours avant notre départ, dès que nous aurions une provision de vivres suffisante. Je nommai le lieutenant Romberg et le docteur Espenberg pour présider aux échanges. Ils pouvaient seuls acheter des vivres ; c’était l’unique moyen de maintenir l’ordre. Mais au bout de quelques jours, m'étant convaincu de l’impossibilité d'obtenir des cochons, et en même temps de la facilité de se procurer des cocos, je levai la défense ; chacun put acquérir à sa fantaisie, des curiosités de l’île.
Le roi, avec toute sa suite, vint à bord à 4 heures après midi. Il se nomme Tapega Kettenovie (* Tāpiika Kiatonui, chef de la tribu des Teii qui occupe la baie de Taiohae). C'est un homme de 40 à 45 ans, bien fait (158), robuste, le col épais ; il a le teint brun, presque noir. Il était tatoué partout, jusque sur la tête, dont quelques parties avaient été rasées exprès. Du reste, rien ne le distinguait de ses sujets ; car, à l'exception du tchiabou (2), il était entièrement nu.
(2) Note du traducteur : le tchiabou est une ceinture que les sauvages portent autour des hanches ou des reins : elle porte le nom de maro aux îles Sandwich (* Hawaii). * Note de Jacques Iakopo : il s’agit du mot marquisien hiapo désignant le pagne/hami fabriqué à partir de l’écorce des racines des jeunes banians ; de couleur brun-rouge, il était réservé aux chefs et à leurs fils.)
Après l'avoir conduit dans ma chambre, je lui donnai un couteau et une pièce d'étoffe rouge, longue d'une vingtaine d'aunes, dont il s'enveloppa aussitôt les hanches. Je fis aussi des présents à sa suite, composée principalement de ses parents, quoique Robarts me conseillât de n'être pas si généreux : car ces gens-là, me disait-il, sont étrangers à la reconnaissance, et aucun insulaire, pas même le roi, ne vous donnera la moindre chose en retour. Je ne manquai pas de faire observer au roi la grandeur de nos vaisseaux et le nombre de nos canons, en l'assurant que je n'avais pas l'intention de m'en servir contre ses sujets, et je le priai de leur bien recommander de ne rien faire qui nous forçât d'user de voies de fait. Je m'imaginais alors que l'autorité du roi était aussi grande ici qu'aux îles Sandwich et aux îles de la Société (* Tahiti) ; mais je fus bientôt détrompé. Quand il fut remonté sur le pont (159), de petits perroquets du Brésil attirèrent son attention, et lui causèrent autant d'étonnement que de plaisir. Il s'assit et resta quelques minutes à les considérer. Je crus devoir lui en offrir un, comme le moyen le plus sûr de gagner son affection. Robarts, qui blâmait ma libéralité, ne lui traduisit pas exactement mes offres ; car je reçus le lendemain un cochon en échange.
Au coucher du soleil tous les hommes, sans exception, retournèrent à terre ; mais une centaine de femmes restèrent encore près du vaisseau, autour duquel elles nageaient depuis plus de cinq heures, employant tout leur art à faire connaître le but de leur visite. Il était impossible de ne pas les comprendre ; leurs attitudes et leurs gestes étaient trop significatifs. Les occupations de l'équipage, qui ne pouvaient être interrompues, empêchèrent sans doute les matelots de donner beaucoup d'attention à ces agaceries. J'avais d'ailleurs défendu positivement d'admettre qui que ce fût à bord, n'importe le sexe, excepté la famille royale. Mais à la nuit tombante, ces pauvres créatures demandèrent, d'un ton si lamentable, la permission de monter à bord, que je ne pus la leur refuser. Je crus pouvoir d'autant plus montrer de l'indulgence sur ce point, que tout mon monde jouissait de la meilleure santé, et (160) que Robarts m'assurait que l'île était exempte de maladie. Cependant je mis des bornes à cette complaisance : deux jours après, je ne laissai plus venir de femmes à bord, quoiqu'il s'en présentât tous les jours plus de cinquante, qui nageaient autour du vaisseau ; elles ne s'en éloignèrent qu'après qu'on eut tiré quelques coups de fusils par-dessus leurs têtes. Je croirais volontiers que cette dégradation du sexe féminin doit être moins attribuée à leur légèreté ou à leur libertinage, qu'à leur obéissance aux volontés tyranniques et brutales de leurs pères et de leurs maris, qui les envoyaient pour obtenir par elles du fer et d'autres bagatelles. En effet, ces hommes venaient le matin, en nageant, au-devant d'elles, recueillir ce qu'elles avaient reçu. J'ai vu un homme amener à la nage une jeune fille de dix à douze ans (c'était sans doute la sienne), et l'offrir à qui voudrait le payer : mais ce qui excita mon étonnement et mon dégoût, fut une enfant de huit ans au plus, aussi peu retenue et aussi prodigue de ses faveurs que ses sœurs de dix-huit ou de vingt ans. Je considérai quelque temps cette malheureuse avec un mélange de pitié et d'horreur : c'était absolument une enfant, riant et folâtrant, comme on fait à son âge, sans la moindre idée de son malheureux état.
Le lendemain, dès 6 heures du matin, (161) le vaisseau était environné de plusieurs centaines d'insulaires qui nous offraient à acheter des cocos, des bananes et des fruits à pain. Toute la famille royale vint à bord à 7 heures : je la conduisis dans ma chambre, et j'offris un présent à chacune des personnes qui la composait. Le portrait de ma femme attira particulièrement leur attention, ils s'arrêtèrent longtemps à le considérer, et exprimèrent, avec air de satisfaction leur admiration et leur étonnement. Ils se faisaient surtout remarquer l'un à l'autre la frisure, qu'ils regardaient sans doute comme une grande beauté. Un miroir ne les surprit pas moins. Ils examinèrent avec soin le derrière de la glace, pour s'en expliquer le merveilleux effet. Un grand miroir dans lequel ils pouvaient se voir de la tête aux pieds, fût pour eux une chose très-extraordinaire. Le roi surtout prenait beaucoup de plaisir à s'y regarder ; et chaque fois qu'il entrait à bord, soit vanité, soit curiosité, il courait aussitôt à ma chambre se placer devant la glace, et y restait souvent des heures entières. Je m'étais proposé d'aller à terre pour rendre une visite au roi, et chercher en même temps une bonne aiguade. Mais afin que le vaisseau ne fût point surchargé d'hôtes incommodes pendant mon absence, je fis tirer un coup de canon et arborer en même temps (162) pavillon rouge. C'était déclarer dès ce moment le vaisseau tahbou (3), et tout commerce interrompu.
(3) Le mot tahbou (* tabou, en français ; tapu, en marquisien) étant assez connu par les voyages de Cook, je crois inutile d'en donner ici l'explication. Mais on verra dans le chapitre suivant jusqu'où va sa puissance dans l'île de Nuku Hiva.
Aussi personne ne vint à bord. Cependant, ceux qui nageaient autour du bâtiment paraissaient s'éloigner avec peine. À 10 heures, je me fis conduire à terre, accompagné de l'ambassadeur et d'une grande partie de mes officiers. Quoique les dispositions pacifiques des habitants et l'amitié qui paraissait régner entre le roi, ainsi qu'entre sa famille et moi, me fissent espérer une bonne réception, je crus prudent toutefois de me tenir sur mes gardes ; et, en conséquence, je fis accompagner ma chaloupe d'un second canot. Tous les matelots avaient une paire de pistolets et un sabre. J'avais en outre 6 soldats armés, et chaque officier portait de même ses armes. L'Anglais et le Français nous servaient d'interprètes.
Une foule d'habitants des deux sexes étaient rassemblés sur le rivage, où nous ne pûmes débarquer qu'avec difficulté à cause de la force du ressac. Quoique ni le roi, ni personne de sa famille ne fût présent, la conduite du peuple fut respectueuse et polie. Après avoir goûté de (163) l'eau que je trouvai très-bonne, je marchai vers une maison peu éloignée, et dans laquelle le roi nous attendait. Lorsque nous en fûmes à cinq cents pas, nous vîmes arriver vers nous l'oncle du roi, qui est en même temps son beau-père, et qui n'est connu ici que sous le nom de père du roi (* Probablement Puakahuhu, 2ème époux de Putahaii, mère de Kiatonui ; son 1er époux, Tīmaùteii, père de Kiatonui, avait péri en mer jeune, lors d’une expédition à Eiao). Quoiqu'âgé de soixante-quinze ans, il paraissait jouir encore d'une santé excellente. Ses yeux étaient vifs, et à en juger par sa physionomie, il devait être d'un caractère ferme et intrépide. Il avait été un des plus grands guerriers de son temps : il souffrait même encore d'une blessure à l'œil qu'il tenait couvert d'un bandeau. Il portait un long bâton, avec lequel il s'efforçait, mais assez inutilement, d'écarter la foule qui nous suivait. Il me prit par la main et me conduisit à une maison longue et étroite, dans laquelle la reine-mère (* Putahaii) et ses parentes étaient assises et semblaient nous attendre.
À peine fûmes-nous arrivés dans l'enceinte, que le roi vint à notre rencontre et m'accueillit avec beaucoup d'aisance et d'amitié. Le peuple s'arrêta parce que la maison du roi est tabou : on me fit asseoir au milieu des dames qui me considérèrent avec une grande curiosité ; elles prenaient tour à tour mes mains dans les leurs et ne les quittaient que pour examiner mes habits, les broderies de mon uniforme, mon chapeau, etc. : (164) leur physionomie annonçait tant de bonté, que je conçus la meilleure opinion de leur caractère. Je leur fis présent de boutons, de couteaux, de ciseaux et d'autres bagatelles dont je m'étais pourvu, mais qui ne leur firent pas autant de plaisir que je m'y attendais : elles paraissaient plus occupées de nous que de nos présents. La fille du roi, jeune personne d'environ vingt-quatre ans (* Probablement Tahatapu, sa fille aînée, épouse du chef Hapaa Mauateii, tous deux parents de Paetini) et sa belle-fille plus jeune de quelques années, auraient passé pour jolies même en Europe ; elles étaient toutes enveloppées d'une étoffe jaune : leur tête n'avait d'autre ornement que leurs cheveux noirs enduits d'huile de coco et noués en une touffe serrée sur la tête. Leur corps, que l'enveloppe, jaune ne cachait pas entièrement, n'était ni peint ni tatoué. Elles n'avaient de tatoué, en noir et jaune, que la moitié du bras et la main : on aurait dit des gants courts que nos dames portaient autrefois.
Après nous être reposés, le roi nous conduisit à un autre bâtiment dans lequel étaient réunis tous ses parents mâles. Ce bâtiment n'est éloigné que de quinze pas de l'autre et ne sert que pour les repas. On y étendit aussitôt des nattes sur lesquelles nous nous plaçâmes. Nos hôtes paraissaient avoir tant de joie de nous voir au milieu d'eux, qu'ils ne savaient comment nous la témoigner. L'un nous (165) apportait des cocos, un autre des bananes, un troisième de l'eau ; plusieurs se tinrent près de nous pour nous rafraîchir avec leurs éventails.
Après une visite d'une demi-heure, nous prîmes congé du roi et retournâmes à nos canots. Ce fut encore le beau-père du roi qui nous reconduisit aussi loin qu'il était venu à notre rencontre. Une foule innombrable nous entourait : plusieurs insulaires parlaient fort haut, sans avoir, je le crois, aucune mauvaise intention ; cependant je présume que les six soldats sous les armes, dont trois marchaient devant nous et trois derrière, purent être la vraie cause de la conduite paisible des Nukuhiviens.
Nous rentrâmes à bord à midi. J'expédiai sur-le-champ la chaloupe avec les barriques vides ; elle revint au bout de trois heures, les insulaires avaient montré beaucoup d'empressement à aider nos gens, remplissant eux-mêmes les barriques et les poussant à la nage au-delà des brisants. Sans leur secours officieux, il eût été impossible de ramener plus d'une chaloupe par jour, encore n'aurait-on pu en venir à bout qu'avec de grands efforts de la part des matelots et au péril de leur santé ; mais, grâce à l'aide des insulaires, on put facilement faire trois voyages par jour, et même nos gens se bornaient à avoir l'œil sur ces actifs travailleurs, qui, au moyen de cette vigilance, ne purent (166), en huit jours, dérober que le cercle de fer d'une barrique. On leur donnait chaque jour, en récompense de leurs peines, une douzaine de morceaux de vieux cercles longs de cinq pouces.
Malgré tous nos efforts, nous ne pûmes pas obtenir de cochons. En trois jours, on ne nous en apporta que deux, encore l'un provenait-il d'un échange contre un perroquet, et l'autre avait-il coûté une grande hache. Nous fûmes donc obligés d'user de nos provisions, comme si eussions été en mer. Notre seule ressource pour corriger l'âcreté de notre sang, après un long usage de salaisons, était le lait de coco : c'est pourquoi je fis acheter tous ceux qu'on apportait à vendre, et chacun de nous en mangeait autant qu'il voulait.
Le 10 mai, on nous apprit que des hauteurs de l'île on avait aperçu un vaisseau à trois mâts. Persuadé que c'était la Néva, j'envoyai aussitôt un canot avec un officier pour la conduire dans la baie ; mais il était trop tard : la Néva se tenait à une si grande distance de terre, que le canot revint sans avoir pu l'atteindre. Le lendemain, j'expédiai le lieutenant Golovatcheff à sa rencontre, et à midi nous eûmes la satisfaction de voir la Néva à l'entrée de la baie.
Comme il faisait calme, je donnai à l'instant l'ordre à la chaloupe de la remorquer (167) ; à cinq heures, elle jeta l'ancre à côté de nous. Le capitaine Lisianski me raconta qu'il s'était arrêté quelques jours près de l’île de Pâques, dans l'espérance de nous y trouver ; mais des vents violents de l'ouest l'avaient empêché d'y mouiller. Il avait envoyé un canot à la baie de Cook, et échangé avec les habitants des bananes et des patates. J'eus grand plaisir à apprendre que tout le monde était en bonne santé, et que depuis notre séparation il n'était rien arrivé de fâcheux.
Le 12 à 5 heures après midi, pendant que j'étais allé faire visite au capitaine Lisianski, je reçus la fâcheuse nouvelle que tous les insulaires couraient aux armes, parce qu'on avait répandu le bruit que nous tenions leur roi aux arrêts sur notre vaisseau. La chaloupe de la Néva vint au même moment ; et l'officier qui la commandait confirma la nouvelle, ajoutant qu'il avait eu beaucoup de peine à s'embarquer, que ce n'était qu'aux remontrances de l'Anglais Robarts qu'il devait de n'avoir point été attaqué, qu'enfin Robarts lui-même avait couru le risque de devenir la victime de la fureur des Nukuhiviens. Cette affaire me paraissait inconcevable. Je ne faisais que de quitter le vaisseau, et il y avait une demi-heure qu'un de nos canots avait ramené le roi à terre. Il avait passé la matinée avec nous et jamais je ne l'avais vu de si bonne humeur (168).
Outre les présents qu'il recevait chaque fois qu'il venait à bord, je l'avais fait raser et laver avec de l'eau parfumée, ce qui lui avait causé un plaisir inexprimable. Je retournai sur-le-champ à bord pour m'informer si quelqu'un ne l'avait pas offensé ; mais il ne s'était absolument rien passé. Je ne savais si le roi lui-même n'avait pas donné lieu à ce faux bruit ; et cela me paraissait impossible, car il n'avait aucune raison de se plaindre. Je soupçonnai alors que le Français pourrait bien être la cause de tout ce vacarme. Par méchanceté et peut être par jalousie de ce que nous lui préférions l'Anglais, il avait voulu semer la désunion entre les insulaires et nous. Les informations que je pris à ce sujet, confirmèrent en partie mes soupçons : voici ce qui était arrivé.
Pendant que j'étais à dîner, l'officier de quart me fit dire que le roi, qui venait d'être reconduit à terre, il y avait à peine une heure, était revenu à bord avec un homme qui apportait un cochon, pour lequel il demandait un petit perroquet. En moins de dix minutes, je fus sur le pont ; mais l'homme était déjà parti parce qu'on ne lui avait pas donné le perroquet sur-le-champ. J'en fus très-surpris ; et comme il importait beaucoup d'avoir le cochon, je priai le roi de rappeler le trop impatient vendeur. Il paraît que celui-ci ne s'inquiétait guère de l'ordre du roi (169), puisqu'il redoubla de vitesse pour gagner le rivage.
Au même instant, un de ceux qui accompagnaient le roi sauta du pont dans la mer et nagea avec agilité à la suite de la pirogue, afin, m'assurait le Français, d'engager le naturel à ramener son cochon à bord ; mais ce n'était pas vrai, le roi l'envoyait au contraire, comme je l'ai appris depuis, pour annoncer que je voulais le mettre aux fers. Si tout ceci n'était pas une imposture du Français, ce que j'ai tout lieu de croire, il était de son devoir de m'avertir de l'ordre du roi ; car il n'ignorait pas les sérieuses conséquences qui pouvaient en résulter. Je regardai, au reste, cette affaire comme peu de chose. Je n'en montrai point d'humeur et encore moins de colère, ce qui aurait pu faire craindre des mesures violentes de ma part. Le roi resta encore une heure à bord après cette aventure, et retourna à terre sur un de nos canots avec l'air fort tranquille en apparence. Dès que le bruit se fut répandu dans l’île que le roi était enchaîné, chacun avait pris les armes, et l'on a vu que la chaloupe de la Néva ne s'était échappée qu'avec beaucoup de peine. Cependant, l'arrivée du roi qui n'avait éprouvé aucun mal, tranquillisa un peu ses sujets. Soit que le roi eût pu craindre quelque violence de notre part, soit que le Français eût eu la malice de lui inspirer cette idée (170), il me parut convenable d'aller lui faire visite le lendemain pour le convaincre que nous n'avions pas eu la moindre intention hostile envers lui. Le frère du roi m'avait déjà demandé, quelques jours auparavant, pourquoi je n'avais encore mis personne aux fers, comme un Américain (4) y avait mis un parent du roi.
(4) Cet Américain avait été ici 8 mois avant nous.
Je lui avais répondu que je ne ferais certainement pas le moindre mal à personne, tant que l'on se comporterait amicalement avec nous, et que j'espérais que nous nous séparerions bons amis.
Le capitaine Lisianski m'accompagna. Nous partîmes à 8 heures du matin, après avoir envoyé nos chaloupes, une heure auparavant, à l'aiguade. Nous descendîmes à terre au nombre de 40, y compris 20 hommes armés : nous étions nous-mêmes munis de nos armes. En outre, les deux embarcations, destinées à charger les barriques d'eau, portaient chacune deux petits canons d'une livre et 18 hommes d'équipage, commandés par deux lieutenants : nous pouvions par conséquent défier l’île entière, si l'on eût eu envie de nous attaquer.
Personne ne se trouva sur le rivage à notre arrivée. Nous avions vu, pendant toute la nuit précédente, des feux en divers endroits, et le matin aucun (171) insulaire n'apporta des cocos comme à l'ordinaire : il paraissait donc que les esprits n'étaient pas encore tout-à-fait rassurés. Nous allâmes droit à la maison du roi, située dans une vallée à un mille dans les terres (* Dans la vallée Meàu de Taiohae, en un lieu connu sous le nom de Otahu de nos jours ; à exactement 1850 m de la plage, on y trouve désormais les captages d’eau.). Le chemin traversait un bocage de cocotiers, d'arbres à fruits et de miro (* le bois de rose polynésien, thespesia populnea). L'herbe était si abondante et si haute, qu'elle allait jusqu'à nos genoux et retardait notre marche ; enfin, nous parvînmes à un sentier, dans lequel nous trouvâmes des traces d'une coutume de Taïti (* Tahiti), qui ne donne pas une grande idée de la propreté des Nukuhiviens. Un ravin, rempli d'eau à un pied de profondeur, nous conduisit à un chemin très-bien entretenu.
Nous entrâmes ensuite dans une magnifique forêt, qui paraissait s'étendre jusqu'à une chaîne de montagnes qui bornaient l'horizon. Les arbres de la forêt, hauts de 70 à 80 pieds, étaient principalement des cocotiers et des arbres à pain, qu'on reconnaissait facilement aux fruits qu'ils portaient en abondance. Les ruisseaux, qui descendaient avec rapidité des montagnes en se croisant, arrosaient les habitations de la vallée ; des masses de rochers interrompaient leur cours, y formaient des cascades bruyantes et pittoresques. (* C’est exactement le paysage que l’on voit à Otahu).
On voyait près des maisons de grandes plantations de taro et de mûriers rangées dans le plus bel ordre (* le mûrier à papier/ute servait à la fabrication du tapa le plus léger et le plus blanc), et entourées de (172) jolies palissades de perches blanches ; coup d'œil qui annonçait de grands progrès dans la culture. Cette vue, vraiment ravissante, contribua beaucoup à faire trêve, pour quelques moments, à la sensation pénible que nous éprouvions de nous trouver au milieu d'un peuple de Cannibales adonnés aux vices les plus révoltants.
Le roi vint à notre rencontre à quelques centaines de pas de sa maison : il nous fit l'accueil le plus cordial. Nous trouvâmes chez lui toute la famille rassemblée et très-contente de notre visite, car chacun de nous apportait un présent. La reine fut au comble de la joie de recevoir un petit miroir. Je priai le roi de me dire franchement ce qui l'avait engagé à répandre un bruit qui avait failli à rompre la bonne harmonie qui régnait si heureusement entre nous, et aurait pu donner lieu à des scènes sanglantes, dont les suites n'auraient pas été à son avantage. Il me certifia qu'il n'avait jamais rien appréhendé de ma part ; mais le Français lui avait dit que je le ferais certainement mettre aux fers, si le cochon n'était pas incontinent rapporté à bord. Je vis par-là que mes soupçons sur Joseph Cabri n'étaient que trop bien fondés. Je fis de beaux présents au roi et à toute sa famille, et je le priai d'être bien convaincu, qu'à moins d'y être forcé, je n'emploierais jamais la violence contre personne (175), encore moins contre lui, que je regardais comme mon ami.
Après nous être reposés et rafraîchis avec du lait de coco, nous allâmes, sous la conduite de Robarts, voir un Moraï. Mais, avant de quitter la maison, on nous présenta la petite-fille du roi, qui, comme tous les enfants et petits-enfants de la famille royale, est traitée d'etoua (être divin) (* ètua) (* C’était peut-être Honutini qui prit le nom de Paetini en grandissant). Elle avait sa maison particulière dans laquelle personne ne pouvait entrer, à l'exception de sa mère, de sa grand-mère et de ses plus proches parents. Cette habitation était tabou pour tout le reste des insulaires. Le plus jeune frère du roi portait sur ses bras cette petite divinité, enfant de huit à dix mois.
Je demandai combien de temps les mères allaitaient leurs enfants. On me répondit qu'en général les enfants ne tètent point. Aussitôt qu'un enfant vient.au monde, une des plus proches parentes, parmi lesquelles il s'élève ordinairement des disputes à ce sujet, l'emporte chez elle, et le nourrit de fruits et de poissons crus. Ainsi ces insulaires ne sont point allaités, et cependant les hommes sont d'une stature colossale.
Enfin, nous nous sommes mis en chemin pour le Moraï, et nous avons passé près d'une source minérale ; elles sont nombreuses dans cette île. Ce Moraï est placé sur une montagne assez haute que nous eûmes beaucoup de peine à gravir (174), ayant le soleil presque perpendiculaire sur nos têtes.
Au milieu d'un bois touffu, si entrelacé de lianes qu'il semble impénétrable, nous avons trouvé une espèce d'échafaud au haut duquel était un cercueil renfermant un cadavre dont on n'apercevait que la tête. Le Moraï était orné, en dehors, de piliers de bois taillés pour représenter des figures humaines, mais ce n'était que le travail d'un artiste maladroit. Près de ces statues s'élevaient des colonnes enveloppées de feuilles de cocotier et de toile de coton blanche. Nous étions fort curieux de savoir ce que signifiaient ces enveloppes : mais tout ce que nous apprîmes à ce sujet, c'est que les colonnes étaient tabou. À côté de ce Moraï se trouvait la maison du prêtre ; il était absent. Chaque famille a son Moraï particulier ; celui que nous vîmes appartenait à celle du prêtre ; et sans Robarts, qui est allié à cette famille aussi bien qu'à la famille royale, nous n'eussions peut-être pas pu le visiter, car les Nukuhiviens n'en accordent pas volontiers la permission. Les Moraïs sont ordinairement sur des montagnes, au centre du pays : celui-ci fait exception, car il n'est pas fort éloigné du rivage. Dès que M. Tilésius eut fini de dessiner la vue du Moraï, nous retournâmes à nos canots.
(Aquarelle du Moraï exécutée par Tilésius,
ce jour-là au fond de la vallée Meàu à Taiohae.)
Nous ne pûmes cependant rejeter la demande de Robarts, qui nous pria d'aller voir sa maison (175), et nous n'eûmes pas lieu de regretter le petit détour que cette visite nous causa. Sa maison, construite à la manière du pays, est toute neuve, et située au milieu d'un bois de cocotiers ; d'un côté coule un ruisseau, et de l'autre une source minérale jaillit du milieu des rochers. Nous nous assîmes, auprès de cette habitation, sur des rochers qui bordent le ruisseau, et à l'ombre des majestueux cocotiers ; nous nous remîmes un peu de la fatigue de notre promenade. Une vingtaine d'insulaires, perchés sur les arbres, jetaient à terre les cocos, tandis que d'autres naturels les épluchaient et les cassaient avec une adresse merveilleuse. Nous apaisâmes la faim qui commençait à se faire sentir avec l'amande et notre soif avec le lait de ce fruit admirable. La femme de Robarts, âgée de dix-huit ans, s'écartait un peu des usages du pays. Elle n'avait pas, comme les autres, frotté son corps avec l'huile de coco, qui donne, il est vrai, beaucoup de lustre à la peau, mais qui répand aussi une odeur insupportable. À une heure, nous fûmes de retour de notre excursion et très-satisfaits. La nouvelle de notre visite au roi s'était rapidement répandue, car nous trouvâmes le rivage couvert de monde ; et à peine fûmes-nous à bord, que le commerce d'échange reprit son cours ordinaire (176).
Le 11 mai, j'avais envoyé le lieutenant Löwenstern pour relever la côte de Nuku Hiva à l'O. de la baie Taiohae. Il avait découvert, à 5 milles de cette baie, un port dont il me fit une description si brillante, que je résolus de le voir par moi-même. En conséquence, je m'y rendis le 15, accompagné du capitaine Lisianski, du lieutenant Löwenstern, de MM. Horner, Tilésius et Langsdorff, et de quelques officiers de la Néva, dans deux canots. Nous prîmes avec nous plusieurs articles d'échange et des présents, dans l'espérance d'obtenir un surcroît de vivres.
Nous arrivâmes à 10 heures du matin, après une navigation d'une heure et demie. La sonde rapportait, à l’entrée de la baie, 20 brasses, sur un fond de sable fin mêlé d'argile. La côte O. de l'entrée est bordée de rochers élevés et perpendiculaires d'un aspect sauvage. Dans l'intérieur on voit, du côté de l'E., une autre baie qui paraît semée de rochers, et entièrement ouverte à l’O. ; en sorte que le ressac y est très-fort : mais dès qu'on a doublé la pointe de cette baie rocailleuse, on découvre le plus beau bassin que l'on puisse imaginer. Sa plus grande longueur, du N. E. au S. O., est environ de 200 toises ; sa largeur de 100 : le fond est terminé par une plage unie, sablonneuse, derrière laquelle s'étend une pelouse comparable aux plus beaux gazons anglais (177). On trouve en quelques endroits de l'eau douce, qui tombe des montagnes dont la baie est entourée. Un ruisseau assez considérable coule dans une jolie vallée, habitée et située au N. de l'entrée du port. Les indigènes la nomment Hakauì (* Désormais Hakauì). Le ruisseau se jette dans la baie septentrionale. Mais cette baie n'étant pas à l'abri des vents, le ressac y rend le débarquement fort difficile. Je crois cependant que, de mer haute, un canot de moyenne grandeur pourrait entrer dans la rivière. Au reste, on fait de l'eau très facilement : il ne s'agit que d'amarrer les canots près des brisants, les insulaires, comme je l'ai déjà dit, se chargent, pour quelques morceaux de fer, de remplir les barriques et de les ramener, en nageant, à travers les brisants. · Ce beau bassin est si bien enfermé dans les terres, que la tempête la plus violente ne pourrait guère agiter ses eaux. Un vaisseau qui a besoin de se radouber ne pourrait choisir un lieu plus commode.
À 50 toises de la côte orientale, la profondeur est de 5 brasses, et, à 10 toises, elle est encore de 10 à 12 pieds. Le déchargement s'effectuerait avec la plus grande facilité ; même dans le cas où l'on n'aurait pas besoin d'un radoub, je préférerais ce port à celui de Taiohae (Anna-Maria). Les cocos, les bananes et les fruits à pain y sont en aussi (178) grande abondance. Peut-être les provisions animales sont-elles aussi rares qu'à Taiohae : mais un avantage bien grand que ce nouveau port a sur l'autre, c'est que l'on n'y mouille qu'à cent toises du rivage, et qu'ainsi la demeure du roi et celles des habitants de la vallée se trouvent sous le canon des vaisseaux. Une attaque, de la part des insulaires, deviendrait impossible. On ne serait pas obligé non plus de donner une escorte à chaque canot qui va à terre, comme on le fait à Taiohae ,où le vaisseau est obligé de mouiller à plus de demi-mille de la côte, et où le rivages est d'ailleurs marécageux ou couvert de grosses pierres; en sorte que, pour jouir d'un air salubre, il faut s'enfoncer assez avant dans les terres : enfin, il serait très-difficile d'établir avantageusement un hôpital dans le voisinage ; et si l'on voulait y avoir un observatoire, on exposerait les instruments à être dérangés dans le transport, à cause de la violence du ressac qui rend le débarquement difficile.
À la nouvelle baie, au contraire, l'hôpital et l'observatoire pourraient être très-bien placés sur la belle prairie qui est près du rivage (* en amont de la plage de Hakatea), et l'on ne peut imaginer une plus agréable promenade que les bords de la rivière qui coule dans la vallée de Hakauì. On est d'ailleurs dans cette baie parfaitement à l'abri de toute surprise de (179) la part des habitants, à cause des rochers qui ferment la vallée du côté de la pelouse ; ils seraient obligés de les franchir ou de traverser plusieurs montagnes, ce qui ralentirait leur marche, et donnerait la facilité de les apercevoir longtemps avant leur arrivée dans le voisinage des vaisseaux. Le seul inconvénient de ce port est son entrée, qui, dans sa partie la plus resserrée, n'a que 120 toises. Ce passage est difficile sans être dangereux, car le fond a 15 à 20 brasses de profondeur, et l'on peut se touer si le vent n'est pas trop fort. La baie de Taiohae (Anna-Maria) n'est pas plus commode à cet égard, puisqu'il faut presque toujours se touer pour y entrer ou pour en sortir. Les insulaires ne désignent ce port par aucun nom particulier, quoiqu'ils donnent celui de Hakauì à la vallée dans laquelle ils demeurent. Je l'ai nommé Port Tchitchagoff, en l'honneur de notre ministre de la marine. Il est situé par 8° 57’ 00’’ de latitude S. et 139°42’ 15" de longitude O.
(1804 – Baie de Hakauì / Tchitchagoff – Atlas de Krusenstern, 1813)
Quoique les environs de l'habitation du roi et de la maison de l'Anglais Robarts, à Taiohae, m'aient paru fort agréables, je leur préfère la vallée de Hakauì. Ce qui contribue le plus à l'embellir, est la petite rivière qui, coulant avec rapidité au pied de hautes montagnes, l'arrose en serpentant. C'est sur sa rive gauche (180) que les habitations sont placées. Elles annoncent plus d'aisance que celles de Taiohae ; les insulaires mêmes y ont meilleure mine. On y voit des plantations de racines de taro et de mûriers plus nombreuses et plus étendues ; enfin, ce qui fait la principale richesse de l’île, une plus grande quantité de cochons, dont les habitants sont également très-avares, car nous n'en pûmes pas obtenir un seul.
Le roi de cette vallée, nommé Baouteng (* Pautini, dont l’épouse, Uuhei, est la sœur de Tahiataiòa, épouse de Kiatonui), homme d'une taille gigantesque, nous en apporta un pour le vendre ; mais il ne put se résoudre à se séparer de son trésor. Quatre fois le marché fut renouvelé et toujours il le rompit. Quoique le dernier lui fût très-avantageux, il s'en repentit aussitôt, et nous rendit nos marchandises, malgré le plaisir qu'elles avaient paru lui causer.
Notre arrivée répandit la joie parmi les habitants du canton ; ils nous souriaient avec un air de plaisir ; et quoique nous fussions les premiers Européens qui fussent venus chez eux, il n'y eut ni presse importune, ni cris excessifs ; chacun apportait tranquillement des bananes et des fruits à pain, pour les échanger contre des morceaux de vieux fer.
Les femmes de cette vallée diffèrent aussi beaucoup de celles de Taiohae. Elles sont en général mieux faites et deux d'entre elles auraient pu même, en Europe, passer pour très-jolies. Aucune n'était entièrement nue (181) ; toutes étaient enveloppées de longs châles d'étoffe jaune. Mais ce qui les distingue surtout de leurs voisines de Taiohae est une sorte de turban de toile blanche arrangé avec goût, et qui leur sied à merveille. Elles s'étaient fortement frottées d'huile de coco, qui donne à leur corps un lustre qu'elles regardent comme une grande beauté.
Nous n'avions pas remarqué ce surcroît de luxe sur celles qui étaient venues à notre rencontre sur le rivage, l'empressement de nous voir ne leur ayant peut-être pas laissé le temps de faire leur toilette : mais quand nous allâmes, quelques heures après, dans la vallée, nous les trouvâmes beaucoup plus parées, parce qu'elles s'étaient tatoué les bras, les mains et le bout des oreilles, et avaient même tracé sur leurs lèvres des lignes transversales. Quant à la modestie et à la pudeur, elles y paraissaient aussi étrangères que leurs sœurs de Taiohae. Elles témoignaient un désir extrême de faire une connaissance intime avec leurs nouveaux hôtes : leurs gestes étaient trop expressifs pour qu'on pût s'y méprendre. La troupe qui les entourait applaudissait vivement à cette pantomime ; et si elles étaient excitées à jouer ce rôle, comme tout le faisait présumer, il faut avouer qu'elles s'en acquittaient parfaitement bien.
Durant notre promenade, dans la vallée, (182) nous observâmes, à quelques centaines de pas de la maison du roi, un grand espace de terrain uni, ayant en avant une terrasse en pierre haute d'un pied, et longue de 100 toises. Cet ouvrage annonçait une habileté dont nous n'avions pas aperçu d'exemple à Taiohae. Les pierres des fondations étaient placées avec une grande justesse, et si bien jointes, qu'aucun ouvrier européen n'eût pu faire mieux. Robarts nous dit que cette plate-forme servait de siège aux spectateurs pendant les danses solennelles. (* Il s’agit probablement du tohua koìka Ponaòuoho dont il ne subsiste que quelques pierres de nos jours.)
À quatre heures après midi, nous nous rembarquâmes ; mais, contrariés par le vent, nous ne pûmes rentrer à bord qu'à 8 heures du soir. MM. Tilésius et Langsdorff, qui voulurent retourner par terre, n'arrivèrent que le lendemain, mais très-satisfaits de leur course. Le chemin, qui traversait des montagnes hautes et escarpées, les avait d'abord tellement fatigués, qu'ils furent obligés de passer la nuit dans l'habitation d'un ami de Robarts : celui-ci avait été leur guide dans cette promenade.
Le 16 mai, nous avions achevé notre provision d'eau et de bois.
Le 17, au point du jour, je fis lever une ancre, et, à huit heures, la seconde.
Le port étant entre de hautes montagnes qui occasionnaient un changement de vent presque continuel, la sortie en est souvent très-difficile. Il fallut donc nous touer (* vieux mot français signifiant remorquer, tracter ; tow en anglais.) (185) quelque pénible que fût ce travail par une très-grande chaleur.
Le vent avait soufflé d'abord assez constamment de terre, et nous étions déjà parvenus au milieu de la baie, lorsque tout à coup il varia de manière qu'il nous fallut à chaque instant courir des bordées. De plus, un courant nous entraînait de plus en plus à l’O., et nous fûmes forcés de laisser tomber l'ancre à 120 toises de la côte occidentale de la baie : le fond étant encore de 20 brasses près du rivage, notre proximité de la côte ne nous faisait courir aucun danger. On mouilla une ancre à jet, et nous commençâmes à nous touer dessus ; nous étions au milieu de la baie lorsqu'il survint un coup de vent trop fort pour notre petite ancre, et il fallut en mouiller une seconde.
La Néva avait de même à combattre contre ces vents changeants, et lorsqu'elle vit nos efforts infructueux pour sortir de la baie, elle mouilla également, mais à une plus grande distance de la côte. Nous laissâmes tomber aussitôt une seconde ancre à jet, et, à 4 heures après midi, nous nous retrouvâmes au milieu de la baie. Le vent paraissant devenir plus favorable, je fis mettre toutes les voiles dehors, dans l'espérance de sortir avant la nuit. Mais le vent changea de nouveau, et nous obligea de laisser tomber l'ancre pour la troisième fois. On avait (184) travaillé sans relâche depuis 4 heures du matin ; et par une chaleur de 25 degrés. Je résolus donc de passer la nuit dans la baie, pour laisser reposer mon monde.
À 8 heures du soir, le vent souffla bon frais, et continua ainsi jusqu’au jour. Nous appareillâmes alors, et sortîmes de la baie dans la matinée. Mais le temps ne nous favorisa pas plus que la veille. Le vent souffla avec force, et accompagné d'une pluie abondante.
Ce mauvais temps m’ayant décidé à m'éloigner de terre le plus tôt possible, je fus contraint d'emmener le Français Joseph Cabri, qui était venu fort tard à bord, et ne s'était pas montré. Il paraissait plus content qu'attristé de cette aventure, et je pensai que son dessein avait été réellement de partir avec nous. Robarts fut, par ce moyen, délivré sans s'y être attendu de son mortel ennemi.
Avant de continuer la relation de mon voyage, je crois qu'il n'est pas inutile de donner sur les îles Washington, ainsi que sur les mœurs et usages de ses habitants, ce que m'en ont appris les deux Européens que j'ai rencontrés à Nuku Hiva.
CHAPITRE VIII
DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE DES ÎLES WASHINGTON
(* Pour les lecteurs familiers des îles Marquises, le début de cette description géographique est peut-être superflue. Jacques Iakopo Pelleau l’a néanmoins conservée car elle procure aux navigateurs, nombreux dans l’archipel, des notions de navigation intéressantes.)
Découverte des îles Washington. — Description de Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huna, Motuiti/Hatuiti, Eiao, Fatu-Huku - Ces îles et celles de Mendoza offrent peu de ressources aux navigateurs - Description de la côte méridionale de Nuku Hiva et de la baie Anna-Maria, ou Taiohae - Renseignements pour y entrer. - Saisons et climats – Vents et marées. - Observations astronomiques et nautiques au port d'Anna-Maria.
_________________
Le groupe des îles Washington a été découvert dans le mois de mai 1791, par Ingraham, capitaine du navire le Hope de Boston, dans sa traversée des Marquesas de Mendoza à la côte N. O. de l'Amérique. Il fut découvert de nouveau quelques semaines après par Marchand, capitaine du navire français le Solide, dont le voyage, rédigé par M. de Fleurieu, marin habile et savant, est un chef-d’œuvre. Marchand crut être le premier qui eût découvert ce groupe ; il aborda à une de ces îles, que les (186) officiers nommèrent de son nom « Île Marchand », et dont il prit possession au nom du gouvernement français. Il vit également et détermina la position des autres îles auxquelles on donna de même des noms : il n'aperçut pas l’île Ua Huna qui est la plus orientale ; il nomma tout le groupe ILES DE LA RÉVOLUTION.
L'année suivante, deux navigateurs de nations différentes les découvrirent encore, Hergest, lieutenant dans la marine anglaise, les vit au mois de mars 1792. Il commandait le Daedalus, vaisseau de transport, destiné à porter des provisions et autres objets au célèbre Vancouver pour la continuation de son voyage ; il les releva avec beaucoup d'exactitude, leur donna des noms et découvrit deux baies à la côte méridionale de Nuku Hiva : il entra avec sa chaloupe dans l'une d'elles et la nomma, Port-Anna-Maria. Vancouver nomma ensuite le groupe « Îles d'Hergest » en mémoire de son malheureux ami (5) qu'il regardait comme le premier qui les eût vues.
(5) Hergest a été massacré à Vahou (* Oahu), une des îles Sandwich, avec M. Gooch, astronome, qui allait joindre le capitaine Vancouver.
Quelques mois après Hergest, le capitaine Brown, commandant le navire anglais le Butterworth, passa entre ces îles sans cependant leur donner de nom, honneur qu'en (187) deux ans, elles avaient reçu quatre fois ; il toucha terre à Ua Huna dont il releva la côte occidentale.
Enfin, le dernier qui découvrit ce groupe fut Josiah Roberts, capitaine du navire américain le Jefferson. Il s'était arrêté pendant trois mois à Taoouatte (* Tahuata) d'où un natif de Ua Huna le conduisit dans cette île en février 1793. Robarts est probablement le premier qui ait donné à ce groupe le nom d'îles Washington, comme on le voit dans le voyage de M. de La Rochefoucauld en Amérique (6), où se trouve une relation succincte de cette découverte de Robarts.
(6) Voyage dans les Etats-Unis, par La Rochefoucaud-Lianeourt, tom. 2, p. 23. Les noms des îles y sont défigurés. Ua Huna, par exemple, est nommé Onhava.
Mais Ingraham avait donné ce nom à l’île Ua Huna : on ne sait s'il vient originairement d'Ingraham ou de Roberts. Quoiqu'il en soit, l'honneur de la première découverte de ces îles appartenant incontestablement aux Américains, de qui elles ont reçu le nom de Washington, il est juste de leur conserver. M. de Fleurieu lui-même rejette le nom de La Révolution donné par Marchand, sans cependant en assigner un autre, parce qu'il réunit ces îles avec le groupe situé au S. O. et qui porte le nom de Marquesas de Mendoza. La géographie gagne incontestablement à la suppression des noms trop multipliés sur les cartes. Mais le nom de Washington doit peut-être faire exception, et je l'ai conservé sur la carte de mon voyage.
Ces îles au nombre de huit sont au N. O. des Marquesas de Mendoza ; elles s'étendent de 9° 50’ à 7° 50’ de latitude méridionale, et de 139° 5’ 30’’ à 140° 13’ 00’’ de longitude occidentale. Comme leurs noms particuliers ne se trouvent pas sur quelques cartes, je rapporterai ceux qui leur ont été donnés à chacune par les navigateurs qui les ont découvertes.
1. Nuku Hiva (7) est la plus considérable du groupe.
(7) Pendant mon séjour dans cette île, je me suis donné beaucoup de peine pour connaitre son vrai nom et en bien saisir la prononciation pour l'écrire avec justesse. Je n'ai jamais entendu le son de l'r que Wilson a placé à la tête des noms de plusieurs îles.
Sa plus grande longueur de la pointe du S. E. à celle de l'O. est de 17 milles ; cependant je ne puis déterminer l'étendue de sa circonférence n'ayant point reconnu sa côte septentrionale. La direction de la pointe S E. à la pointe S. est E. N. E. et O. S. O. De la pointe du S., elle court N. O., et de la pointe S. E. directement au N. La pointe S. E., nommée Pointe Martin par Hergest, gît, d'après nos observations, par 8° 57’ de latitude méridionale (189) et 139° 32’ 30’’ de longitude occidentale. L'extrémité S. est par 8° 58’ 40 "S, et 139° 49’ 30’’ O. Enfin, celle du N. O. par 8° 53’ 30’’ S. et 139° 49’ 00’’ O. Ingraham nomma cette île Federal Island, Marchand île Baux, Hergest Sir Henri Martin's Island, et Roberts Adam's Island.
2. Ua Huna est la plus orientale de ce groupe. Son extrémité O., selon nos observations, gît par 8° 58 15" S., et 139° 13’ 00’’ O., au S. 87° E., à la distance de 18 milles de la Pointe-Martin de l'île, de Nuku Hiva. Sa direction est E. N. E. et O. S. O. Sa longueur entière est de 9 milles. Il y a sur la côte O. une baie que nous n'avons pas vue. Marchand n'a pas connu cette île. Ingraham l'a nommée île Washington, Hergest Riou's Island, et Roberts Massachusetts Island.
3. Ua Pou est la plus méridionale des îles Washington. Son extrémité N. se trouve directement au S. du Port-Anna-Maria à la distance de 24 milles, et, selon nos observations, par 9° 21’ 50" S. et 139° 39’ 00’’ O. Les officiers du Solide la nommèrent Île Marchand, Ingraham Adam's Island, et Robarts Jefferson's Island. Comme nous ne fîmes pas le tour de cette île, nous ne pûmes voir le rocher en pain de sucre que Marchand a nommé le Pic, et Wilson, six ans plus tard, Church (l'église) (190). Hergest le décrit comme ressemblant à une vieille église gothique. Nous ne pûmes voir non plus le rocher blanc que Marchand a nommé l'Obélisque, et qui est vraisemblablement ce que Wilson nomme sur sa carte Stack Island.
4. Au S. E. de la pointe S. de Ua Pou, à la distance d'un mille et demi, gît une petite île plate d'environ deux milles de tour, que Marchand nomme Île Plate, Ingraham Lincoln, Wilson Level et Roberts Resolution Island. Je ne pus connaître son nom propre. Elle git, suivant les observations de Marchand, par 9° 29’ 30" S. La passe entre cette petite île et Ua Pou paraît sûre, puisque Roberts l'a parcourue.
5. 6. Mottouaïty (* Hatuiti) est formé par deux petites îles inhabitées, situées E et O. l'une par rapport à l'autre, et séparées par un canal d'un mille de largeur. Elles sont au N. O. ¼ O à 30 milles de distance de la pointe septentrionale de Nuku Hiva. Les habitants des îles voisines y vont souvent pour pêcher : cependant la disette seule les oblige à entreprendre cette navigation, qui est dangereuse pour leurs chétives pirogues. La position de ces deux îles, que nous n'avons pas vues, est déterminée diversement par Marchand et par Hergest, quoiqu'ils ne diffèrent que de quelques minutes pour la latitude ; mais ayant trouvé la longitude assignée par Hergest à Nuku Hiva, d'accord avec la nôtre que nous (191) avons dérivée d'une série d'observations de distances lunaires, je donne la préférence à ses déterminations. Les Hatuiti sont situés, d'après lui, par 8° 37’ 30" S. et 140° 20’ 00" O. Ingraham avait nommé ces îles Franklin Island et Roberts Blake Island. À la distance où ils les ont vues, ils les ont prises pour une seule île. Les habitants de Nuku Hiva les désignent par un seul nom (8).
(8) L'Anglais Robarts me pria plusieurs fois de déporter sur une de ces îles son ennemi Joseph Cabri.
7. 8. Hiaou (* Désormais Eiao) et Fattouhou (* Désormais Hatutu/Hatutaa), deux îles inhabitées : la première a 8 milles de longueur sur 2 de largeur. Son extrémité méridionale est par 7° 59’ S. et 140° 13’ O., d'après les observations d'Hergest et de l'astronome Gooch ; ils y débarquèrent et trouvèrent des cocotiers en abondance. Le milieu de Hatutaa, qui est beaucoup plus petite et ronde, est par 7° 50’ S. et 140° 06’ O. Ces deux îles sont au N. N. O. à 60 milles de distance de l'extrémité occidentale de Nuku Hiva ; elles sont visitées par les habitants des îles voisines qui vont y chercher des cocos ; Ingraham les nomma Knox and Hancock Islands, Marchand île Masse et île Chanal, Roberts Freemantle Island et Langdon Island, Hergest Roberts’s Islands.
Nuku Hiva, la plus grande et la plus fertile (192) de ces îles, était si dépourvue de provisions du règne animal, que nous ne pûmes nous y en procurer. Je crois devoir conseiller aux navigateurs qui feraient route dans cette partie de l'Océan, de n'aborder à aucune de ces îles non plus qu'aux Mendocines (* Les îles du groupe sud, du nom de Mendoza). Cook, qui a le premier, dans les temps modernes, touché à cet archipel, n'y trouva qu'une quantité de cochons très petite, relativement à celle dont il avait besoin pour son équipage ; et Marchand, dix-sept ans après, en trouva encore moins.
L'impossibilité d'obtenir des cochons en quantité suffisante ne vient pas tant du manque de ces animaux, quoiqu’ils soient moins communs qu'aux îles de Sandwich et de la Société, que de la répugnance des insulaires à s'en défaire. C'est un usage parmi eux de célébrer, en mémoire de leurs parents, de leurs chefs et de leurs prêtres défunts, des fêtes dans lesquelles la chair des cochons est le mets principal et en même temps le plus délicat du festin. J'ai rapporté plus haut comment le roi de Hakauì, après avoir conclu plusieurs fois le marché de son cochon, ne put se résoudre à s'en défaire. Il en possédait cependant plusieurs, car nous en comptâmes un grand nombre dans sa vallée.
Les végétaux mêmes ne sont pas en quantité suffisante. Nous n'eûmes que ce qu'il nous fallait de cocos pour notre consommation journalière. Il y a peu de (195) bananes et de fruits à pain, du moins au Port Anna-Maria. Nous avons acheté plus de bananes au Port Tchitchagoff ; mais on ne nous y offrit pas un seul fruit à pain.
Après une traversée de trois mois au moins depuis le Brésil en doublant le Cap Horn, le navigateur ne doit donc pas s'attendre à trouver ici un ravitaillement suffisant pour mettre son équipage en état de continuer le voyage jusqu'en Amérique ou au Kamtchatka ; il est même assez douteux qu'il puisse s'y procurer des vivres frais pour sa consommation journalière pendant son séjour.
Les seules choses sur lesquelles on peut compter sont l'eau et le bois, encore a-t-on besoin du secours des insulaires à cause de la violence du ressac le long de la côte ; les Naturels le traversent à la nage avec une agilité qu'un Européen admire sans pouvoir l'imiter. Mais ce travail n'est pas seulement difficile, il peut même devenir très dangereux ; car une insurrection des insulaires couperait toute communication avec le bâtiment aux hommes qui seraient à terre, et ces insurrections sont toujours à craindre, car le moindre malentendu suffit pour les exciter, ainsi que nous en avons fait l'expérience. Je pense donc que les vaisseaux qui vont au Kamtchatka en doublant le Cap Horn, feraient beaucoup mieux d'aller du Brésil directement (194) aux îles de la Société ou aux îles des Amis (* Tonga). Ils pourraient s'y approvisionner de vivres frais pour six ou huit semaines au moins.
La route qui est plus directe fournirait l'occasion de déterminer plus exactement la position de quelques îles ; par exemple, de celles qui appartiennent aux groupes Fidji, Babaco, Hapae et Vavao : ils pourraient même en découvrir de nouvelles. Quant aux vaisseaux destinés pour la côte nord-ouest de l'Amérique ou pour l’ile Kodiak, il leur serait plus avantageux d'entrer dans quelque port du Chili, où ils trouveraient des vivres en abondance, notamment du froment, objet très précieux pour Kodiak et les colonies russes de la côte de l'Amérique. La route du Chili à Kodiak n’est pas trop longue mais si l’on jugeait convenable de s'arrêter à quelque endroit, les îles Sandwich offrent une station qui n’occasionne aucun détour.
Quoique les îles Washington présentent très peu de ressources aux navigateurs pours les vivres, je crois cependant devoir décrire la baie Taiohae et la côte méridionale de Nuku Hiva, que nous avons relevées avec soin.
Cette côte n'est qu’une suite de rochers hauts et hachés, extrêmement escarpés du côté du rivage, et d’où se précipitent de très-belles cascades : celle de l'extrémité méridionale de l’île se distingue plus particulièrement ; il est (195) difficile d'en voir une plus magnifique. Le lit de cette cascade paraît large de plusieurs toises, et l'eau tombe d'une hauteur de 2000 pieds. MM. Tilésius et Langsdorff l'ont examinée : elle donne naissance à la rivière qui a son embouchure dans le port Tchitchagoff (* Hakauì). Cette chaîne de rochers est liée à plusieurs hautes montagnes, la plupart nues, qui se prolongent dans l'intérieur de l’île. Mais au nord-ouest de la pointe méridionale, la côte est plus basse, plus unie, et le terrain s'élève insensiblement vers l'intérieur. Nous n'approchâmes pas assez de ce côté pour y distinguer des coupures qui, je crois, doivent s'y trouver, quoique Hergest décrive toute la côte de l'ouest comme une masse continue de rochers sans une seule anse.
L'Anglais Robarts nous parla souvent d’une, vallée située de ce côté de l’île, et si bien peuplée qu'elle peut fournir 1200 guerriers. Mais comme il n'y était jamais allé, il ignorait si, à l'extrémité de cette vallée, dont le nom est Hotty-Chevé (* Cela ressemble à Hatiheù mais la localisation ne correspond pas, cette baie étant plein nord.), il y avait une baie où les vaisseaux pussent mouiller avec sûreté. Sur la côte orientale, près de la pointe du nord, on trouve une baie où la Néva fit, pour la première fois, connaissance avec les Nukuhiviens.
La côte méridionale offre trois ports dans lesquels le mouillage est très sûr. Ce sont : la Baie Hooumi, qu'Hergest nomme Comptroller's bay (196), le Port Anna-Maria et le Port Tchitchagoff. Entre ces deux derniers ports se trouvent plusieurs petits enfoncements qui ne peuvent être d'aucune utilité, parce qu'ils sont ouverts aux vents et pleins de rochers. J'ai déjà décrit suffisamment le Port Tchitchagoff. Quant à Comptroller’s bay, nous ne l'avons vu qu'en passant, sans pouvoir l'examiner ; je me borne donc au Port Anna-Maria. Le plan que j'en donne suffit pour diriger ceux qui voudraient y entrer : cependant quelques observations en compléteront la connaissance.

La carte de la baie de Taiohae dessinée par un géographe lors du séjour de 10 jours des Russes en 1804. La légende est en allemand.
Aussitôt qu'en arrivant de l'E, on a connaissance de Nuku Hiva, la pointe Martin est la première qui se présente ; son aspect est si remarquable qu'on ne peut la confondre avec aucune autre pointe de l’île. Un de ses côtés forme la côte orientale de Comptroller’s bay. La pointe s'avance beaucoup et offre un amas de rochers escarpés et brisés qui semblent avoir éprouvé une grande révolution. On peut s'en approcher sans crainte, ainsi que de toute la côte méridionale jusqu'à un mille anglais de distance, le fond étant, jusqu'à cette distance, de 59 à 55 brasses, de sable fin.
On voit bientôt un rocher noir, éloigné d'environ un quart de mille de la pointe Martin et qu'on laisse à droite (* Teohotekea). Comptroller’s bay se présente alors dans la direction du N. au S. et, un peu à l’O., on (197) découvre une autre baie plus petite. Dès qu'on est vis à vis de son ouverture, on s’avance jusqu'à 5 ou 6 milles à peu près parallèlement à la côte qui court E. N. E. et O. S. O. ; alors on aperçoit la petite île Mataùapuna, éloignée de 30 toises au plus de la pointe orientale de l'entrée. Aussitôt que l’on voit cette petite passe, il faut gouverner directement sur l’île et la doubler à 100 ou 150 toises de distance ; alors on voit bien ouvert le Port Anna-Maria. Une autre petite île, de la grandeur de Mataùapuna, est située à la côte occidentale de l’entrée, dont elle n'est également séparée que par un canal de 30 toises de largeur praticable seulement pour des pirogues. Cet îlot nommé Motunui (9), est reconnaissable par un rocher situé à 10 ou 15 toises de distance.
(9) Ce mot signifie « Grande île ».
Mataùapuna et Motunui forment ainsi l'entrée du port d'Anna-Maria. Il faut éviter en entrant ou en sortant, de ranger de trop près ce dernier îlot et en général la côte occidentale, parce qu'un vent d'E., quelque faible qu'il soit, joint à un courant assez fort, peuvent faire courir des dangers. (198)
S'il souffle un vent frais dans la baie, on peut y entrer en sûreté, et s'approcher jusqu'à 50 toises de chacune des côtes, et· même plus de la côte orientale, car rien n'y peut causer le moindre danger ; mais si le vent est faible ou variable, ce qui est ordinaire dans cette baie entourée de hautes montages, on· ne peut pas espérer de profiter des variations du vent, car il saute à chaque instant d’un point à l’autre, par des rafales violentes, puis· s'apaise complétement : il faut se touer. Quoique· pénible et fatigante, à cause de la chaleur brûlante, cette manière d'entrer et de sortir est cependant la seule qui soit sûre.
À 3 quarts de mille environ du rivage septentrional, la baie s'élargit dans la direction E. et O. On s'approche, jusqu'à un quart de mille d'une colline très-saillante a la côte orientale ; c'est le seul endroit où l'on puisse débarquer et le moins incommode. On y laisse tomber ses ancres par 14 ou 15 brasses, en les plaçant dans une direction E. et O. On y est à un demi-mille à peu près d'un ruisseau où l'on peut se procurer de l'eau. Il faut préférer la côte orientale à l'occidentale, parce que l'on y est moins exposé à l'action du courant. Pendant les 10 jours que nous y sommes restés mouillés, nos câbles n'ont pas été une seule fois dérangés, tandis que ceux de la Néva, mouillés à la côte (199) occidentale, avaient tous les jours besoin d'être remis en ordre.
Les îles Washington doivent éprouver une chaleur pareille à celle des Marquesas de Mendoza dont elles sont si proches. On voit, dans le Voyage de Marchand, qu'au port Madre de Dios de l’île Santa-Christina, le thermomètre se tenait, au mois de juin, à 27 degrés. La hauteur du nôtre, pendant notre séjour dans le Port Anna-Maria, a été jusqu'à 25 degrés mais ordinairement il restait à 25 et 24. À terre, il pouvait bien monter à 2 degrés de plus.
Malgré cette chaleur, le climat est très sain. Les deux Européens que nous avons trouvés ici, assurèrent qu'on ne pourrait s'en figurer un meilleur, et l'air de santé des habitants confirmait cette assertion. L'hiver y est comme dans toutes les contrées situées entre les tropiques, c’est la saison des pluies ; mais on dit qu'elles n'y sont fréquentes ni continues Il s'écoule quelquefois 10 mois sans qu'il en tombe une goutte : c’est un grand malheur. Cette sécheresse occasionne une famine générale dont les suites sont horribles, les habitants de livrant alors à des abominations dont aucun autre peuple sur la terre ne fournit d'exemple.
Les vents dominants dans ces iles sont les vents alizés du S. E. inclinant un peu à l'E. et au S. ; cependant les vents du S. O. y soufflent aussi (200) et même avec assez de continuité (10).
(10) Les insulaires ont pour chacun de ces vents des noms particuliers.
Les insulaires en profitent pour faire des visites à leurs voisins du S. E. Au Port Anna Maria, les brises de terre et de mer alternent, il est vrai, le jour et la nuit, mais sans beaucoup de régularité. Elles sont d'ailleurs toujours très faibles, si l'on en excepte quelques rafales assez violentes qui viennent des montagnes, et s'échappent par les vallées qui les séparent. J'ai déjà dit, dans le chapitre précédent, que nous n'avions pu établir à terre aucun instrument astronomique.
Les observations que fit M. Horner le jour de notre arrivée et celui de notre départ déterminèrent une nouvelle marche de nos chronomètres. Le 28 mai, le nº 128 retardait, sur le temps moyen de Greenwich, de 7 heures 51’ 24". Retard journalier : -21’ 3’’. Le n° 1856 retardait, sur le temps moyen de Greenwich, de 10 heures 15’ 08". Avance journalière : + 24’ 50’’. Comme le petit chronomètre de Pennington était devenu entièrement inutile, le capitaine Lisianski me donna un box time keeper du même auteur. (201)
La marche journalière de cette montre, qui, au 18 mai, retardait, sur le temps moyen de Greenwich, de 1 h. 49’ 09", était de -16’ 40’’.
La latitude de l'entrée du Port Anna-Maria entre les îles Mataùa et Motunui est de 8° 56’ 32’’ S.
La latitude de l'aiguade, sur la côte septentrionale : 8° 54’ 56" S.
La longitude du Port Anna-Maria, déduite de 42 séries de distances lunaires, faites tant par le docteur Horner que par moi, du 29 avril au 4 mai, et depuis le 4 mai jusqu'au 7 à midi, c'est à dire jusqu'à notre entrée dans la baie, fut trouvée au moyen du chronomètre n° 128 (en ayant égard à la nouvelle détermination de sa marche), de 139° 39’ 45’’ O. (11).
(11) Cette estimation de la longitude du Port Anna-Maria coïncide à une minute près avec celle du lieutenant Hergest et de l'astronome Gooch, mais diffère de près d'un demi-degré à l'E. de celle de Marchand.
La longitude, d'après la montre d'Arnold, n° 128, réglée à Sainte Catherine : 140° 42’ 30’’.
D'après la montre d'Arnold, n° 1856, suivant sa marche à Ste-Catherine, avançant de 2º depuis le Cap Horn : 141° 29' 30’’ !
(202) La déclinaison était de 4° 36’ 30’’ à l'E., calculée sur une moyenne entre plusieurs observations, du 7 au 18 mai, aux environs de la baie. La violence du ressac nous empêcha de faire des observations exactes sur les marées : on peut cependant affirmer qu'elles ont lieu régulièrement toutes les 6 heures. Le flux vient de l’E. à la nouvelle lune et à la pleine lune, sa plus grande hauteur est entre 4 et 5 heures. Il est difficile de déterminer avec certitude sa plus grande élévation ; mais certainement elle ne passe pas 3 pieds.
CHAPITRE IX.
HABITANTS DE Nuku Hiva
Habitants – Beauté des femmes – Leur santé excellente - Les Femmes – Tatouage - Habits et ornements des deux sexes — Habitations – Sociétés secrètes - Outils et meubles - Aliments et cuisine – Pêche - Pirogues – Agriculture – Occupations des hommes et des femmes - Forme du gouvernement – Mœurs - Art militaire - Armistices - Religion et funérailles – Tabou - Magie - L'Anglais Robarts — Musique — Population — Remarques générales sur les Naturels de ce groupe d'îles.
Quoique les Naturels des îles Sandwich et Washington soient les seuls insulaires du grand Océan que j'aie vus, je crois cependant pouvoir affirmer qu'aucun de ces peuples ne surpasse ces derniers en beauté. D'après les descriptions que Cook a données des autres archipels de cette mer, leurs habitants ne peuvent soutenir à cet égard la comparaison avec ceux des îles Marquises de Mendoza (* les 3 îles du groupe sud-est), et Forster partage cette opinion.
Cette beauté du corps n'est pas non plus comme dans les autres îles (204) un privilège réservé par la nature aux erihs (* ariki/arii, les chefs) ou personnes de la classe supérieure, elle est ici à peu près et sans exception accordée à chacun. L'égalité, plus grande dans le partage des propriétés peut en être la cause. Le Nukuhivien peu éclairé ne voit pas encore dans la personne de son roi le despote auquel il doit sacrifier toutes ses facultés, sans oser penser à se conserver lui-même ou sa famille. Le petit nombre de ses supérieurs, qui ne se composent que des parents du roi et leur peu d’autorité, lui laissent plus de liberté pour son travail et lui garantissent la libre possession de la terre, de sorte que chacun en a une part à très-peu d'exceptions près. Le Nukuhivien (12) est en général de haute taille, très bien fait et robuste.
(12) Je ne parle ici que des habitants de Nuku Hiva, n’ayant visité aucune autre île de ce groupe, mais je crois qu’on peut appliquer le portrait que j’en fais à tout le groupe, et même aux habitants des Marquises de Mendoza, avec lesquels ils ont tant de ressemblance par le langage, la forme du gouvernement, les mœurs et les usages.
Il a le cou long et d'une belle forme, les traits du visage extrêmement réguliers, un air de bonté qui ne se dément pas lorsqu'on le fréquente ; mais le préjugé favorable qu'on pourrait en concevoir est (205) bientôt dissipé lorsqu'on sait de quelles horreurs ces beaux hommes sont capables : on ne voit plus alors dans leur belle physionomie qu'une indifférence apathique. Leurs yeux n'ont point de feu.
Le tatouage et l'huile dont le corps du Nukuhivien est couvert font paraître sa peau noirâtre ; mais dans son état naturel, elle est blanche comme on le voit chez les enfants et chez les femmes qui ne sont point tatoués. Elle ne cède pas même à celle des Européens si ce n'est peut-être par une petite teinte jaunâtre.
On ne voit parmi ces insulaires aucun individu contrefait ou atteint de défauts corporels ; on n'aperçoit sur leur corps nulle apparence d'ulcère ou d'éruption cutanée. Ils doivent sans doute cet avantage à leur sobriété. Ils connaissent à peine le kava, boisson si générale dans toutes les îles de ces mers, et dont l’usage immodéré est si nuisible et déforme souvent le corps ; si quelqu'un en use à Nuku Hiva, ce qui est très rare, c’est au moins avec la plus grande modération ; enfin, les Nukuhiviens jouissent généralement d'une santé que rien n'altère. Ils ont eu aussi jusqu'à présent le bonheur d'être exempts de la maladie vénérienne. Comme ils ne connaissent, ils n'ont pas non plus de médecins.
La frayeur du kaha, espèce de sortilège qui rend malade et dont je parlerai plus (206) amplement, peut bien, par l'effet de l'imagination, transformer chez eux un malaise en maladie ; mais comme cette prétendue infirmité se dissipe par la levée du sortilège ; on ne peut l'appeler une maladie réelle. Tout l'art de guérir de ces insulaires se borne en conséquence au traitement des blessures, à quoi le roi est, dit-on, d'une habileté remarquable.
Parmi les beaux hommes, j'en ai vu deux qui excitèrent particulièrement notre admiration : l'un, habitant de Taiohae, était un grand guerrier et en même temps l'allumeur du feu du roi (13).
(13) J'aurai dans la suite occasion de dire en quoi consiste cette charge.
Il se nommait Maou-ha-ou (* difficile de deviner qui c’était, même en comparant avec les noms connus de l’époque) : c'était peut-être un des plus beaux hommes qu'il soit possible de voir. Sa taille était de six pieds deux pouces ; toutes les parties de son corps étaient d'une proportion parfaite. L’autre nommé Pautini, roi de la vallée Hakauì, malgré son âge de cinquante ans, était encore un homme superbe.
Les femmes sont en général très belles ; leur tête surtout est admirable, elles l'ont bien proportionnée ; le visage plutôt rond qu'ovale, de grands yeux brillants, le teint fleuri, de très belles dents, les cheveux bouclés naturellement ; elles les lient avec beaucoup de goût (207) par un ruban blanc qui leur sied à merveille ; enfin la teinte claire de leur peau leur donne peut-être quelque supériorité sur les femmes des archipels de Sandwich (* Hawaii), de la Société (* Tahiti) et des Amis (* Tonga) (14).
(14) Nous en vîmes surtout plusieurs dans la vallée Hakauì, qui étaient fort jolies, et se paraient avec plus de goût que leurs voisines de Taiohae.
Toutefois, un œil impartial pourrait remarquer, chez ces femmes, des défauts que les compagnons de Mendaña et de Marchand n'ont pas aperçus ou n’ont pas voulu voir. Leur taille par exemple n'est rien moins que belle, elles sont petites et se tiennent mal, même les jeunes filles de dix-huit ans : aussi leur démarche est-elle mal assurée et comme traînante ; elles ont le bas de la taille trop gros.
Leurs idées de beauté doivent être fort différentes des nôtres ; car autrement elles prendraient plus de peine à cacher ces défauts. Un morceau d'étoffe de grandeur médiocre, dans laquelle elles s'enveloppent fort négligemment, couvre assez mal leurs beautés et leurs imperfections. Ce n'est pas de la Nukuhivienne que l'on pourra dire avec Thomson : « …when unadorned, is then adorned the most. » (15)
(15) « (elle) n'est jamais mieux parée que lorsqu'elle ne l'est pas. »
(208) On chercherait en vain chez elles cette expression douce et aimable qui brille, dit-on, dans les yeux des Tahitiennes et des compatriotes d'Ouaïni (16).
(16) C'est le nom d'une jeune fille des îles Sandwich. Madame Berclay, qui accompagnait son mari dans son voyage à la côte nord-ouest d'Amérique, avait pris Ouaïni avec elle, avec le dessein de l'emmener en Europe ; mais elle la laissa à la Chine. Le capitaine Meares l'embarqua pour la reconduire dans sa patrie, elle mourut dans la traversée. On voit le portrait de cette jolie sauvage dans le voyage de Meares, page 27 de l'édition originale.
Elles montrent en revanche une effronterie (car le mot coquetterie serait trop modéré) qui, pour des hommes doués de quelque délicatesse, détruit le peu de charmes qu'elles possèdent.
Parvenus à l'âge viril, les Nukuhiviens se tatouent tout le corps avec une perfection qui, nulle part, n'est portée à un si haut degré. C'est une vraie peinture composée de diverses figures : ils les tracent au moyen de légères piqûres qu'ils font à la peau jusqu'à ce qu'elle saigne, et ils la frottent ensuite avec de la couleur : ordinairement on choisit le noir, qui se change graduellement en bleu foncé. Le roi, le père du roi et le grand-prêtre sont les seuls que nous ayons vus tatoués de la tête aux pieds. Toutes les parties de leur corps, (209) le visage, les yeux et même quelques endroits de la tête dont les cheveux avaient été rasés, étaient ornés de cette manière.
Cet usage ne règne ni aux îles de la Société ni à celles des Amis. Dans ce dernier archipel, les rois ne sont pas du tout tatoués ; et, suivant le capitaine King, les habitants des îles Sandwich et de la Nouvelle-Zélande sont les seuls qui se tatouent aussi le visage : on trouve quelque conformité entre la manière de tatouer de ceux-ci et celle des Nukuhiviens.
Ils ne se bornent pas à tracer isolément des figures d'animaux ou d'autres en lignes droites, comme on fait aux îles Sandwich ; mais ils peignent avec une symétrie parfaite des ornements formés d'anneaux concentriques et bien liés entre eux, et tracent par-dessus des bandes qui embellissent réellement les formes du corps. Les femmes ne sont tatouées qu'aux mains, aux bras, au lobe de l'oreille et des lèvres. Les gens de la classe inférieure sont beaucoup moins tatoués et plusieurs même ne le sont pas du tout. Il paraît donc que, cet ornement n'appartient qu'aux personnes distinguées.
Des artistes se vouent à la profession de cet art. L’un d'eux avait établi son atelier sur le vaisseau où il ne manquait pas d'occupation, la plupart de nos matelots voulant être tatoués.
Les hommes ne sont pas circoncis, cependant (210) quelques-uns avaient le prépuce fendu dans sa longueur : opération qui se fait avec un instrument tranchant (* superincision du prépuce et non circoncision). Au reste, les Nukuhiviens ainsi que les habitants de Santa-Christina, ont le prépuce noué avec un cordon. Il ne me paraît pas probable, comme le soupçonne M. de Fleurieu, que ce soit pour se garantir des insectes ou par un raffinement de sensualité. En considérant les idées contradictoires de décence qui règnent parmi les hommes, ne pourrait-on pas conjecturer que toute la pudeur des Nukuhiviens consiste à cacher aux yeux de l'autre sexe ce que la nature a voulu couvrir ? Au moins avons-nous vu la modestie des belles, qui nageaient autour de notre vaisseau, fort choquée, lorsque le besoin accidentel d'un matelot offrait à leurs yeux un objet qui offensait leurs yeux. Robarts confirma aussi ma conjecture, en m'assurant que les Nukuhiviennes étaient inexorables contre celui qui n'observait pas cette règle de décence.
Les hommes vont généralement nus, sans en excepter même le roi ; car un morceau étroit d'étoffe grossière d'écorce de mûrier dont les hanches sont entourées, ne peut passer pour un vêtement. Les Nukuhiviens ont deux mots pour désigner ce pagne-ceinture : celle qui est en étoffe fine se nomme eatou (* ?), en étoffe (211) plus grosse hiapo. Tous ne portent pas cette ce pagne. Le beau Maou-ha-hou affectait d'aller entièrement nu. Je lui donnai par deux fois un pagne-ceinture ; il ne l'avait pas quand il revint ensuite à bord.
Ils doivent aussi faire usage de nattes. Le gendre du roi en portait toujours une lorsqu'il venait à bord, mais il était le seul. Cette natte était fort grossière, il la mettait sur ses épaules et la nouait sous le menton, de sorte qu'elle ne lui couvrait que le dos (* C’est cette natte en forme de cape que les Marquisiens nommaient kahu, mot devenu désormais générique pour désigner n’importe quel vêtement.)
Ni les principaux habitants ni le roi n'ont d'habits de cérémonie, ce qui est dû plutôt à leur pauvreté qu'à leur forme de gouvernement républicaine ; car Cook a vu le roi de l’île Santa-Christina en habit de parade.
Les Nukuhiviens ont différentes espèces de parures ; mais il paraît qu'elles ne sont pas un privilège de la grandeur, car je n'en ai vu de particulières ni au roi, ni à aucun de ses parents. Le gendre du roi portait seul dans sa barbe une dent de cochon, ou quelque chose de semblable.
Les ornements des Nukuhiviens sont presque les mêmes que Forster a trouvés chez des habitants des îles Mendocines (* Les Marquises du sud). Les dents de cochon et les haricots rouges en forment la principale partie. Forster ayant donné la description et les dessins de la plupart de ces colifichets, je ne les indiquerai que succinctement.
L'ornement de la tête est un (212) grand casque de plumes de coq noires (* le taavaha, composé de 500 plumes caudales de coq), ou une sorte de diadème, ou de tresse de fibres de cocos garnie de nacre de perles, ou simplement une branche de bois flexible d'où pend une rangée de cordons.
Plusieurs insulaires avaient de grandes feuilles fichées dans leurs cheveux ; leurs pendants d'oreilles sont de grosses coquilles rondes, remplies d'une substance dure et sablonneuse ; elles sont traversées par une dent de cochon percée qu'ils fichent dans le lobe de l'oreille : une cheville de bois, passée dans le trou de la dent de cochon, l'empêche de tomber (* le haakai).
Ils prennent surtout grand soin de la parure de leur cou. Ils ont une sorte de collerette, en forme de demi-lune, faite d'un bois tendre, et sur laquelle sont collées plusieurs rangées de haricots rouges. Mais cette parure est réservée aux prêtres.
Les autres insulaires en portent une espèce singulière : elle consiste en un rang de dents de cochon, attachées à une tresse de fibres de cocos. Ils portent aussi de ces dents isolées au cou ou dans la barbe, ou bien des boules, de la grosseur d'une pomme, entièrement couvertes de haricots rouges.
Ils se rasent la barbe, en laissant une petite touffe au menton. Leur tête est également rasée, à l'exception de deux mèches de cheveux de chaque côté, qu'ils nouent et (213) relèvent en forme de cornes. Plusieurs insulaires, surtout dans la classe inférieure, ne coupent pas leurs cheveux, qui sont crépus et laineux, sans pourtant l'être autant que ceux des nègres.
L'habillement des femmes consiste en un pagne-ceinture qu'elles passent, comme les hommes, entre les cuisses, et un morceau d'étoffe qui, ainsi que je l'ai dit plus haut, les couvre fort peu, et descend jusqu'aux mollets ; lorsqu'elles venaient au vaisseau en nageant, elles se débarrassaient même de leur hiapo. Elles se frottent tous les jours le corps d'huile de coco, ce qui lui donne beaucoup de lustre, mais aussi une odeur désagréable. Je ne puis décider si cet usage a pour but, comme le tatouage des hommes, de protéger la peau contre l'ardeur du soleil ou contre les insectes : je le crois pourtant. Je ne leur ai jamais vu de colliers ; la plupart ont des éventails en forme de losange ou de demi-cercle : ils sont faits de chaumes, très-habilement tissés, et teints en blanc avec la chaux de coquillage (* Si elles ont des éventails, ce sont forcément des femmes de la classe supérieure). Leurs cheveux noirs, bien imprégnés d'huile, sont noués en touffes bien serrées contre la tête.
Les maisons sont longues et étroites, construites avec des bambous et des troncs d'un arbre nommé faou (* fau/hau, l‘hibiscus des mers, hibiscus tiliaceus), entrelacés de feuilles de (214) cocotier et de fougère ; le mur de derrière est plus élevé que celui de devant, de sorte que le toit ne tombe que d'un côté : il a un demi-pied d’épaisseur ; on le couvre de feuilles sèches d'arbre à pain. L'intérieur de la maison est divisé, en deux parties, par une poutre posée à terre dans toute la longueur du bâtiment ; la partie antérieure est pavée, l'autre est couverte de nattes, qui servent de lits à toute la famille et aux domestiques, sans distinction de sexe. Une petite séparation, pratiquée à l'un des bouts, sert à serrer les meubles les plus précieux. Leurs calebasses, leurs armes, leurs haches, leurs tambours, etc. sont suspendus au toit et aux parois.
La porte, haute d'environ trois pieds, est placée au milieu du bâtiment : la famille a coutume de s'asseoir, en cercle, à l'entour. À une distance de 20 à 25 toises de cette maison, il y en a une autre dont la distribution intérieure est la même ; mais elle est élevée d'un pied et demi à deux pieds de plus au-dessus du sol. Devant toute la longueur de ce bâtiment règne une plate-forme, large de 10 à 12 pieds, pavée en grandes pierres : il sert de salle à manger. Cependant c'est une prérogative du roi, de ses parents, des prêtres et de quelques guerriers distingués d'en construire un semblable, car il suppose une certaine richesse (215), le propriétaire étant tenu d'avoir toujours un grand nombre de convives, qui forment une société particulière, et qu'il doit mourir même dans le temps de la plus grande disette.


Le « carré » auquel Krusenstern fait allusion ci-après est en fait un trapèze qui se nomme « paìuma » ; il est symbole de courage et apporte la protection.
Les deux portraits ont été réalisés en 1804 ; celui de Kiatonui est de Löwenstern ; l’autre, de Langsdorff. (Huukena, Op. Cit. p. 203)
Les membres de ce club se reconnaissent à différentes marques tatouées sur leur corps. Ceux du club du roi, par exemple, au nombre de vingt-six, ont sur la poitrine un carré long de six pouces et large de quatre. Robarts en faisait partie. La marque des compagnons de Joseph Cabri était un œil, etc., etc.

Portrait de Joseph Cabri par Orlowski d’après Tilésius ; Langsdorff, 1804
Robarts m'assura qu'il ne serait jamais entré dans cette société, si la faim ne l'y eût forcé. Sa répugnance me paraissait cependant impliquer contradiction ; puisque non-seulement tous ceux qui composent une pareille société sont libres de toute inquiétude pour leur nourriture, mais que, de son aveu même, les insulaires regardent comme un honneur d'y être admis.
Je soupçonnai donc que cette distinction entraîne la perte d'une partie de la liberté. Il est en effet difficile de supposer qu'un peuple si peu vertueux pratique à un si haut degré l'amour du prochain et l'hospitalité, sans en attendre quelque dédommagement. Le roi nous donna souvent des preuves de son caractère peu généreux, ou, pour mieux dire, avare. Jamais aucune de ses actions ne me mit à même de lui supposer le moindre sentiment de reconnaissance (216) ou de bienveillance (17).
(17) À chaque visite que le roi nous faisait, je l'ai comblé de présents, de peu de valeur en eux-mêmes, il est vrai, mais de grand prix pour un Nukuhivien. Cependant il ne m'a jamais offert même un coco en don ; et lorsqu'après le malentendu, dont j’ai parlé, et qui faillit à causer une insurrection, il vint à bord avec une plante de poivrier (* le kava, piper methysticum) qu'il me présenta en signe de paix, il me le fit qu'avec un air très-marqué de regret, au point qu'une demi-heure après, il me pria de la lui rendre, puisque je n'en faisais aucun usage.

Dessin de Löwenstern montrant Kiatonui apportant son pied de kava à Krusenstern, 1804
On ne doit certainement pas attendre d'un sauvage qu'il nourrisse continuellement une quantité d'hommes sans en recevoir quelque dédommagement : or, avec des hommes qui n'ont aucune propriété, ce dédommagement ne peut guère consister que dans une renonciation entière ou partielle à leur indépendance. C'est là en effet la marche ordinaire des rapports politiques des hommes entre eux. Le despotisme arrive à pas lents. Dans quelques années le roi de Nuku Hiva, qui n'est encore que le plus riche citoyen d'une république de sauvages, et qui n'a aucun pouvoir sur le plus pauvre habitant, si l'on excepte les membres de sa société, sera peut-être un despote aussi absolu que le roi d'Ovaïhi (*Hawaii).
Les femmes n'assistent jamais aux repas des sociétés. La maison même où le banquet a lieu est toujours tabou pour elles : elles ont cependant (217) la faculté de manger avec les hommes ; mais il faut que ce soit dans leurs maisons. La viande de porc ne leur est pas non plus défendue ; toutefois on leur en donne bien rarement (18), car, Robarts m'assura qu'il était le seul qui ne refusait pas cette friandise à sa femme.
(18) Presque dans toutes les îles de cette mer, l'un et l'autre sont défendus aux femmes.
À dix ou quinze pas des maisons, on voit plusieurs trous revêtus de pierres et recouverts de branches et de feuillages, dans lesquels les insulaires gardent leurs provisions, qui consistent principalement en poissons secs et en pudding aigre. C'est une sorte de pâte composée de fruit à pain et de racines de taro : elle se conserve plusieurs mois dans ces espèces de caveaux (* le « ma »).
La cuisine des Nukuhiviens est fort simple. Indépendamment de la viande de porc, que, selon le récit de Robarts, ils cuisent à la manière des Tahitiens, ils font leur principale nourriture du pudding aigre, qui n'a pas mauvais goût, et qu'on pourrait comparer à une tarte aux pommes très sucrée (* la popoi) ; ils mangent aussi des ignames, des taros, des bananes et des cannes à sucre. Leurs mets sont cuits sur des feuilles de bananes, qui leur servent aussi de plats. Quant aux poissons, ils les mangent (218) en général crus, trempés seulement dans l'eau salée (* les citronniers ont été importés bien plus tard).
Leur manière de prendre leur repas n'est rien moins qu'appétissante. Ils prennent le pudding avec les doigts et le portent avidement à la bouche. C'est ainsi du moins que j'ai vu manger le roi : mais je dois ajouter qu'il se lavait les mains aussitôt après le repas.
Leurs outils sont extrêmement simples. Une pierre, taillée en pointe aiguë, leur sert à percer des trous : leur hache est faite avec une pierre noire plate ; ils n'en font usage qu'à défaut de haches européennes. Le moindre morceau de fer qu'ils recevaient de nous était aussitôt passé sur une pierre jusqu'à ce qu'il eût acquis le tranchant convenable, et ensuite lié fortement à un manche de bois pour servir de hache. J'ai pourtant vu employer la hache de pierre à la construction d'une pirogue à pêcher.
Leurs meubles sont des écales de coco (* noix évidées), des courges creusées ou calebasses, de grandes écuelles, couvertes en forme de coquilles, faites d'un bois brun aminci, des hameçons et des lignes, des dents de requins qu'ils emploient en guise de rasoirs. Les calebasses et les écuelles d'écales de cocos sont ordinairement ornées d'os provenant des bras et des doigts des ennemis qu'ils ont mangés.
Leurs armes sont des massues, des lances et des frondes. Les massues sont longues d'environ (219) cinq pieds, et faites de bois de casuarina (* le toa, ou bois de fer, casuarina equisetifolia), d'un très-beau poli et très-massives, car elles ne pèsent pas moins de dix livres : une tête d'homme est sculptée à l'une des extrémités. Les lances sont faites du même bois, longues de dix à douze pieds, d'un pouce d'épaisseur au milieu, et très-aiguës aux deux bouts. Les frondes sont en cordons parfaitement tressés ; elles sont élargies au milieu pour recevoir la pierre.
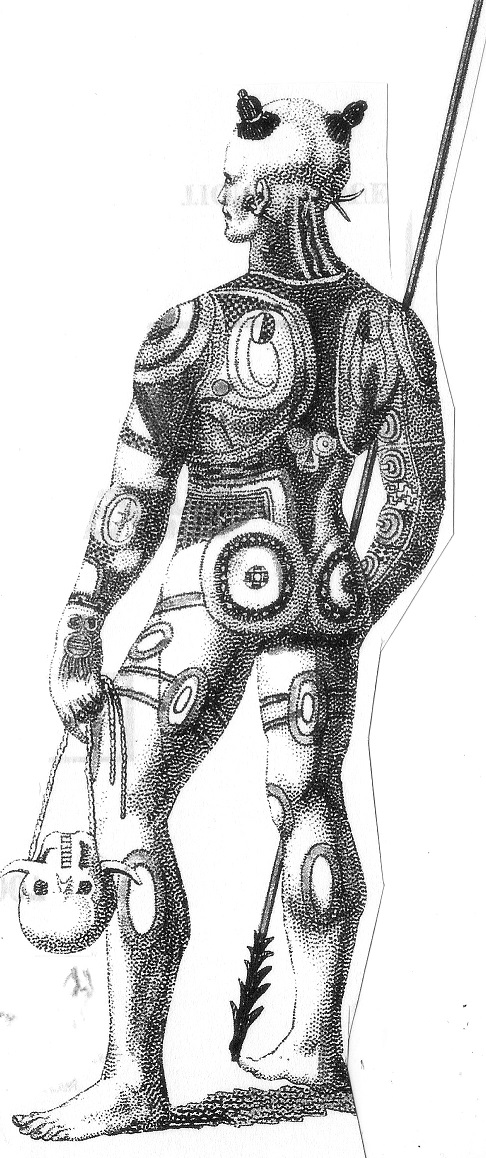


Le dessin de droite avec la lance est de Langsdorff (un jeune homme de 1804) ;
celui de droite avec la massue/casse-tête « ùu » est de Teiki Huukena.
Au centre, on peut voir une fronde/maka marquisienne ; elles étaient généralement portées autour de la tête.
Les Nukuhiviens ont une manière de prendre le poisson qui leur est, à ce que je crois, tout-à-fait particulière (19).
(19) J'ai vu à Surinam une manière de pêcher qui y a quelque rapport.
Ils écrasent en petits morceaux la racine d'une plante qui croît parmi les rochers, et qu'un plongeur va aussitôt répandre au fond de la mer. Son effet sur les poissons est tel qu'ils paraissent, en peu de temps, à demi-morts, à la surface de l'eau, et qu'on peut les prendre sans beaucoup de peine. Ces insulaires ont cependant des filets, mais il me semble qu'ils en font peu d'usage car je n'ai vu à Taiohae que huit pirogues de pêcheurs.
La troisième manière de prendre le poisson est à l'hameçon : il est en nacre de perles et très-artistement façonné. La ligne, ainsi que tous les cordages (22O) dont ils se servent pour leurs pirogues, est faite avec l'écorce de l'arbre qu'ils nomment faou (*fau/hau, hibiscus tiliaceus). Ils font encore, avec les fibres de la bourre des cocos, une autre sorte de corde très-lisse et très forte. Au reste, la pêche est une occupation dédaignée par quiconque possède une portion de terre suffisante à son entretien ; de sorte qu'elle est abandonnée à la classe la plus pauvre. Ils savaient que nous payions bien le poisson ; cependant on ne nous apporta que deux fois sept à huit bonites, preuve certaine que peu de ces insulaires s'occupent de la pêche.
Les pirogues des Nukuhiviens sont toutes à balanciers (20), et construites avec trois différents bois, dont dépendent leurs qualités.
(20) Le balancier est une perche qui repose sur l'eau parallèlement à la pirogue à laquelle elle est attachée avec d'autres perches transversales pour empêcher l’embarcation de chavirer.
Celles qui sont en bois de l'arbre à pain (* artocarpus altilis) ou de miro (*le bois de rose, thespesia populnea) sont de moindre valeur que celles pour lesquelles on a employé le bois de tamanu (* laurier d’Alexandrie, calophyllum inophyllum). Ces dernières sont les plus durables et marchent le mieux. Du reste, elles sont toutes peu solidement construites, et cousues avec des cordes faites de fibres de cocos. La plus grande que nous ayons vue avait vingt-trois pieds de longueur, deux pieds et demi de largeur et deux pieds et un tiers de profondeur !
(20) Le balancier est une perche qui repose sur l'eau parallèlement à la pirogue à laquelle elle est attachée avec d'autres perches transversales pour empêcher l’embarcation de chavirer.
(221) Le Nukuhivien ayant peu de besoins, l'agriculture a dû faire beaucoup moins de progrès chez eux que dans les autres îles de cet Océan. On voit à la vérité des plantations de mûriers à papier, de racines de taro et de poivriers (* kava, piper methysticum) ; mais elles ne sont pas en proportion de la population : ce que prouvent la disette de taro et l'extrême simplicité de l'habillement des insulaires des deux sexes. L'arbre à pain, le cocotier et le bananier ne demandent aucun soin. Un trou, dans lequel on met une bouture, en fait toute la façon. La plante est dans toute sa vigueur au bout d'un mois, et peut être alors abandonnée à elle-même : ainsi, l'agriculture occupe peu les hommes. La pêche est méprisée ou, au moins négligée, sans doute à cause de la peine qu'elle occasionne et du danger qu'elle fait courir.
La construction de leurs maisons est certainement ce qui leur donne le plus de fatigue. La fabrication de leurs armes exige peu de travail, de manière qu'ils passent leur temps dans une grande oisiveté : aussi les voit-on la plus grande partie de la journée couchés sur leurs nattes.
Les femmes ont plus d'occupations : elles filent et tordent les cordages dont l'usage est extrêmement varié. Elles font leurs éventails et ceux des hommes, ainsi que plusieurs ornements dont elles se parent. Mais leur travail principal est la fabrication de (222) l'étoffe dont elles s'habillent. Il y en a de deux sortes : l'une grossière et grise, qu'elles fabriquent avec l'écorce d'un arbre, et qui est destinée aux ceintures ou hiapo : les femmes pauvres l'emploient aussi pour se couvrir, après l'avoir teinte en jaune. La seconde sorte, faite des fibres du mûrier à papier (* ute, broussonetia papyfera), est très fine et d'une blancheur éblouissante. Elle sert aux femmes plus riches pour leur coiffure et pour leurs vêtements. Cette étoffe fine est beaucoup moins ample et moins solide que la grossière : je n'en ai pas vu une seule pièce qui ne fût très-lâche et presque trouée.
J'ai déjà eu occasion d'observer que la forme du gouvernement des Nukuhiviens n'est rien moins que monarchique. Le roi n'est distingué du moindre de ses sujets ni par les habits, ni par les ornements : on se moque de ses ordres ; et s'il lui arrivait de frapper quelqu'un, on lui rendrait bien vite les coups. Il a peut-être en temps de guerre, comme chef des guerriers, un peu plus d'autorité ; cependant, de la manière dont elle se fait ici, il y a apparence que le roi n'est pas le seul général.
L'homme le plus fort et le plus déterminé décide vraisemblablement par ses manœuvres le mouvement des autres ; De sorte que la puissance du roi à la guerre me paraît assez problématique. Je suis aussi très persuadé que sur (225) le champ de bataille, le rôle de Kiatonui est moins brillant que celui de Maou-ha-hou, son allumeur de feu.
La principale prérogative du roi et la seule qui soit positive, consiste dans sa richesse, qui le met en état de nourrir un grand nombre de ses sujets. Le roi n'ayant donc aucune autorité ne peut exercer la justice d'aucune manière. Le vol, loin d'être criminel, est au contraire un mérite pour celui qui s'y montre le plus habile (21).
(21) Je dois, cependant rendre aux Nukuhiviens la justice de dire qu'ils nous ont rarement donné l'occasion sur nos vaisseaux d'admirer leur dextérité à nous voler. Ils ont été retenus sans doute par les armes de nos soldats, qui étaient constamment chargées et dont l'effet leur était parfaitement connu.
L'adultère n'est un crime que dans la famille royale. Le meurtre seul est puni, non par le roi ou les prêtres, mais par les parents et les amis du mort, qui veulent se venger et exigent le sang pour le sang. Quoique les Nukuhiviens soient parvenus à ce point de civilisation où l'on s'unit par le mariage, ils ne paraissent pas en général regarder ce lien comme sacré. Il ressemble probablement plutôt à une simple association formée par une inclination mutuelle ou par l'intérêt, et continuée par l'habitude.
Le court (224) séjour que nous avons fait dans cette île a suffi pour nous convaincre que ses habitants n'ont aucune idée morale des rapports et des devoirs du mariage (22), si bien reconnus dans les autres îles de cette vaste mer.
(22) Le Français (* Joseph Cabri), qui, après un séjour de plusieurs années, était devenu tout-à-fait Nukuhivien, regardait comme une grande preuve du perfectionnement de leurs idées morales, que le frère ne cohabitait plus avec la sœur.
En un mot, l'adultère est chez les Nukuhiviens une chose toute simple et universellement tolérée. Les suites horribles de ce genre de vie brutale se manifestent par l'indifférence avec laquelle, dans un temps de famine, un homme tue sa femme et même son enfant pour en dévorer la chair et satisfaire sa faim : peut-être aurait-il plus de répugnance à commettre cette dernière abomination, s'il n'avait pas beaucoup de motifs de douter que cet enfant fût de lui.
Je soupçonne que la vanité de Robarts a été un peu intéressée à sauver l'honneur de la famille royale à laquelle il est allié, lorsqu'il m'a dit que le roi et tous les membres de sa famille avaient le droit de punir leurs femmes de mort quand ils les surprenaient en faute. Je croirais plutôt que lorsque cette punition sévère est infligée, c'est pour quelque autre (225) cause ; puisque, de son aveu, les dames de la famille royale ne mettent pas plus de prix que les autres à la fidélité conjugale : nous nous en sommes assez souvent aperçus !
Un personnage essentiel de cette famille est celui qui porte le titre d'ALLUMEUR DU FEU DU ROI. Il doit être constamment auprès de sa personne pour exécuter ses ordres ; mais la principale affaire à laquelle son maître l’emploie est bien propre à caractériser le souverain de Nuku Hiva.
Si le roi s'absente de sa maison pour un temps qui excède un certain nombre d'heures, l'ALLUMEUR DU FEU ne l'accompagne pas : il, doit rester auprès de la reine et remplacer le roi dans tous ses droits ; elle trouve en lui un second mari en l'absence de l'autre : c'est le gardien de sa vertu ; la jouissance de ce qui est sous sa garde est sa récompense. Les rois de Nuku Hiva croient apparemment qu'il vaut mieux partager avec un seul qu'avec plusieurs ce qu'ils seraient sûrs de ne pas posséder seuls : peut-être aussi le poste d'ALLUMEUR DU FEU n'est-il qu'un luxe. L'Herculéen Maou-ha-hou remplissait cette fonction pendant notre relâche à Taiohae ; mais il ne méritait guère la confiance du roi car il me parut qu'il était un mauvais gardien de la vertu de la reine.
On conçoit facilement qu'un peuple qui se (226) repaît avec plaisir de chair humaine doit faire souvent la guerre à ses voisins pour savourer ce mets, quoique d'autres causes puissent aussi donner lieu aux hostilités ; mais la manière dont les Nukuhiviens font la guerre décèle encore une grande analogie entre leur caractère et celui des animaux carnassiers.
Il est rare que des corps nombreux s’attaquent ; on se met respectivement en embuscade ; on tâche de tuer son ennemi à la dérobée : la proie est dévorée sur-le-champ (* non, les futures victimes avaient les jambes brisées et on les rapportait au prêtre-tauà qui les sacrifiait conformément au rite de circonstance).
Celui qui montre le plus d'habileté dans ces ruses de guerre, qui peut rester plus longtemps couché sur le ventre sans faire le moindre mouvement, respirer le plus doucement, courir le plus agilement, sauter le plus adroitement d'une pointe de rocher à l'autre ; celui-là, dis-je, n'acquiert pas moins de gloire parmi ses camarades que le robuste et vaillant Maou-ha-hou.
Joseph Cabri se distinguait surtout par toutes ces qualités ; il nous a, depuis, entretenu assez souvent de ses hauts-faits en ce genre. Il nous racontait combien d'hommes il avait tué dans cette sorte de guerre, en nous en détaillant toutes les circonstances. Il nous assura au reste, et son ennemi Robarts lui a rendu justice en ce point, qu'il n'avait jamais mangé de chair humaine, ayant toujours troqué son homme contre un cochon.
Les habitants des vallées de Hooumi, de Hakauì (227) et de Hotty-Chevé (* difficile de trouver le nom de cette vallée du sud-ouest), ainsi que ceux d'une autre vallée plus enfoncée dans les terres, sont presque continuellement en guerre avec ceux de Taiohae. Les guerriers de Hooumi, dont le nombre est, dit-on, de plus de mille, portent un nom particulier, ils s'appellent Taipī, c'est-à-dire troupes de la grande mer : cependant celles de Taiohae ne leur font la guerre que sur terre, jamais sur mer. (* En réalité, si la tribu occupant la vallée de Hooumi fait bien partie de l’alliance Taipī, tout comme les autres grandes vallées du nord, le nom de cette tribu est « Teavarangi/Teavaàni » qui signifie « La voute céleste ».) La raison en est singulière et mérite d'être rapportée. Elle montre que, malgré le peu de considération dont jouissent les rois, on témoigne cependant en plusieurs cas un respect extraordinaire pour les membres de la famille royale, fondé peut-être sur une ancienne superstition.
Le fils de Kiatonui a épousé la fille du roi des Taipī (* Malheureusement, si la généalogie laissée par Crook nous donne quelques détails des épouses des fils de Kiatonui, il ne précise pas le nom des gendres de ce dernier.) ; et comme elle est venue par eau, · la mer qui sépare les deux vallées est devenue tabou, c'est-à-dire sacrée : y verser le sang serait la profaner. Mais si le prince faisait divorce avec sa femme et la renvoyait chez ses parents, le tabou serait alors levé, et la guerre qui se faisait par terre recommencerait aussitôt par mer. Au contraire, si la princesse meurt dans la vallée de son mari, c'est le signal d'une paix perpétuelle, parce que, dans ce cas, l'esprit de cette personne royale, que l'on vénère comme un ètua ou être divin, voltige au-dessus de cette vallée, et son repos ne doit pas (228) être troublé.
Une heureuse alliance de ce genre maintient la paix entre la vallée Taiohae et une autre dans l'intérieur (* les Hapaa les plus proches de Muàke). La fille de Kiatonui en a épousé le roi, dont le nom est Maou-day (* Mauateii), c'est-à-dire chef des guerriers (* ?) (* Comme déjà mentionné, la fille aînée de Kiatonui avait épousé Mauateii ; ils étaient tous deux parents de Paetini. Robarts fait souvent allusion à ce couple dans son journal ; ayant échangé son nom avec celui (inconnu) de leur fils aîné, ils étaient ses parents adoptifs). Il peut, dit-on, en réunir 1200 sous ses ordres ; et comme leur position respective les empêche de pouvoir se faire la guerre par mer, les deux vallées sont dans la plus profonde paix : aussi Mauateii réside-t-il presque constamment à Taiohae. C'est après Maou-ha-hou et Pautini, le plus bel homme que nous ayons eu occasion de voir : c'était aussi un de ceux qui venaient journellement à bord.

Portrait de Mauateii par Tilésius en 1804
La guerre avec les Taipī continue par terre jusqu'à ce que l'un des deux rois (les deux partis ont en ce point un droit égal) demande un armistice, sous le prétexte de la célébration des danses solennelles ; ce sont les jeux olympiques de ces sauvages, et, d'après leurs coutumes, ils ne peuvent être longtemps interrompus. Dans ce cas, on convient d'une époque fixe pour en commencer les préparatifs et du temps qu'elles doivent durer. Amis et ennemis prennent également part à ces fêtes. La preuve que ces hommes grossiers et sanguinaires se lassent de la guerre et désirent quelquefois de jouir d'un repos assuré, est qu'ils prolongent ce temps de préparatifs beaucoup (229) plus qu'il ne serait nécessaire pour une cérémonie de quelques jours.
Six mois s'étaient écoulés déjà depuis le dernier armistice, et il en restait encore huit jusqu'au jour où devait commencer la fête, quoique tout ne consistât qu'à préparer une nouvelle place pour y célébrer les danses. Après ces jeux, chacun retourne chez soi et la guerre recommence : elle cesse du moment que l'armistice est dénoncé, ce qui se fait par une branche de cocotier que l'on plante au sommet d'une montagne.
Il n'y a qu'une exception à cette règle. Elle a lieu en tout temps et en toute circonstance, que ce soit pendant l'armistice ou la célébration des fêtes ; le génie même de la paix, l'esprit d'un ètua ne pourrait y mettre obstacle.
À la mort du grand-prêtre d'une vallée (* un tauà), il faut nécessairement sacrifier trois victimes humaines ; or, comme les victimes ne peuvent être prises dans la vallée même, il faut se les procurer chez les voisins. Dès ce moment, on expédie des pirogues pour tâcher d'en saisir. Si l'on parvient à surprendre une pirogue qui ne soit pas assez forte pour se défendre et qui contienne le nombre de victimes prescrites, les violences cessent à l'instant et la mer redevient tabou : mais si l'on ne peut rien saisir sur mer, l'équipage des pirogues descend à terre et se met en embuscade parmi les rochers pour sauter (250) sur les habitants, qui viennent souvent le matin pêcher à l'hameçon. Il ne tarde pas à égorger les victimes qui doivent réconcilier les mânes du grand-prêtre avec la divinité. Ces infortunés ne sont cependant pas dévorés : on les suspend à un arbre où ils restent jusqu'à ce que la chair se sépare des os. Si l'on ne peut surprendre personne le premier jour, le bruit de la tentative se répand aussitôt ; on se défend et les hostilités commencent : mais ces sortes de guerres ne durent pas longtemps à cause du petit nombre de victimes qu'elles exigent.
On s'attendait à pareille scène d'un moment à l'autre pendant notre séjour à Taiohae : le grand-prêtre étant très-malade et sans espoir de guérison.
Des prêtres, supposent une religion ; mais quelle espèce de religion les Nukuhiviens peuvent-ils avoir ? Si l'on en juge par leur caractère moral, elle n'a pas encore contribué à l’améliorer ; elle ne sert sans doute qu'à procurer une vie commode et tranquille à quelques individus, qui, par des absurdités souvent accompagnées d'horreurs, trouvent le moyen de se faire considérer de tout le reste de la nature comme une classe sacrée (23) et nécessaire.
(23) La personne des prêtres est tabou
Il paraît que les Nukuhiviens ont une (230) idée confuse d'un être supérieur qu'ils nomment ètua ; mais ils reconnaissent plusieurs ètua : l'esprit d'un prêtre, d'un roi ou d'un membre de la famille est ètua ; les Européens-même le sont tous à leurs yeux : car leurs idées ne s'étendant pas au-delà de leur horizon ; ils croient que les vaisseaux étrangers tombent des nues. Selon eux, le tonnerre est occasionné par les vaisseaux européens qui se canonnent dans les nuages où ils naviguent avec la plus grande facilité. C'est pourquoi ces insulaires ont une frayeur extrême de nos canons (24).
(24) On tira un jour un coup de canon au moment où le frère du roi était à bord. Il se jeta aussitôt à terre, en s'accrochant à l'Anglais Robarts qui se trouvait près de lui ; l'angoisse la plus vive était peinte sur son visage : il ne cessait de répéter avec une voix tremblante : Mattè, mattè (Je suis mort) (mate, en marquisien moderne).
Le seul bien qu'ait produit cette religion est le tabou, dont l'origine est certainement religieuse ; car le roi même n'osant l'enfreindre, il s'ensuit que le respect extrême des insulaires pour ce mot leur vient d'un sentiment dont la source est hors d'eux-mêmes. Les prêtres seuls peuvent prononcer un tabou général ; mais chaque particulier a le pouvoir d'en attacher un à sa propriété. Ce qui se fait de cette manière. Si quelqu'un, par exemple, veut préserver un (232) arbre à pain, un cocotier ou sa maison, de vol ou de destruction, il déclare que l'esprit de son père, ou du roi, ou de telle autre personne, y repose ; l'arbre ou la maison est alors tabou, et personne n'ose toucher. L'homme assez impie pour rompre un tabou est aussitôt déclaré kikino : les kikino sont toujours les premiers que les ennemis mangent, du moins les Nukuhiviens le croient fermement, et il est possible aussi que les prêtres disposent les choses de façon que cela arrive ainsi Toutes les personnes de la famille royale et les prêtres sont tabou. L'Anglais m'assurait qu'il était lui-même tabou ; il n'en avait pas moins peur d'être pris et mangé à la première guerre,On l'a probablement considéré au commencement comme un ètua, ainsi que le sont tous les Européens, mais une familiarité de sept ans a peut-être fait disparaître peu à peu l'éclat de la divinité.
Robarts n'a pu me donner que très-peu de lumière sur la religion des Nukuhiviens, soit parce qu'ils n'en ont eux-mêmes que des idées confuses, soit parce qu'il n'a pris aucune peine de s'en informer.
Voici ce qu'il m'a appris des usages pratiqués aux funérailles : on reconnaît sans peine l'esprit de leur fondateur. Dès que le cadavre est lavé, on le dépose sur une plate-forme garnie d'une pièce d'étoffe (233) toute neuve, et on le recouvre d'une autre absolument pareille. Le lendemain, les parents du défunt donnent une grande fête à leurs amis et à leurs connaissances, à laquelle les prêtres doivent nécessairement assister, mais dont les femmes sont exclues. On y étale toute sa richesse en cochons (dont on ne mange que très-rarement en d'autres occasions), en racines de taro et en fruits de l'arbre à pain. Dès que l'assemblée est réunie, on coupe la tête du cochon pour l'offrir aux dieux, afin qu'ils accordent au défunt un passage sûr et tranquille à l'autre monde. Cette tête est remise aux prêtres, ils la mangent chez eux, et n'en gardent qu'une petite partie qu'ils placent sous une pierre. Le repas fini, les amis et les plus proches parents du défunt sont obligés de rester près du corps et de le frotter continuellement d'huile de cocos pour le garantir de la putréfaction. Ces frictions réitérées le rendent dur comme la pierre et indestructible. Douze mois après la première fête, on en donne une seconde qui n'est pas moins splendide, pour remercier les dieux d'avoir laissé le défunt passer heureusement dans l'autre monde : c'est par là que finissent les funérailles. Le cadavre est alors mis en pièces, les os sont placés dans une boîte d'arbre à pain et on la porte au moraï, (234) dont l'entrée est défendue aux femmes, sous peine, de mort.
La croyance aux sortilèges est universelle ; il en est un surtout auquel les Nukuhiviens attachent une grande importance, et qui paraît avoir quelques rapports avec leur religion ; car c'est à leurs prêtres auxquels ils accordent cette vertu magique. On dit cependant que parmi le peuple, il se trouve des gens qui prétendent la posséder, sans doute pour se faire craindre et pour obtenir des présents. Cette magie, qu'ils nomment kaha (* ou nanikaha), consiste à faire périr d'une mort lente la personne à laquelle ils en veulent.
Voici en quoi elle consiste : quiconque veut se venger par magie, cherche à se procurer de la salive, de l'urine ou des excréments de son ennemi. Il y mêle une certaine poudre, met cette mixtion dans une bourse tressée d'une manière particulière et l'enterre. Le grand secret est attaché à l'art de bien tresser la bourse et d'apprêter la poudre (* le mot nani signifie attacher, ficeler). Dès que la bourse est en terre, l'effet de la magie ne tarde pas à se manifester sur celui qui en est l'objet. Il tombe malade, s'affaiblit peu à peu, perd enfin ses forces entièrement et meurt sans faute le vingtième jour. Mais, parvenu même au dix-neuvième, s'il veut arrêter la vengeance de son adversaire et racheter sa vie (235) par un cochon ou quelque autre présent de prix, il peut encore être sauvé ; on déterre la bourse et, sur-le-champ, les symptômes de la maladie disparaissent ; il se rétablit bientôt et dans quelques jours il est parfaitement guéri.
Quoique homme de bon sens, Robarts croyait à cette magie des prêtres, et le Français y ajoutait également foi, car il s'était donné, quoiqu'inutilement, toutes les peines possibles pour découvrir ce secret, afin de se débarrasser de son ennemi Robarts, ne pouvant espérer d'y parvenir d'une autre manière. Robarts possédait un talisman plus redoutable que le kaha : c'était un bon fusil. Cependant il désirait encore se faire craindre davantage : il nous pria, le capitaine Lisianski et moi, de la manière la plus pressante, de lui donner une paire de pistolets, un fusil, des balles, de la poudre et du plomb. Nous fûmes réellement peinés de ne pouvoir satisfaire sur ce point un homme qui nous avait rendu tant de services. Nous lui représentâmes qu'il s'attirerait par là une guerre générale qui durerait autant que ses munitions. Ses richesses en ce genre ne pouvant rester un secret pour les insulaires, ceux-ci chercheraient tous les moyens de s'en emparer, ainsi elles contribueraient moins à ajouter à sa sécurité qu'à mettre sa vie en danger. Nos raisons lui parurent fondées ; et comme nous voulions (236) nous séparer bons amis, nous lui donnâmes des choses qui lui ont été sûrement plus utiles que la poudre et des balles.
Robarts me parut un homme d'un caractère exalté et d'un esprit indécis, mais il avait du bon sens et un bon naturel. Le plus grand reproche que lui adressait Cabri, son ennemi mortel, était de voler maladroitement, et par là de courir souvent le risque de mourir de faim. Il avait su, au milieu de ce peuple sauvage, s'attirer peu à peu cette considération qu'un « esprit sensé obtient facilement sur l'ignorance et la sottise » : il avait même plus d'influence que le guerrier le plus distingué ; il était devenu particulièrement nécessaire au roi. Je ne doute pas qu'il n'ait pu opérer plus de bien dans cette île que le missionnaire Crook pendant son séjour.
L'unique but de celui-ci était d'y répandre le christianisme, sans penser qu'il faut commencer par faire, de ces insulaires, des hommes avant d'en faire des chrétiens. Robarts me paraissait plus propre que Crook, ou tout autre missionnaire, à effectuer ce changement par son exemple, par son adresse, et par l'estime générale dont il jouit. Il s'est construit une jolie maison, possède un terrain qu'il cultive avec de l'ordre et de l'intelligence ; il ne cesse d'y faire des améliorations inconnues avant lui ; enfin, de son aveu même, il mène une (237) vie heureuse et tranquille. La seule idée qui le tourmente, c'est celle de vivre parmi des cannibales, et chaque guerre le fait trembler. Je lui offris de le conduire aux îles Sandwich, d'où il trouverait facilement occasion d'aller à la Chine ; mais il ne put se résoudre à quitter sa femme, qui venait de lui donner un fils. Il finira probablement ses jours à Nuku Hiva.
Un peuple, placé dans l'échelle de la civilisation aussi bas que les Nukuhiviens, ne peut être fort sensible aux charmes de la musique On ne connaît cependant aucune peuplade, même dans l'état le plus sauvage, qui n'y prenne quelque plaisir, et les Nukuhiviens n'y sont pas tout-à-fait indifférents. Mais leur musique répond à leur caractère ; leurs instruments en sont la preuve. Une musique, destinée à exciter des sensations douces, ne saurait être goûtée par des hommes qui n'en sont pas susceptibles. Le son tendre d'une flûte ne peut affecter des barbares qui égorgent, sans être émus, leurs femmes et leurs enfants. Il ne leur faut que des instruments propres à enflammer leur férocité.
Les tambours de ces sauvages, qui sont d'une grosseur monstrueuse, et qui rendent un son creux et sourd, leur conviennent parfaitement. Le son le plus harmonieux à leur oreille est celui qu'ils produisent en appuyant le bras gauche contre les (238) corps, et frappant violemment du plat de la main droite sur le creux de l'autre main, qui retentit alors avec force : c'est ainsi qu'ils battent la mesure.
Leurs chants et leurs danses ne sont pas moins barbares. La danse consiste à sautiller continuellement sur la même place, en levant de temps en temps les mains en haut, et remuant rapidement les doigts. Leurs chants ressemblent plutôt à un hurlement qu'à une réunion régulière de voix. Mais ils en sont contents, et je doute que la plus belle musique puisse émouvoir un Nukuhivien.
Ce que j'ai à dire de la population de l'île n'est fondé que sur une estimation assez arbitraire ; mais lorsqu'on n'a pas de données certaines, il faut se contenter d'approximations. Taiohae peut, selon Robarts, faire marcher 800 guerriers contre l’ennemi ; Hooumi, 1000 ; Hakauì, 500 ; Mauateii, 1200 ; Hotty-Chevé (* ?), au S. O. de Taiohae, et une autre vallée au N. E., fournissent chacune 1200 hommes.
Ces calculs de Robarts, en nombres ronds, sont faits un peu à l'aventure, car il n'avait pas de renseignements très-positifs. Quoi qu'il en soit, si l'on admet ce nombre de 5900 combattants, et qu'on le multiplie par trois pour les femmes, les enfants et les vieillards, etc., ce que je regarde comme suffisant, parce que les mariages ne sont pas féconds, et que je n'ai vu, ni à Taiohae (239), ni à Hakauì, aucun homme très-âgé, on aura, pour la population totale, 17 700, ou, en nombre rond, 18000 habitants.
Je soupçonne pourtant que Robarts a porté un tiers trop haut la population, de Taiohae ; car je ne vis jamais, dans cette partie de l’île où doivent se trouver 800 guerriers, conséquemment 2400 habitants, plus de 800 à 1000 personnes à la fois, parmi lesquels on comptait à peu près 400 jeunes filles ; et certainement la plus grande partie des habitants s'était rassemblée sur le rivage. La curiosité de voir des vaisseaux européens , objets nouveaux pour eux, jointe au désir général et très-vif d'obtenir du fer, devait naturellement attirer tout le monde, et ne laisser en arrière que les mères avec leurs enfants, qui effectivement ne parurent pas du tout, si ce n'est la petite fille du roi, Ainsi, en diminuant d'un tiers l'estimation de Robarts, il resterait 2000 âmes en tout; ce qui est bien peu pour une île qui a 60 milles de tour, dont le climat est sain, où l'usage du kava est fort modéré, et où la pire des maladies est encore inconnue.
D'un autre côté, la population doit souffrir prodigieusement des guerres continuelles, des sacrifices humains, des meurtres qui se commettent à la moindre disette de vivres ; de la débauche des femmes, qui s'y livrent dès l'âge de huit à neuf ans ; enfin, du peu (240) de respect pour le mariage. Robarts m'a assuré qu'une femme avait rarement plus de deux enfants, et très-souvent n'en avait aucun. On ne doit donc compter qu'un enfant par mariage, pour terme moyen, ce qui est à peine le quart du calcul adopté en Europe.
Je terminerai ce que j'ai à dire sur les mœurs et les usages des Nukuhiviens par quelques remarques sur leur caractère. Je dois d'abord avouer que si nous n'eussions pas rencontré dans l’île l'Anglais Robarts et le Français Cabri, nous eussions emporté, de ces insulaires, l'opinion la plus favorable. Nous n'avons éprouvé, de leur part, que d'excellents procédés : ils se sont toujours conduits avec la plus grande honnêteté dans leur commerce d'échange avec nous ; ils commençaient toujours par livrer leurs cocos avant de recevoir notre fer. Si nous avions besoin de bois ou d'eau, ils étaient toujours prêts à nous aider. Nous m'avons eu que très-rarement à nous plaindre de vol, vice si commun et si répandu dans toutes les îles de cet océan. Toujours gais et contents, la bonté paraissait peinte sur leur figure. Pendant les dix jours que nous avons passés avec eux, nous ne fûmes jamais obligés de tirer un coup de fusil chargé à balle. Peut-être faut-il attribuer leur conduite paisible à la crainte de nos armes et à l'espoir d'une récompense (241). Mais pourquoi chercher des motifs ignobles à des actions auxquelles nous ne pouvions qu'applaudir chez des hommes qui connaissent si peu les Européens, des hommes qui, d'après les idées de quelques philosophes, ne doivent point encore connaître la corruption ?
On trouvera sans doute étrange qu'après avoir apporté d'Europe les préjugés les plus favorables aux insulaires du Grand-Océan, qu'après avoir eu la meilleure opinion des Nukuhiviens pendant les premiers jours de ma relâche chez eux, je finisse par en faire une peinture si désavantageuse ; mais la surprise cessera, si l'on veut bien peser avec impartialité les raisons suivantes.
Les deux Européens que nous avons trouvés à Nuku Hiva, et qui avaient vécu plusieurs années dans cette île, se sont accordés à dire que les habitants sont dépravés, barbares, et, sans excepter même les femmes , cannibales dans toute l'étendue du terme ; que leur air de gaîté et de bonté qui nous a si fort trompés, ne leur est pas naturel ; que la crainte de nos armes ou l'espérance du gain, les avaient seules empêché de donner un libre cours à leurs passions féroces. Ces Européens décrivirent, comme témoins oculaires, avec les plus grands détails, des scènes affreuses qui avaient lieu presque tous les jours chez ce peuple, surtout en temps (242) de guerre. Ils nous racontèrent avec quelle rage ces barbares tombent sur leur proie, lui coupent la tête, sucent avec une horrible avidité le sang par une ouverture qu'ils font au crâne (25), et achèvent ensuite leur détestable repas.
(25) Tous les crânes que nous avons obtenus d'eux avaient cette ouverture.
J'ai d'abord refusé de croire à ces horreurs, et regardé ces rapports comme fort exagérés. Mais ces récits reposent sur la déposition unanime de deux hommes qui ont été, pendant plusieurs années, non-seulement témoins, mais encore acteurs dans ces scènes abominables. Ces deux hommes étaient ennemis jurés, et cherchaient, en se calomniant et se dénigrant réciproquement, à se mettre plus en crédit dans notre esprit. Jamais cependant ils ne se sont contredits sur ce point. La justice même que Robarts rendait à son adversaire de n'avoir, en aucun temps, mangé la chair de sa victime, et de l'avoir cédée pour un cochon, donne encore à ces faits un plus grand degré de vraisemblance. D'ailleurs, les récits de ces deux Européens s'accordent parfaitement avec divers indices qui nous ont frappés pendant notre court séjour.
Chaque jour les Nukuhiviens nous apportaient une quantité de crânes à vendre ; leurs armes étaient toutes ornées de (243) cheveux ; des ossements humains décoraient, à leur manière, une grande partie de leurs meubles. Ils nous faisaient connaître aussi, pas leurs pantomimes, leur goût pour la chair humaine. Toutes ces particularités suffisent malheureusement pour prouver que ce sont des cannibales. Il est vrai que les habitants de la Nouvelle-Zélande, des îles Sandwich, en un mot, de toutes les îles du Grand-Océan, mangent aussi la chair de leurs ennemis tués à la guerre. Mais ce qui place les habitants des îles Washington à la tête des plus affreux cannibales, c'est que, dans les temps de famine, les hommes tuent les femmes, les enfants, les vieillards ; ils cuisent et rôtissent leur chair, et la mangent avec le plus grand plaisir.
Ces Nukuhiviennes même qui paraissaient si douces, dont les regards n'exprimaient que la volupté, prennent aussi part, quand cela leur est permis, à ces détestables repas. C'est ce qui nous a été attesté par les deux Européens. Peut-on excuser de pareilles horreurs ? Peut-on, avec George Forster, soutenir que les insulaires du Grand Océan sont un peuple doux, bon et non corrompu ? Je prétends que c'est la crainte seule qui les empêche de tuer et de manger tout homme qui aborde chez eux.
Il y a quelques années qu'un navire marchand américain entra au Port Anna-Maria. Le capitaine, en bon quaker (244), avait envoyé ses gens à terre sans armes : à peine furent-ils aperçus par les insulaires, que ceux-ci se rassemblèrent pour les attaquer et les entraîner dans leurs montagnes. Robarts, et le roi lui-même qui le seconda, eurent beaucoup de peine à sauver ces étrangers ; Robarts avait représenté au roi la perfidie d'une action semblable, et les suites funestes qui en pourraient résulter pour sa vallée.
Au reste, ils nous prouvèrent qu'ils n'ont aucun sentiment d'équité et de bienveillance. Pendant tout le temps de notre séjour chez eux, nous avions fait tout ce qui dépendait de nous pour leur inspirer de la reconnaissance, ou au moins de la bienveillance : nos procédés produisirent un effet tout contraire. Au moment de notre départ, le bruit se répandit qu'un de nos vaisseaux était échoué, parce que nous avions été obligés de mouiller plus près de la côte. En moins de deux heures les insulaires, armés de massues, de haches et de lances, se rassemblèrent, en grand nombre, vis-à-vis du vaisseau. Nous ne les avions pas encore vus dans cet appareil de guerre. Quel pouvait être leur dessein, si ce n'est de nous voler et de nous massacrer ? Le Français, qui vint aussitôt à bord, nous avertit des projets hostiles des insulaires, et nous annonça que toute la vallée était en mouvement. (245) Il résulte de ce portrait des Nukuhiviens, qui peut paraître chargé, mais qui certainement ne l'est pas, qu'ils n'ont ni institutions sociales, ni religion, ni sentiments moraux ; qu'ils ne connaissent d'autre jouissance que celle de satisfaire leurs besoins physiques ; en un mot, qu'il n'existe en eux aucune trace de bonne qualité : que c'est par conséquent la race d'hommes la plus vicieuse qui existe sur la terre. Ainsi, on ne sera pas scandalisé de ce que je les ai nommés des sauvages (26).
(26) On lit, dans le voyage de Marchand, publié par Fleurieu, tom. V, page. 441, éd. in-8° : « J'appelle sauvages les peuples qui, ne reconnaissant aucun gouvernement, aucune institution sociale, et satisfaits de pourvoir aux premiers besoins de la nature, peuvent être considérés comme le terme intermédiaire entre la brute et l'homme. On doit cependant classer au-dessous de la brute l'homme qui mange son semblable. »
Malgré les peintures avantageuses des habitants des îles des Amis, de la Société, de Sandwich, que l'on trouve dans les voyages de Cook ; malgré l'enthousiasme avec lequel Forster prend leur défense, je ne puis m'empêcher de regarder tous ces insulaires non-seulement comme des sauvages, dans le sens que M. de Fleurieu attache à ce mot, mais encore comme appartenant à cette classe d'hommes au-dessous de la brute qui mangent leurs semblables : c'est (246) tout au plus si l'on peut admettre une ou deux exceptions.
Indépendamment des insulaires, bien reconnus pour cannibales, tels que ceux de la Nouvelle-Zélande, de Fidji, des îles des Navigateurs, des îles Marquesas de Mendoza, des îles Washington, des îles Salomon, des îles Sandwich, de la Louisiade et de la Nouvelle Calédonie, ne peut-on pas, d'après ce qui est arrivé au capitaine Bligh et à d'Entrecasteaux, soupçonner les naturels des îles des Amis d'avoir les mêmes goûts que leurs voisins ?
Les habitants des îles de la Société sont jusqu'à présent les seuls que l'on n'a point encore soupçonné de cette barbarie : ce sont les moins corrompus, les plus doux, les plus humains de tous les insulaires du Grand Océan ; en un mot, ce sont eux qui ont donné la meilleure idée des hommes de la nature et qui ont excité le plus d'enthousiasme : et cependant on voit parmi eux des mères égorger de sang-froid l’enfant qu'elles viennent de mettre au monde pour continuer leur vie déréglée. Et ces sociétés nombreuses des areoyés (* arioi, à Tahiti), dont Forster fait l'apologie avec tant d'éloquence, ne sont-elles pas composées d'autant de parricides ! Il n'y a peut-être que l'extrême fertilité de leurs îles qui les empêche d'être également des cannibales (27).
(27) Forster père croit de même que les habitants des îles de la Société ont été anciennement anthropophages.
(247) Il est sans doute louable à Cook de vouloir disculper les insulaires, qui l'ont bien accueilli, du reproche qu'on leur a fait ; mais de nouveaux voyages ont prouvé combien il est facile d'être trompé par les apparences. Je ne veux en citer qu'un exemple Cook ayant été amicalement reçu par les insulaires de la Nouvelle Calédonie, fait le plus grand éloge de leur caractère. Il leur donne la préférence sur tous les insulaires de cette mer, même sur les habitants des îles des Amis ; Forster en fait un portrait non moins avantageux. Et cependant d'Entrecasteaux a trouvé chez eux des indices certains de leur goût pour la chair humaine. Malheur au navigateur infortuné qui échouera sur les côtes de la Nouvelle-Calédonie ! Hélas ! C'est peut-être là que La Pérouse a trouvé son tombeau, après avoir pleuré peu de temps auparavant des compagnons qui avaient éprouvé un sort aussi funeste ! (* L’Astrolabe et la Boussole, les deux navires de La Pérouse se sont écrasés contre les récifs de Vanikoro, une des îles Salomon, en 1788 ; les épaves ont été formellement identifiées en 2005.)
CHAPITRE X (Début)
DÉPART DES ÎLES WASHINGTON – ARRIVÉE DE LA NADEJDA AU KAMTCHATKA
La Nadejda et la Néva font voile pour les îles Sandwich - Recherche inutile, de l'île Ohiva-Patto (* ?) - Arrivée à l’île Ovaihi (* Hawaii) - Erreur remarquable des chronomètres à bord des deux vaisseaux - Disette complète de vivres - Le mont Mouna-Roa. - Habitants des îles Sandwich. - La Nadejda se sépare de la Néva et fait route pour le Kamtchatka - Expériences sur la température de l'eau de la mer - Tentatives inutiles pour retrouver la terre que les Espagnols prétendent avoir, découverte à l'est du Japon - Arrivée au Kamtchatka - Situation de Jipounskoï Noss - La Nadejda entre dans le port de Saint-Pierre et Saint-Paul.
Le 18 mai, nous quittâmes la baie de Taiohae par un très-mauvais temps. Nous perdîmes une ancre à jet et deux câbles. Pendant que nous étions à nous touer hors de la baie, il survint une rafale si violente, que nous fûmes obligés de couper nos câbles et de mettre nos voiles dehors, pour n'être pas entraînés sur les rochers qui bordent le côté occidental de l'entrée (249), dont nous étions à peine éloignés d'une encablure.
À 9 heures, les nuages se dissipèrent et le temps s'éclaircit. Cependant le vent soufflait encore, de l'E. N. E., avec force. Nous aperçûmes la Néva qui, dès la veille au soir, avait réussi à gagner le large. Après avoir pris nos embarcations à bord et amarré nos ancres, je tournai le cap au N., pour nous rapprocher de l’île, voulant mesurer encore quelques angles et dessiner quelques vues, ce que le mauvais temps du matin nous avait empêché de faire. À midi, nos observations nous donnèrent 8° 59’ 46" de latitude. La pointe N. O. de Nuku Hiva nous restait directement au N. C'est de cette pointe, dont la longitude est, d'après nos observations, par 139° 49’ 0 O., que je pris mon point de départ. Le vent soufflant grand frais de l'E., je me dirigeai à l'O. S. O. pour vérifier l'existence d'une terre dont le capitaine Marchand doit avoir eu connaissance en allant des îles Washington au N.
M. de Fleurieu suppose que c'est l'Ohiva-Potto du Tahitien Tupaia, qui accompagna Cook dans son premier voyage. Quoique la nuit fût très-claire, je fis mettre en panne à 9 heures du soir, afin de ne laisser aucun doute sur l'existence de cette île prétendue. Nous étions éloignés d'un degré à l'O. de notre (250) point de départ.
À 5 heures et demie du matin, nous fîmes route, à toutes voiles, à l'O. ¼ S., et à midi, je gouvernai à l'O., pensant qu'il était inutile de gouverner plus longtemps O. S. O. : car si Marchand, dans cette direction, eût effectivement aperçu une terre, nous devions de même la découvrir infailliblement, avant le coucher du soleil. Après avoir continué notre route à l'O. jusqu'à 6 heures du soir, sans le moindre indice de terre, je renonçai à sa recherche dans cette direction. D'ailleurs, je ne devais pas trop m'éloigner, car je savais que, dans cette partie de l'Océan, un fort courant, qui porte à l'O., rend très pénible la traversée directe des îles Washington aux îles Sandwich, comme l'a éprouvé le lieutenant Hergest, commandant du Daedalus.
Ce même courant à l'O. avait obligé le capitaine Vancouver, à son passage de Tahiti à Ovaïhi, en 1791, à se diriger à l'E. pour atteindre cette dernière île. À 6 heures du soir, je changeai donc de route et me dirigeai au N. N. O. Nous étions alors par 9° 23' S. et 142° 27" O., conséquemment 2° 48' à l'O. de Nuku Hiva. Pendant cette première nuit je fis peu de voile, jugeant que je pourrais rencontrer quelque terre dans ces parages. Nous n'eûmes pas ce bonheur.
Nous avions eu pendant quelques jours un fort vent d'E. et d'E. S. E. (251) accompagné de violentes rafales, qui nous avaient déchiré quelques vieilles voiles. Le courant portait constamment à l'O., comme je devais m'y attendre. Je fus donc très-étonné de trouver, pendant 2 jours de suite, qu'il portait fortement au S., et même le 21 et le 22 de ce mois, entre 4° et 6° de latitude S., à 49 milles au S. 65° O. Je me déterminai par conséquent à porter le cap au N. O. Sur ces entrefaites, le courant ne porta plus au S. ; il resta constamment au N. O. jusqu'à notre arrivée aux îles Sandwich. Le 22 mai, nous étions par 3° 27’ S. et 145° 00' O. ; l'inclinaison était de 13° au S., et la déclinaison de 5° 18 à l'E. (28).
(28) On vit ce soir-là un oiseau gris, de la grosseur d'un pigeon, voltiger longtemps autour du vaisseau, et se poser enfin sur les manœuvres, où il se laissa prendre à la main.
Le 24, M. Horner profita d'un calme pour plonger un thermomètre de six à 100 brasses dans la mer : il était, à cette profondeur, à 12 ½ degrés, et, à la surface de l'eau, à 22 ¼ degrés, température de l'air. La machine de Hales, au contraire, plongée à la même profondeur, indiqua 19 degrés, quoiqu'elle y fût restée 20 minutes, ce qui prouve que l'eau qu'elle contenait s'était fort échauffée pendant qu'on remontait la machine.
Au moment de ces expériences, nous étions à 0° 56’ au S. de l'équateur, et par 46° 16’ O. La déclinaison de l'aiguille était de 4° 37’ E., et l'inclinaison de 8° 30' S. Nous n'avions eu, depuis 2 jours, qu'un vent faible et variable avec des alternatives de calmes : l'air était très-doux et fort agréable ; il paraissait frais, surtout pendant la nuit, en comparaison des chaleurs que nous avions essuyées depuis plusieurs semaines ; le thermomètre ne se tenait pourtant qu'à un degré et demi plus bas que le jour de notre départ de Nuku Hiva.
Le vendredi 25 mai, à 3 heures après midi, nous passâmes la ligne par 146° 31' de longitude O., selon nos chronomètres, mais, selon la table de loch, par 144° 56 : ainsi, en 7 jours, elle présentait une différence de 1° 35'. Presque au moment même où nous coupâmes l'équateur (ce qui put être déterminé avec assez d'exactitude, puisque la latitude observée à midi n'était que 4’), l'inclinaison se trouva de 6° 15' S. ; mais notre boussole d'inclinaison n'était pas assez parfaite pour mériter beaucoup de confiance…
(…)
BIBLIOGRAPHIE
*- Crook, William Pascoe - Récit aux îles Marquises, 1797-1799 ; traduit de l’anglais par Mgr Hervé Le Cléac’h, Denise Koenig, Gilles Cordonnier, Marie-Thérèse Jacquier et Deborah Pope-Haere Pō-Tahiti-2007
*- Govor, Elena « Twelve Days at Nuku Hiva – Russian Encounters and Mutiny in the South Pacific », University of Hawai’i Press, Honolulu, 2010
*- Huukena, Teìki : « Hāmani haatuhuka – Te Patutiki – Dictionnaire du tatouage polynésien des îles Marquises – Marquisien/français – Français/marquisien – Tome 1 -Tiki éditions – 2011
*- Krusenstern, Adam von : « Voyage autour du monde fait dans les années 1803, 1804, 1805 et 1806 », Paris, 1821/ Hachette - BNF
*- Porter, Commodore David, « Nuku Hiva, 1813-1814 ; le Journal d’un corsaire américain aux îles Marquises », éditions Haere Pō, Tahiti 2014.
*- Robarts, Edward « Journal Marquisien, 1798-1806 » ; traduction de Jacques Iakopo Pelleau, Haere Pō, Tahiti, 2018.
Publié par Jacques Iakopo Pelleau le 03/06/2020


