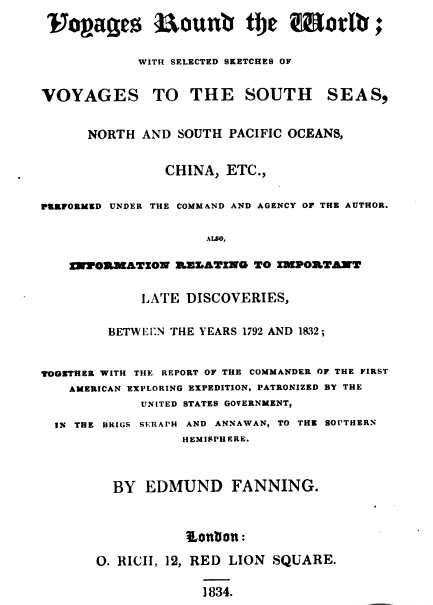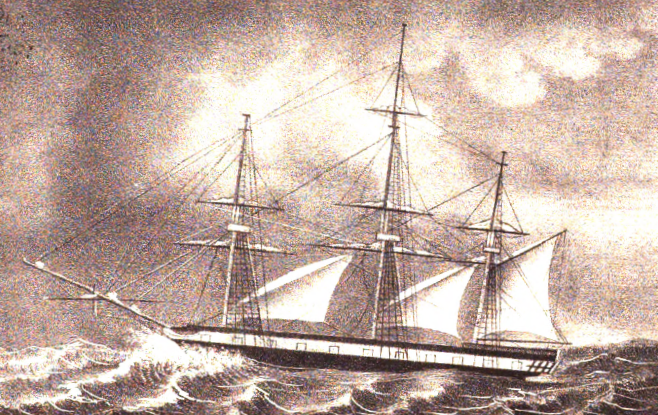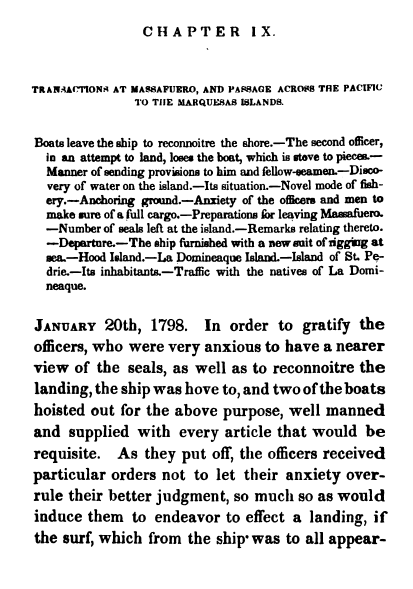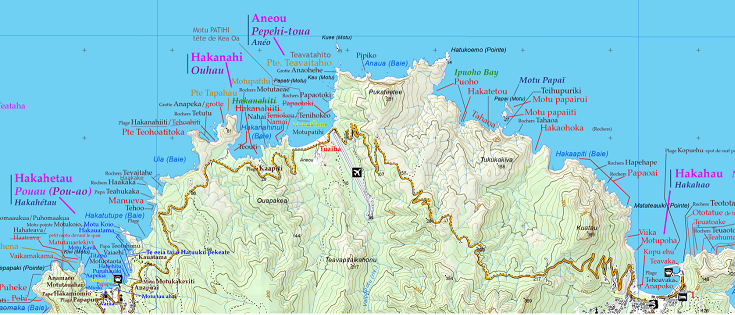« VOYAGES AUTOUR DU MONDE – VOYAGE DANS LES MERS DU SUD »
I - L’OUVRAGE
Page de titre de la publication de 1834
II - L’AUTEUR
Edmund FANNING (1769-1841)
Capitaine américain du navire de commerce « Betsey » à partir de juin 1797, époque à laquelle il quitte le Connecticut pour prendre la direction des côtes occidentales de l’Amérique du sud afin d’y chasser les otaries à fourrure pour en revendre ensuite les peaux en Chine. Le 19 janvier 1798, il fait escale à Masafuero dans l’archipel de Juan Fernandez au Chili ; il en repart le 5 avril de la même année, direction les Marquises.
Le trois-mâts Aspasia, de la même classe que le Betsey
LECTURES COMPLÉMENTAIRES :
III - LES MARQUISES SELON FANNING
Chapitre IX : Départ de Masafuero pour les Galapagos et les Marquises
*- Les notes entre parenthèses avec * sont de Jacques Iakopo Pelleau.
*- Les notes entre parenthèses sans * sont du capitaine Fanning.
*- Les nombres à trois chiffres entre parenthèses se réfèrent à la pagination de l’ouvrage original en anglais.
(118) (…)
Le 5 avril 1798.
Nous quittâmes Masafuero à 6 P.M. et mîmes le cap au N.O. afin d’attraper les alizés et de fixer notre route vers les îles Marquises. (118 à 122) (…)
Le 19.
Alizé léger d’est ; légère brume. À trois heures trente P.M., la vigie en haut du mât de misaine cria le « Terre ! terre ! » tant attendu ; il signala une île élevée, ronde et en forme de pain de sucre à une distance d’environ six lieues au S. O (* 29km) ; en nous approchant, nous constatâmes que c’était Hood’s Island (* Fatu Uku). À une distance de quarante-huit lieues (* 231 km) à l’est de cette île, nous croisâmes des troupeaux de cachalots et leurs compagnons de voyages habituels, le poisson au museau arrondi que les baleiniers nomment « black fish » (* probablement des dauphins globicéphales, toujours très nombreux dans les eaux marquisiennes). Le nombre de ces derniers alla croissant jusqu’à ce que (123) nous nous trouvions à une distance de l’île de trois lieues (* 14,5 km). À 5 P.M., nous avions La Domineaque en vue (* La Dominica, Hiva Oa) à une distance de sept lieues (* 33,7 km) à l’O.S.O. À 8 P.M., nous mîmes le navire vent debout, réduisîmes la voilure pour la nuit afin de nous maintenir du côté au vent de cette île.
Le lendemain matin à cinq heures, nous nous laissâmes porter vers le sud-ouest en direction de l’île ; une heure après, l’île de San Pedrie (* San Pedro, Moho Tani) était en vue au S.S.O. à une distance de cinq lieues (* 24 km). On dit que cette île est habitée par la plus belle des races de Naturels des îles du Pacifique Sud. À 8 P.M., nous avions La Christiana en vue (* Santa Cristina, Tahuata) à sept lieues (* 33 km) à l’O.S.O. quart ouest. Nous virâmes lof pour lof (* virer de bord vent arrière) dans l’intention de longer la côte nord-ouest de Hiva Oa ; quand nous nous trouvâmes face aux vallées, le vert feuillage des arbres fut un enchantement complet pour nos yeux qui en avaient été privés depuis si longtemps.
À 11 A.M., une pirogue double vint se ranger le long du navire avec à son bord onze Naturels. Nous mîmes alors en panne et certains d’entre eux grimpèrent jusqu’au plat-bord sur lequel ils se fixèrent s’agrippant au garde-fou ; rien ne semblait les inciter à venir sur le pont. Néanmoins (124), ils troquèrent sans attendre leurs noix de coco, &c, contre des clous et des taillons de cerceaux en fer (*). Cet échange ayant été très court, nous repartîmes vent arrière vers l’ouest en longeant la terre et, à midi, nous trouvions vers le milieu de l’île en nous maintenant à quelque distance ; notre latitude était de 9° 40’ sud.
(* En 1774, à son passage à Tahuata, le capitaine Cook avait ainsi distribué des taillons de cerceaux de barrique en fer que les Marquisiens ont rapidement utilisés comme lames d’herminette ; cette sorte de cadeau fut abondamment utilisée par les navigateurs suivants).
(125) CHAPITRE X - ESCALE AUX ÎLES MARQUISES ET WASHINGTON - TRANSACTIONS SUR PLACE
Réserve des Naturels – Difficultés à commercer avec eux – Leur prudence – Parfums de leurs vallées – Pénurie de nourriture chez eux – Arrivée à La Christiana (* Tahuata) - Visiteurs inattendus – Le Révérend William P. Crook – Ses déclarations concernant l’île – Un renégat italien – Les initiatives et les plans tordus de ce dernier – Protection accordée à M. Crook et à son ami – Leur évasion – Projets de capture du Betsey – Le chef quitte le Betsey avec ses cadeaux – Départ des îles Marquises – Nouvelle façon de manger du poisson – Arrivée aux îles Washington (* Les Marquises du nord-ouest) – Attitude hostile des Naturels – Danger imminent pour le navire et l’équipage – Échappée belle – Les noms autochtones des îles – Départ des îles Washington – Arrivée à Nuggoheeva (* Nuku Hiva).
Le 20 mai 1798 (* Au large de la côte nord de Hiva Oa)
Temps agréable, brise modérée. À 2 P.M., nous mîmes en panne face à une vallée couverte d’arbres à pains et de cocotiers. Trois pirogues parties d’un village tout proche vinrent nous rendre visite ; néanmoins, les Naturels n’apportèrent que peu d’articles à troquer : quelques anguilles, des poulpes et un petit poisson au gout douçâtre et plutôt déplaisant. Cela ne nous parut pas digne d’intérêt, et nous nous éloignâmes. À 5 P.M. nous mîmes de nouveau à la cape en face d’un autre village (126) duquel arrivèrent plusieurs pirogues dont deux seulement acceptèrent de se ranger le long du navire. Les Naturels de ces deux-là nous firent bientôt comprendre la cause de leurs craintes en nous expliquant par gestes qu’ils avaient peur de nos canons sur affut. On fit promptement disparaître la cause de leur émoi en rangeant les canons à l’abri de leur regard et en fermant les écoutilles. Ayant observé la manœuvre de loin, leurs compagnons vinrent immédiatement se ranger le long de notre flanc. Ils n’avaient pas, néanmoins, abandonné toute crainte, et continuaient à se méfier : malgré cela, nous parvînmes avec succès à obtenir quelques noix de coco et une sorte de « pudding » à base de fruit à pain (* Peut-être de la « popoi » ou du « poke ») ; ils échangèrent aussi leurs lignes de pêche contre des clous et des taillons de cerceaux de barrique en fer de quatre à cinq pouces de longueur (* de 10 à 13 cm). C’était le fer sous toutes ses formes qu’ils convoitaient avec ardeur ; les perles de verre et les bibelots ne les intéressaient pas. Quand on leur présentait de petits miroirs ou des boutons nacrés, ils les tournaient et les retournaient en tous sens, les examinant consciencieusement sous tous les angles avant de laisser partir leurs articles. Finalement, après avoir pesé le pour et le contre, ils nous rendaient les miroirs et pointaient le doigt en direction des cerceaux de fer.
Au coucher du soleil, après le départ de nos visiteurs (127), nous nous écartâmes de la côte sous petite voilure par vent de travers afin de maintenir notre position pendant la nuit. Par intermittence, des souffles de vent nous apportaient les senteurs de ces vallées verdoyantes : un vrai délice. Quelqu’un qui n’a jamais rien connu de tel peut à peine imaginer l’enchantement d’une telle sensation après de longs mois passés en mer ; une sensation qui se saisit de tout votre être et vous réanime le corps et l’esprit.
À l’aube, nous prîmes la direction de la côte. À 8 A.M., nous nous mîmes vent debout en face d’un village à partir duquel un certain nombre de Naturels vinrent très rapidement nous rendre visite dans leurs pirogues avec des articles de troc. Nos canons ayant été rentrés au préalable et les écoutilles fermées, il nous fut très facile de les amener à se ranger le long du navire. S’en suivirent alors des transactions vives et rapides ; on échangea des taillons de cerceaux de fer, des clous et des couteaux contre des noix de coco, des fruits frais, du poisson et des lignes de pêche. Après avoir troqué tout ce qu’ils avaient apporté, ils nous quittèrent et nous partîmes vent arrière ; à midi, nous avions la pointe nord-ouest de l’île au S.S.E. à une distance de deux lieues (* 9,6 km) et nous serrâmes au plus près en direction de La Christiana (* Tahuata).

Toute la journée du 21 fut employée à remonter le vent (128). Pendant la nuit, des rafales de pluie et des bourrasques de vent s’abattirent sur nous. À 8 A.M. nous nous trouvions à l’ouest de l’île de La Christiana, très proches du mouillage de Cook où nous avions l’intention de jeter l’ancre afin de procéder à l’entretien du navire, et de nous procurer des vivres frais et de l’eau douce. Plusieurs pirogues se rapprochèrent avec à bord un nombre de Naturels beaucoup plus important que ce que nous avions vus réunis auparavant. Cela me décida à mettre en panne, et les échanges s’opérèrent à nouveau avec entrain, mais les Naturels n’avaient rien à offrir qui fût différent des autres endroits : nous n’obtinrent que des noix de coco, des fruits à pain et de petits poissons contre lesquels ils voulaient de la poudre, des couteaux, des outils, des haches et des hachettes, &c. Je refusai de leur laisser toute la poudre en espérant qu’ils accepteraient d’apporter des porcs, et je mis un terme à l’échange des haches et des hachettes. Mais cela ne mena à rien, et j’en déduisis qu’avec la volaille, les porcins étaient une denrée rare sur l’île ; ce qui s’avéra plus tard être la réalité.
À ce moment-là, deux personnages arrivèrent dans une grande pirogue double et se rangèrent le long du navire ; à l’évidence, c’était des hommes influents et de haut rang vu le respect que les autres leur portaient, et la supériorité de leurs atours ; néanmoins, aucun (129) des deux n’était en possession de ce que nous convoitions. On nous fit rapidement comprendre qu’ils souhaitaient voir le navire s’ancrer plus avant dans la baie ; à la suite de quoi, nous fût-il promis, on nous fournirait en abondance des porcs et tout ce dont nous avions besoin.
L’attitude amicale de ces gens me porta à croire que nous pourrions leur demander de nous aider à piloter le navire jusqu’au havre ; mais après qu’ils soient restés à bord quelques heures pendant lesquelles nous nous étions acharnés en vain à remonter au vent afin de nous positionner sur le point de mouillage désiré, ils quittèrent le navire un peu après midi non sans avoir, au préalable, affiché des signes évidents de mécontentement, impatients qu’ils étaient de retourner à terre. Ce qui ne les empêcha pas, dans leur bousculade, de nous inviter par signes amicaux à venir sans attendre jeter l’ancre dans leur port.
Chaque proue des doubles pirogues de guerre était ornée de quatre crânes humains qui avaient tellement attiré notre attention que le chef nous proposa de les troquer ; mais comme ce n’était pas le genre de vivres frais que nous recherchions, nous refusâmes son offre. Tandis que nous tentions d’avancer, le vent se mit soudain à tourbillonner en rafales nous contraignant sans cesse (130) à carguer et à ferler les voiles à tour de rôle, ce qui nous fit perdre du terrain au lieu d’en gagner.
Le 22.
En plus des fortes rafales et bourrasques de vent de la veille, nous subîmes de très fortes averses de pluie vers 1 P.M. Ce détail était devenu pénible à supporter pour les Indiens qui nous entouraient ; ils ne tardèrent pas à se décider à retourner à terre. À 3 P.M., à l’occasion d’une éclaircie, on vit une petite pirogue s’approcher du navire en toute hâte ; elle semblait venir de la partie occidentale de l’île, tout au moins de l’ouest de la baie, et deux personnes seulement se trouvaient à son bord. Tous les Naturels venaient de nous quitter, et personne ne comprenait qui ces étrangers pouvaient-ils être. En raison de l’impérieuse nécessité dans laquelle nous étions de trouver un mouillage sûr dans la baie, si possible avant la tombée de la nuit, cela nous paraissait vraiment inconcevable de devoir mettre à cape afin de permettre à ces gens de s’approcher.
Alors que la petite pirogue se rangeait sur notre flanc, nous eûmes la grande surprise d’entendre une des personnes s’écrier dans notre langue maternelle : « Monsieur, je suis anglais et je viens vous conjurer de prendre ma vie sous votre protection. » Sur le coup, les mots ne suffisent pas à exprimer la surprise provoquée par une requête aussi inattendue (131). On se porta sur le champ au secours de l’étranger que l’on aida à grimper sur la coupée ; à peine eut-il posé le pied sur le pont qu’il lâcha : « Je suis missionnaire ». Il se laissa alors tomber sur un siège qu’on avait apporté pour lui sur la dunette (* pont ou gaillard d’arrière), et resta la tête inclinée pendant plusieurs minutes à rendre grâce à cet Être Céleste qui protège jusqu’au dernier des moineaux ; sans prêter attention à ceux qui l’entouraient, il ne paraissait préoccupé que par l’expression de sa reconnaissance à la Bonté du Créateur qui venait de lui rendre à nouveau sa liberté. Après avoir reçu l’assurance de se trouver parmi des amis chrétiens, il se ressaisit un peu et entreprit de nous raconter les péripéties de ces derniers jours sur l’île.
« Grâce soit rendue au ciel, Monsieur ! » m’exclamai-je en répondant à une de ses questions : « Vous voilà sain et sauf désormais. » Il se présenta alors comme étant le Révérend William Pascoe Crook que la London Missionary Society (* La Société Missionnaire de Londres/LMS) avait envoyé dans ces îles où, quelques mois plus tôt, le navire missionnaire le Duff du capitaine Wilson l’avait débarqué.
Il expliqua que l’attitude actuelle et récente des Naturels à son égard le préoccupait beaucoup depuis quelques semaines, et qu’en deux occasions, il ne dut son salut, outre la Grâce divine, qu’à l’intervention de son ami, le chef indigène qui l’avait accompagné à bord et qu’il nous présenta à ce moment-là (132) ; il souhaitait nous voir le garder à bord en attendant de le déposer en un endroit où il serait en sécurité.
Pour toute réponse, j’indiquai alors au Révérend que sa qualité d’homme d’église consistait une recommandation suffisante lui assurant d’être accueilli et logé avec tout le confort que notre navire pouvait lui fournir, et j’ajoutai qu’il pouvait s’y considérer comme chez lui et profiter de ma cabine comme il lui plairait jusqu’à notre retour à New York.
Après avoir présenté M. Crook à mes officiers, leur demandant d’être attentif à ses requêtes, je le conduisis avec son ami dans ma cabine où, une fois assis, je fis étaler ma garde-robe devant lui, lui demandant de choisir ce qui lui convenait. À ce moment-là, M. Crook était vêtu à la mode de l’île, c’est-à-dire qu’il ne portait qu’un « maro » (* terme tahitien désignant le pagne des hommes ; en marquisien « hami ») (une pièce d’étoffe confectionnée par les Naturels dont on s’entoure la taille ; une extrémité pend par devant et l’autre par derrière, après avoir été passées par-dessous la partie qui fait le tour de la ceinture). Ayant été constamment exposé au soleil, le reste de sa personne avait pris un teint aussi basané que les chefs, d’autant qu’il avait dû se conformer à ce style de vêtement depuis des mois (133).
À sa demande, on laissa la question des vêtements de côté en attendant qu’on puisse débarquer son ami le chef (Il ne trouvait pas judicieux de faire son choix ou d’accepter un vêtement long en présence du chef) (* peut-être parce que seules les femmes marquisiennes portaient de longs vêtements, pas les hommes…).
Ensuite, afin de m’éclairer sur les procédures à suivre pour les jours suivants, M. Crook me déclara qu’il lui fallait me communiquer des renseignements urgents concernant la situation sur l’île. Il était convaincu du danger extrême que nous courrions si nous nous approchions afin de jeter l’ancre, comme nous en avions l’intention. À cette nouvelle, je donnai immédiatement des ordres à l’officier en second afin d’interrompre nos manœuvres d’approche du mouillage.
Le Révérend nous raconta ensuite que, après le départ du Duff et du capitaine Wilson, qui l’avaient conduit jusqu’ici, un autre navire avait fait escale dans l’île pour faire des vivres, et qu’un renégat italien en avait déserté, s’était caché jusqu’au départ du navire et était resté sur l’île. En plus d’être doté d’un caractère persuasif, il avait profité de son évasion pour emporter avec lui un mousquet, une belle quantité de poudre et des balles qui lui ouvrirent rapidement (134) les faveurs du chef principal, allant jusqu’à devenir gestionnaire privilégié des affaires de l’île.
C’est à l’instigation de cet homme qu’avait débuté la guerre contre les Naturels de La Domineaque (* La Dominica, Hiva Oa) qui avait fait rage pendant quelque temps, avec la sauvagerie et la barbarie qui caractérise leur manière de mener ce genre d’hostilités. Il les avait aussi incités à combattre une autre tribu toute proche sur le territoire de laquelle résidait le chef qui avait conduit M. Crook à bord. Cette vallée se trouvait à une grande distance du port vers l’ouest ; c’est de là qu’ils étaient venus en pirogue, et avaient ensuite attendu fébrilement l’occasion propice pour mener à bien leur évasion jusqu’au navire.
Empreint de son devoir solennel envers Dieu et ses frères mortels, M. Crook avait exprimé à cet individu son désaveu concernant ses projets scélérats et iniques. Il s’était aussi tellement employé à l’empêcher d’entrainer les Naturels dans la poursuite de ses entreprises abominables que l’Italien lui était devenu farouchement hostile, plongeant ainsi M. Crook dans une détresse profonde. Cette haine pour ce dernier avait atteint un tel degré qu’il était parvenu à convaincre le grand-chef et les chefs secondaires (135) de profiter de la première occasion pour assassiner M. Crook.
Les Naturels étaient d’autant plus prêts à se soumettre au régime de l’Italien qu’il se trouvait en possession du mousquet, de la poudre et des balles, et que la formidable supériorité de cet engin sur leurs propres armes pendant les batailles les portaient à croire en son invincibilité. Il les avait persuadés qu’avec son aide ils pourraient non seulement vaincre toutes les tribus des deux îles (* Tahuata et Hiva Oa), les assujettir et leur faire payer tribu au grand-chef, mais qu’avec leur concours, ils pourraient, de surcroit, s’emparer de tous les navires faisant escale dans leur baie, les détruire et s’approprier tout le fer et les biens se trouvant à bord ; avant cela, néanmoins, il s’efforçait de les convaincre de la nécessité de massacrer M. Crook.
Tout au long de son séjour en solitaire parmi les Indiens, de par son comportement aimable et le soin qu’il portait à leur bien-être, ce monsieur s’était attaché l’affection de nombreux chefs, mais aucun d’entre eux ne lui était plus dévoué que l’ami qui l’avait conduit au navire. Cet homme se trouvait être le chef des guerriers, position qui lui conférait une grande influence et beaucoup de poids au sein de leurs conseils ; il était la main droite du grand-chef qui, seul dans la tribu, lui était supérieur. Il s’était souvent et courageusement opposé à ses compatriotes, mettant sa propre vie (136) en danger pour sauver celle de M. Crook qui était chaque jour confronté à des embuscades et à des traquenards que ces derniers, qui étaient le plus souvent des « amis », se chargeaient d’adapter sans cesse aux déplacements du Révérend afin de l’éliminer.
Dans l’impossibilité d’arriver à leurs fins iniques, et sachant que M. Crook et son ami connaissaient leurs projets, ils étaient sûrs que leurs espoirs de s’emparer du navire s’envoleraient si l’un des deux parvenait à monter à bord et dévoilait ce qui se tramait. Tôt le matin, ils avaient donc averti chacun d’entre eux que le grand-chef leur interdisait d’aller au navire (ce qui selon leur coutume équivalait à un tabou (* donc interdiction absolue sous peine de sanctions graves pouvant aller jusqu’à la mort)) et que serait lui, le grand-chef en personne, qui irait voir le capitaine.
Afin de s’assurer de leur obéissance à cette injonction, et de les garder à l’œil, le grand-chef avait envoyé à bord deux chefs secondaires dont l’un qui faisait la navette (sous des prétextes futiles) pour lui rendre compte, chez lui, de l’évolution de nos projets, afin de le conseiller et de lui faire des propositions.
Aussitôt que M. Crook et son ami eurent aperçu notre navire, ils restèrent à l’affut. Dès qu’ils se furent assurés du départ des quelques Naturels et des deux chefs secondaires longtemps restés à bord pour nous servir, entre autres, (137) de pilotes (nous savons maintenant que l’un était le subordonné de l’autre), ils saisirent l’occasion fournie par la forte averse de pluie pour se lancer sur les flots malgré le risque énorme de se faire assassiner ; sort qui eut certainement été le leur s’ils avaient été interceptés.
Il semble qu’une Providence toute particulière veillait sur nous et, j’avoue avec humilité qu’après coup, j’ai fustigé le comportement personnel qui m’avait conduit à me plaindre du retard pris par notre progression en raison des rafales et bourrasques de vent qui, en fin de compte, en nous empêchant d’avancer plus avant, furent l’instrument de notre salut. Nul doute en effet que si nous avions jeté l’ancre ce jour-là, les amarres du navire auraient été sectionnées et nous aurions tous été massacrés.
Notre navire aurait été leur première victime et, en raison de sa petite taille, il était la proie idéale ; il leur eut été, en effet, plus facile d’en venir à bout que d’un plus gros navire. Nous comprenions désormais la raison pour laquelle les deux chefs secondaires nous enjoignaient sans répit d’aller plus avant et de jeter l’ancre ; et aussi pourquoi les vivres se faisaient rares sur l’île.
En effet, le renégat avait totalement réussi à convaincre le grand-chef d’adhérer à la partie la plus importante du plan d’action (138) qui était en voie de réalisation ; la promesse de nous fournir des vivres en abondance alors que l’île se trouvait en période de pénurie, ce n’était là qu’une petite partie de ses plans infâmes.
Nous apprîmes alors la technique qu’ils espéraient employer afin de capturer notre vaisseau. La nuit venue, on enverrait des nageurs et des plongeurs munis d’une longue corde dont l’extrémité serait fixée aux supports du gouvernail afin de le bloquer, l’autre extrémité restant à terre. Ensuite, ils devaient sectionner les amarres d’ancrage sous la ligne de flottaison et, une fois cette opération effectuée, les autres Naturels auraient entrepris de hâler le navire jusque sur la grève.
Dans cette entreprise, l’Italien avait fait preuve d’un sang-froid monstrueux et d’une absence totale de sentiments humains. Il avait fait croire à ces gens que leur réussite serait totale et, craignant que le moindre vestige de cette forfaiture ne fût un jour dévoilé, il avait exigé que tout l’équipage soit éliminé et que le navire soit brûlé.
De la sorte, ils pensaient faire d’une pierre deux coups. Tout d’abord, faire disparaître toute trace du navire et de son équipage, et s’emparer de la totalité du fer et des articles qu’ils convoitaient. Ensuite, avec la poudre, les canons et les armes à feu (139), ils seraient en mesure de prendre possession du prochain navire qui jetterait l’ancre ; de surcroit, ils deviendraient plus puissants que les autres tribus qu’ils pourraient attaquer sans risque. Ils deviendraient alors les plus riches, les plus puissants et, sans aucun doute, les insulaires les plus illustres du Pacifique.
L’ensemble du plan leur paraissait d’une réalisation facile ; il dépendait aussi beaucoup des plongeurs et des nageurs, car seuls quelques Naturels maîtrisent ces activités. Le silence le plus profond devait régner afin d’éviter de se faire repérer par les gardes postés sur le pont du navire ; une fois le câble d’amarrage sectionné et le navire hâlé par l’arrière jusqu’à la grève, on leur avait fait croire que celui-ci se coucherait sur sa quille mettant ainsi hors d’usage les canons les plus gros, et que leur supériorité numérique leur permettrait de s’en rendre facilement maître.
Pris par la conversation, nous n’avions pas vu le temps passer ; le soleil allait bientôt se coucher, et le chef ami de M. Crook paraissait de plus en plus inquiet. Pour le Révérend, le moment était venu de lui annoncer qu’ayant trouvé l’occasion de rentrer dans son pays, il était de son devoir de la saisir, et qu’il ne pouvait donc pas retourner à terre avec lui. Cette nouvelle affligea grandement le chef (140) qui nous fit comprendre qu’il ne survivrait pas longtemps à cette séparation. Il était néanmoins conscient du danger encouru par M. Crook si celui-ci redescendait dans la pirogue, et il ne pouvait pas lui demander d’agir de la sorte. Dans quelques lunes, il espérait bien revoir M. Crook et le capitaine Wilson sur son île, quand les guerres auraient pris fin et que tout serait rentré dans l’ordre.
Très touché par l’affection que lui portait le chef, M. Crook lui répondit que, s’il plaisait au Ciel, il ne lui faudrait pas attendre très longtemps le bonheur de se serrer à nouveau la main. Afin d’éviter au prochain navire, aux autres à venir après lui et à leurs équipages le moindre dommage ou perte, M. Crook lui rappela en même temps la promesse qu’il avait faite d’avertir à temps les capitaines des dangers encourus à toucher cette île. Il jura d’être fidèle à sa promesse. (Plus tard, l’auteur apprit que, conformément à sa promesse, le chef avait donné au capitaine du Butterworth, le navire suivant, les renseignements lui ayant permis d’éviter le danger.)
Quand nous étions descendus dans ma cabine, j’avais retiré mes pistolets de mes poches et les avais déposés sur le buffet. Après en avoir minutieusement examiné la crosse, la détente et les barillets, le chef demanda à M. Crook à quoi ils servaient (141) et comment s’en servir ; les explications l’ayant satisfait, il exprima son désir d’en recevoir un comme cadeau. Bien que prêt à lui offrir un présent qui lui convienne, je n’avais pas l’intention de me séparer de mes pistolets, et je lui répondis que, comme toutes les armes, la poudre et les canons à bord du navire avaient été rendus tabou par le grand-chef de notre pays, et qu’on ne pouvait les sortir du navire ou les donner à quelqu’un. En raison du respect qu’ils portent à tout ce qui est tabou, le chef fut satisfait par cette explication et ne s’intéressa plus aux pistolets.
Je disposai alors, devant lui, un certain nombre d’articles des plus estimables : quelques haches, hachettes, couteaux, rasoirs et un assortiment de petits couverts ; pour compléter la sélection, j’ajoutai un paquet de perles de verroterie et des verres. Ayant demandé à M. Crook quel cadeau serait le plus apprécié, il ne voulut pas me donner son avis me laissant seul juge du choix ; il précisa néanmoins, qu’en présence d’une telle abondance de cadeaux, il était certain que le chef serait accueilli à bras ouverts à son retour (142) à terre, et cela malgré son rôle dans l’évasion de M. Crook.
Quand le chef apprit que tous ces biens allaient être descendus dans sa pirogue comme gage de son amitié envers M. Crook, et de la promesse qu’il avait faite de tenter d’éviter tout dommage aux prochains navires touchant l’île, il fut transporté de joie, se vantant d’être, désormais, le plus riche de sa tribu, plus même que le grand-chef auquel il pourrait déclarer fièrement que la présence parmi eux d’un homme aussi mauvais que le déserteur italien était la cause principale de tous leurs déboires : aussi longtemps qu’il serait là, jamais ils ne pourraient connaître paix, abondance et bien-être mais, au contraire, subiraient discorde, guerres sanglantes et conflits.
La séparation entre ces deux amis fut une scène touchante. D’un côté, un cœur capable d’apprécier les attentions dont il avait longtemps été l’objet, tout autant que les risques pris pour lui au cours de cette évasion ; de l’autre, un enfant de la Nature, doté de vertus et de sentiments dignes d’un être civilisé comprenant que celui dont il se séparait était le seul homme à s’être jamais inquiété de son bien-être dans l’éternité de l’au-delà, lui ayant enseigné combien peu les choses de ce monde ici-bas comptaient en comparaison de celles d’outre-tombe.
Quand il se fut éloigné d’environ cinquante mètres du navire, le chef s’arrêta de ramer et, à l’intention de M. Crook, s’écria que celui-ci devait revenir dans quelques lunes au plus tard faute de quoi il ne vivrait pas assez longtemps pour le revoir ; puis, après avoir brandi sa rame en signe d’amitié, il reprit la direction de son île.
M. Crook m’apprit qu’i existait un autre archipel comprenant quatre îles récemment découvertes par un de nos compatriotes venant de Boston (* Ingraham, en avril 1791) ; il ajouta qu’elles se nommaient les îles Washington, et qu’elles se situaient au nord-ouest de celle sur laquelle nous nous trouvions. Il nous recommanda chaudement de nous y rendre immédiatement car, ayant appris que leur langue était très similaire à celle parlée aux îles Marquises (* les 3 îles du sud-est) dont il était familier et qu’il parlait couramment, il était certain de pouvoir aussi comprendre et parler celle de ces nouvelles îles, et de nous servir d’interprète dans nos démarches d’approvisionnement en eau douce et (144) en vivres frais qui nous faisaient tant défaut. Et c’est ce qui se passa par la suite.
Ne voyant aucune possibilité d’obtenir du ravitaillement sur place, je donnai consigne de préparer le navire à mettre le cap sur les îles Washington. Après le départ de notre ami le chef, nous redescendîmes dans ma cabine où je priai à nouveau M. Crook de choisir quelques vêtements parmi ceux que j’avais sortis pour lui car, depuis qu’il était monté à bord, il avait gardé sa tenue locale ; après m’avoir remercié à plusieurs reprises, il accepta ma demande avec joie.
Dans la période où le navire se trouvait un peu au large de Resolution Bay, et que les Naturels l’entouraient en grand nombre, nous avions remarqué que certains capturaient des poissons de quatre ou six pouces de longueur (* 12/18cm), et qu’après en avoir arraché la tête d’un coup de dents, ils les mangeaient aussitôt entièrement par petites bouchées. J’en parlai à M. Crook lui demandant s’ils n’avaient pas l’habitude de cuire leur poisson. Il répondit qu’ils le cuisaient quand il s’agissait de grosses pièces, et quand ils avaient de la nourriture en abondance mais que, en raison des guerres et de la famine actuelles, ceux que nous avions vus n’étaient pas en mesure de le faire. Il ajouta (145) qu’en période de disette, il avait été lui-même obligé de se plier à une telle pratique ; d’autant plus obligé, expliquait-il, que s’il n’avait pas mangé son poisson sur le champ, on le lui aurait arraché des mains. Il ajouta qu’une fois, il avait trouvé délicieux un de ces poissons mangés crus. Il termina en disant que la famine poussait parfois les Naturels à se tourner vers leurs ennemis pour les capturer afin de s’en nourrir ; c’était une coutume inhumaine et horrible à laquelle il lui avait été impossible de mettre un terme.
Le 23 mai
Depuis notre départ des îles Marquises, nous n’avons cessé d’être balayés par de fortes averses de pluie venues du sud-est entrecoupées d’accalmies. À 1h00 P.M., l’île la plus méridionale des îles Washington était en vue à une distance de cinq lieues (* 25km) vers l’ouest (* Ua Pou). À 3h00 P.M. nous aperçûmes l’île la plus orientale au nord-est (* Ua Huna) et, une demi-heure plus tard, était en vue l’île la plus septentrionale et aussi la plus étendue des îles de cet archipel au N.O. ½ O à une distance de huit lieues environ (* 40km) (* Nuku Hiva). Nous mîmes le cap sur l’extrémité orientale l’île la plus au sud et, à 9h00 A. M., alors que nous longions sa côte nord portés par une belle brise, plusieurs pirogues s’en détachèrent, certaines très grandes, d’autres plus petites, qui vinrent à notre rencontre. (146)
Côte nord de Ua Pou – Service de l’urbanisme de Polynésie française -
Document de travail PALIMMA 2014 – Pierre et Marie-Noëlle OTTINO
Ces grandes pirogues doubles étaient semblables à celles observées à La Christiania, principalement à celle qui avait conduit le grand-chef à bord. Tout comme pour cette dernière, leurs proues étaient ornées de nombreux crânes humains à propos desquels M. Crook déclara qu’ils provenaient des ennemis que leur chef, propriétaire de la pirogue, avait tués au cours de batailles.
Je fus satisfait de constater que M. Crook était en mesure de converser avec ces gens aussi couramment qu’avec les Marquisiens, leur langue étant presque identique. Ils avaient l’air surpris d’entendre M. Crook parler leur langue, et ils étaient très désireux de connaître l’endroit où il l’avait « attrapée » selon leur propre expression ; ils voulaient savoir d’où il venait pour être ainsi capable de parler comme l’un des leurs. Lorsque M. Crook demanda s’il y avait un port dans leur baie, les chefs répondirent par l’affirmative mais, malgré la présence de quelqu’un parlant leur langue, il nous fut impossible de les convaincre de monter à bord. Les tas de pierres rondes (* pour les frondes), les massues de guerre et les lances se trouvant à bord des pirogues nous donnaient à croire qu’ils étaient armés en force.
Nous nous présentâmes alors à l’entrée de la baie (* la carte ci-dessus et les détails donnés plus loin (le récif de corail) indiquent qu’il s’agit probablement d’Aneou) mais, à peine avions nous doublé la pointe (147) qui en marque l’entrée que le vent tomba et qu’une forte houle nous porta à l’intérieur de la baie ; pendant ce temps-là, nous nous efforcions de continuer le troc avec les Naturels restés dans leurs pirogues. En échange de leurs produits, nous leurs offrions des jouets, des verres, des perles de verroterie, des boutons, &c. mais ils refusaient notre fer avec le plus grand des mépris.
Il semblait que ces gens n’avaient reçu la visite, ou jamais vu, d’être civilisé auparavant. Contrairement aux autres insulaires, ils ne manifestaient non plus aucune envie d’obtenir du fer, même lorsqu’on offrait une hachette contre une seule noix de coco, alors qu’ils se précipitaient pour l’échanger contre un bouton nacré. Nous fûmes aussi surpris de constater que rien de ce que nous possédions n’avait, à leurs yeux, plus de valeur que les éclats de vaisselle et de porcelaine cassée conservés à bord par le cuisinier.
À la longue-vue, on voyait le ressac se briser sur le récif de corail qui borde cette baie ; je fis alors remarquer à M. Crook que le navire s’était si avancé dans la baie qu’il nous était nécessaire de demander aux chefs des précisions sur le mouillage dans leur port, et sur la profondeur de l’eau. À ses questions, ils répondirent que nous devions aller plus avant (148), jusqu’au niveau de l’endroit où ils remontaient leurs pirogues. Quant à la profondeur, ils déclarèrent que la baie était sans fond à l’extérieur du récif mais, qu’à l’intérieur du récif de corail, il y avait une belle plage sur laquelle ils avaient coutume de hâler leurs pirogues.
Il nous était devenu urgent de découvrir ce port. Sans perdre de temps, je fis armer un des canots afin de tourner le navire la proue face à la houle. Quand cela fut fait, le canot maintint le cap vers la sortie de la baie tandis que j’envoyais un second canot en sonder l’intérieur. Cette opération se poursuivit quelque temps sans que l’officier qui le commandait ne lance aucun signal, preuve qu’il avait trouvé un bon mouillage. Quant au premier canot, il s’était contenté de maintenir la proue du navire face à la houle, qui lui rendait impossible toute progression.
Pendant ce temps-là, les Naturels affluaient dans la baie, et de nombreuses pirogues apparaissaient au sortir des promontoires rocheux qui en marquent l’entrée ; d’autres venaient de différentes parties de l’île et certaines se rassemblaient autour du canot chargé de sonder. En peu de temps, la baie en fut remplie, tout particulièrement les alentours du navire (149).
M. Crook se tenait en permanence à mes côtés, et son attitude me porta soudain à croire que quelque chose le tracassait. L’explication ne tarda pas : à voix basse, il me fit comprendre que d’après les conversations entendues parmi les Naturels de plusieurs pirogues, et aussi de par leurs exclamations, il estimait que leurs desseins n’étaient pas pacifiques et que, si autant de pirogues s’étaient positionnées entre le navire et le canot chargé du sondage, c’était apparemment dans le but de l’isoler en lui coupant son câble de remorquage à son retour vers le navire. Je jugeai alors plus prudent de faire relever les écoutilles et sortir les canons qui avaient été chargés au préalable.
On lança aussi au second canot le signal de retourner au navire et, afin de lui ouvrir un passage, je fis décharger un mousquet au-dessus de la tête des Naturels de manière à ce qu’ils entendent le sifflement de la balle et qu’ils voient les éclaboussures au moment où elle ricocherait à la surface de l’eau ; en même temps, je fis apparaître les canons dans les écoutilles. L’effet escompté fut atteint car ils s’écartèrent sur le champ, laissant la voie libre à notre canot que nous eûmes la satisfaction de voir se ranger sans encombre le long du navire.
C’est alors que les conques de guerre retentirent, accompagnées de volées de hurlements assourdissants. M. Crook s’adressa (150) aux chefs les plus proches leur conseillant de se maintenir à bonne distance du navire et de faire en sorte que nul ne se serve de ses lances. Il leur rappela les effets produits par le mousquet sur les pirogues se trouvant sur la route du canot, et leur expliqua ce à quoi ils devaient s’attendre si les gros canons se mettaient à cracher leur tonnerre de feu, c’est-à-dire à voir la totale destruction de leur flotte et de leur île. Pointant du doigt les canons qu’on venait de sortir, il ajouta que le capitaine était fermement décidé à décharger leur tonnerre de feu afin de les éliminer et de détruire leur île.
Après avoir manifesté leur étonnement face à une telle démonstration de force, ils s’exclamèrent que le navire devait sûrement venir des nuages. À la suite de quoi, ils s’éloignèrent bientôt à une distance plus respectable, sans cesser pour autant de souffler dans leurs conques de guerre. Lorsque les chefs les plus proches du navire aperçurent la lame d’un sabre étinceler sous les rayons du soleil, ils s’écrièrent que, vu son éclat, cette arme devait venir de l’astre solaire lui-même.
L’officier chargé de sonder la baie rapporta qu’il n’avait pas trouvé le fond à une profondeur de cinquante brasses (* 91.4m), à une distance de câble du récif. Comme le canot ne parvenait pas seul à remorquer le navire, un second fut envoyé (151) à sa rescousse, et nous sortîmes les avirons de galère (* des avirons plus larges) pour leur venir en aide. Parfois, il nous arrivait de gagner un peu de terrain et de tirant d’eau sur la forte houle mais, quelques minutes plus tard, un train de déferlantes nous heurtait et, en dépit de tous nos efforts, nous repartions en arrière au lieu de continuer notre avancée. Les insulaires s’étaient groupés sur la grève tout autour de la baie, sur les rochers dominant le récif de corail, et des centaines d’entre eux se trouvaient encore dans leurs pirogues. Ils ne quittaient pas de yeux le navire observant tous ses mouvements contraires et, à chaque fois que celui-ci repartait en arrière, ils ne manquaient pas de lancer un hurlement terrible qui résonnait par toute la baie.
Après avoir passé plusieurs heures à déployer des efforts laborieux mais nécessaires ; après avoir, à force d’acharnement, progressé d’un peu plus d’un mille (1.8km), alors que, malgré son entrain et sa détermination, notre équipage se trouvait au bord de l’épuisement, nous reçûmes la bénédiction d’une légère risée provenant du promontoire est de la baie. Sans perdre une seconde, les voiles se trouvèrent bordées afin d’en profiter au maximum. Peu après, le navire s’ébranla, se mit en mouvement et finit par se sortir de ce mauvais pas. Nous nommâmes cette baie « Escape Bay », « La Baie de l’Échappée Belle », car nous nous en étions sortis de justesse (152).
La Providence venait à nouveau de nous manifester sa Bonté en préservant du danger nos vies et notre navire. Je suis tout aussi redevable au Révérend Crook qui resta en permanence à mes côtés, toujours prêt à m’avertir lorsqu’il pressentait les mauvaises intentions ou les manœuvres hostiles des Naturels. Tout au long de cette mauvaise passe, l’équipage fit preuve d’un ordre et d’une discipline exemplaires : pas de murmures de mécontentement, pas de défiance envers les officiers ; en dehors des ordres donnés et des réponses apportées, le silence régnait sur le pont. C’est à toutes ces raisons que nous devons notre salut ; j’en suis profondément convaincu. Notre navire était petit et relativement facile à manœuvrer ; eût-il été plus grand et plus lourd que nul acharnement ou artifice humain n’auraient pu ni préserver la vie de l’équipage, ni le sauver de la destruction qui nous avait si farouchement menacés.
En raison de la configuration géographique et de la forte houle, il n’eût pas fallu plus de la moitié du temps nécessaire à notre salut pour que le navire ait été indubitablement jeté sur le récif et réduit en pièces par la puissance des brisants ; la catastrophe prenant fin (153) avec le massacre des malheureux qui auraient nagé jusqu’à la côte.
Il est probable que, nous étant trouvés dans la même situation que le très célèbre et regretté La Pérouse et ses deux grandes frégates, nous ayons subit le même sort funeste que lui. La risée qui nous permit de nous échapper ne s’étirait pas, sur le coup, à plus de cinquante mètres derrière le navire. Il était très réconfortant de constater que les hommes d’équipage eux-mêmes avaient compris que leur survie dépendait de la bonté d’un Être qui avait daigné leur porter assistance ; ils s’agglutinaient autour du Révérend Crook, et l’honnêteté de leur cœur paraissait le prier de rendre grâce avec force au Tout-Puissant.
Notre première impression que cette île n’avait pas été visitée avant nous fut renforcée par le fait que nous n’observâmes aucune trace de fer ou de verroterie parmi les Naturels ; en dépit de leurs nombreuses échanges verbaux, M. Crook (154) ne put, non plus, conclure qu’ils avaient rencontré des êtres civilisés auparavant. Néanmoins, il s’était enquis auprès de certains chefs du nom de leur île et l’avait écrit dans le livre de bord du navire. Conformément à leur prononciation, cela donne Hooapoah ou Wep’oo (* Ua Pou) ; le nom de l’île la plus à l‘est est Hoo-a-ho’o-na (* Ùahuna/Ua Huna). L’île la plus au nord, alors en vue du navire, et aussi la plus étendue de l’archipel se nomme Nug-go-hee-va (* Nuku Hiva) ; celle qui se trouve la plus à l’ouest et qui est aussi la plus petite se nomme Fet-too-e’e-va. (* Il veut dire Hatu Iti, l’îlot qui se trouve à quelques miles au nord-ouest de Nuku Hiva ; Fatu Iva est l’île la plus méridionale, à plus de 150km au sud-est de l’endroit où ils se trouvent.)
Notre réserve d’eau douce se trouvant alors extrêmement réduite, nous étions dans l’obligation impérieuse de nous approvisionner. En raison de l’hostilité patente des Naturels, il était hors de question d’imaginer pouvoir mener à bien une telle opération sur cette île.
En tout état de cause, décision fut prise de profiter de la nuit pour remonter vers la côte sud de la grande île de Nuku Hiva en louvoyant ; une fois les voiles bien bordées, nous mîmes le cap plein nord portés par l’alizé et, à l’aube (155), nous nous trouvions à deux lieues (* 10km) au sud de Nuku Hiva, mais bien au large de sa pointe ouest. Il nous fallut donc remonter face au vent le long de la côte à la recherche d’un havre ; heureusement, la brise était régulière et la mer, calme. (156)
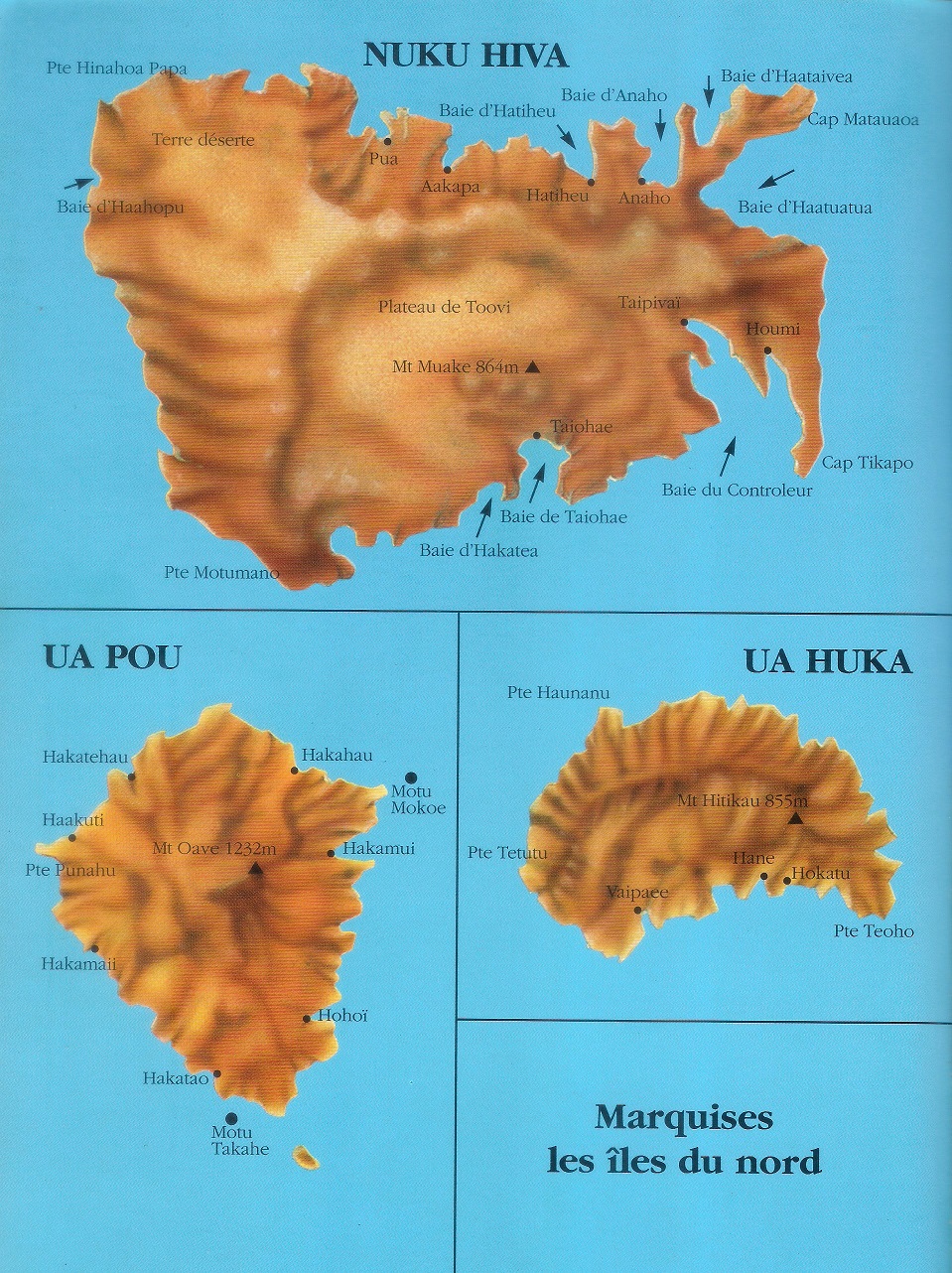
CHAPITRE XI - TRANSACTIONS DIVERSES PENDANT NOTRE SÉJOUR À Nuku Hiva
Refus des Naturels de monter à bord – Méthodes de commerce avec eux – Timidité d’un vieux chef – Projets de le faire monter à bord et succès de l’entreprise – Présentation de présents en signe de paix – Le vieux chef visite entièrement le navire mais n’est pas rassuré pour autant – La confiance vient finalement avec le cadeau d’un tricot – Cadeaux offerts par le roi – Nouvelle visite du vieux chef Tearoroo accompagné du régent – Tabou appliqué après requête – Le remède du régent contre un mal mineur – Acceptation d’un second tabou – Le Révérend Crook passe une nuit à terre – Acceptation d’une invitation à rendre visite au roi – Arrivée d’otages à bord – Accueil à terre – Ordre de marche – Une curieuse manœuvre – La frayeur du pauvre cuisinier – Arrivé à la résidence royale et sa description – Le jeune roi et la reine-mère – Cérémonie de présentation – Présentation de la plaque – Joie des invités – Interruption inattendue de la cérémonie – Retour au navire – Perte de notre boussole volée dans ma cabine – Sur intervention du roi et du régent, restitution de l’objet réduit en pièces – Un groupe d’une cinquantaine de dames de la cour visitent le navire accompagnées de quelques chefs – Leur départ – Le navire quitte la baie de Paypayachee (* Paepaeaki) – Le régent refuse de quitter son ami – Quelques détails sur les habitants – Leur comportement et leur coutume – La vallée de Tiuhoy (* Taiohae) – Quelques remarques sur la baie de Paepaeaki.
Le 25 mai 1798
Nous nous efforçâmes de maintenir le navire le long de la côte en direction de l’est. Quand nos virements de bord nous menaient près du rivage, des Naturels qui avaient pris la mer dans (157) quelques pirogues, se rapprochaient de nous à portée de voix. Quoique sur leurs gardes, ils paraissaient très sociables, posant les questions qui leurs paraissaient nécessaires, et répondant aux nôtres dans la mesure de leurs possibilités.
Le Révérend Crook leur ayant demandé si un port se trouvait à proximité, ils répondirent sans hésiter par l’affirmative, répétant que c’était un très bon port et que c’était là qu’ils remontaient leurs pirogues. Nous comprîmes à ce moment-là que, pour eux, un port, c’était l’endroit où les pirogues pouvaient être hâlées à terre. Il en avait probablement été de même à Ua Pou ; quand les chefs nous disaient qu’ils avaient un bon port, ils voulaient dire qu’ils avaient une belle plage sur laquelle on pouvait remonter facilement pirogues et canots. C’est à cause de notre incompréhension mutuelle que nous nous étions mis en grande difficulté, et non pour de supposées mauvaises intentions de leur part : ils considéraient comme un port tout endroit sur lequel on pouvait remonter une pirogue.
En dépit du drapeau blanc arboré en signe de paix, que les Naturels percevaient comme tel, et malgré les invitations lancées par M. Crook, aucun d’entre eux ne s’aventura à monter à bord. Considérant la longueur des échanges verbaux avec le Révérend, il était clair qu’ils se comprenaient ; (158) néanmoins, ils se maintenaient à portée de voix, et aucune pirogue ne vint se ranger contre le navire, bien que nous ayons pris soin de rentrer les canons et de fermer les écoutilles. En raison de leur défiance, il nous fallut poursuivre nos opérations de troc à une distance qui les rendait malcommodes. Nous attachions au bout d’une ligne ce que nous voulions écouler, et nous le lancions sur la proue des pirogues ; une fois examiné le lot, ils nous renvoyaient promptement des articles correspondant à leur estimation. Achat et vente furent brefs et de peu d’importance. Ce comportement aussi réservé, nous avions du mal à nous l’expliquer : il ne concernait pas seulement ce groupe de Naturels mais bien d’autres encore.
À 11h00 A.M., alors nous nous trouvions en face d’une baie (* probablement Haèotupa/Haaotupa/La baie Collet ; voir la suite immédiate) dont l’aspect nous portait à croire que nous avions enfin trouvé un port, trois pirogues s’approchèrent du navire, chargées de noix de coco, de fruits à pain et d’autres articles ; cependant, en dépit de nos encouragements répétés et des stratagèmes déployés afin de faire monter ces Naturels à bord, rien ne put les convaincre. Ils nous firent comprendre que notre navire n’était pas le premier qu’ils voyaient, ce qui fut confirmé par le collier porté par un des rameurs, qui était orné de quelques perles de verroterie finement polies (159) et soigneusement fixées sur une dent de cochon.
Nous étions sur le point de descendre un canot afin d’apprécier la commodité du mouillage à proximité du navire lorsque la vigie s’écria qu’il venait juste d’apercevoir ce qui ressemblait à l’entrée d’une plus grande baie, un peu plus à l’est. Grimpant dans la voilure, je sortis ma longue-vue et constatai que s’offrait à nous une opportunité plus favorable que celle que nous nous apprêtions à explorer.
En conséquence, après avoir pris congé des Naturels en y mettant les formes, nous nous séparâmes et virâmes de bord pour nous éloigner de la côte et nous rapprocher de l’autre baie, une manœuvre qui fut parfaitement réussie. Une heure après midi, alors que le navire pénétrait dans la bouche de cette baie, nous vîmes arriver une grande pirogue venant à notre rencontre depuis la grève ; à son bord se trouvait un vieux chef aux cheveux blancs et bouclés, ce qui lui donnait un air vénérable et pittoresque. Cette pirogue contenait aussi une trentaine de rameurs. Le vieil homme agita un drapeau blanc et une branche de verdure ; en retour, nous répondîmes à ces marques de paix et d’amitié en déployant un drapeau blanc (160). Nous renonçâmes aussi à descendre un canot, persuadés que nous étions, d’obtenir du vieux chef tous les renseignements dont nous avions besoin. Mais, rien n’y fit ; nous ne pûmes le convaincre de venir se ranger contre le navire.
Il fit le tour du navire à plusieurs reprises, restant à une distance de quinze ou vingt mètres, et prenant bien soin de ne pas s’en approcher ; à la suite de quoi, le vieux chef se lança dans une démonstration oratoire du cru dont le but était de nous convaincre d’accepter l’invitation cordiale du roi à nous rendre à terre. Après avoir attendu avec une extrême patience qu’il ait terminé son discours, et mis un terme à ses déplacements, nous étions épuisés, bien que cela puisse paraître grossier de le signaler.
Je donnai alors l’ordre de faire descendre un canot, et informai le Révérend Crook de mon intention d’user de stratagème pour parvenir à faire monter le vieux chef à bord en prenant garde, évidemment, d’éviter tout problème ou toute péripétie malencontreuse. Je lui demandai aussi d’apporter son aide à la réalisation de ce plan en prenant place dans le canot à côté de l’officier ; il s’empressa d’accepter. L’officier reçut alors trois consignes : en premier, il devait sonder la baie (161) afin de trouver un mouillage convenable ; au cas où la pirogue le suivrait, il devait faire semblant de ne pas la remarquer mais, une fois les opérations de sondage terminées, il devrait saisir la première occasion qui se présenterait pour positionner son canot, qui était d’une grande maniabilité, le long de la pirogue, puis s’emparer du chef et l’amener à bord sans lui porter préjudice.
Un fois le canot mis à la mer et armé d’un équipage choisi, M. Crook descendit s’assoir près de l’officier tout en continuant de converser avec le vieux chef ; alors, le canot s’éloigna et prit la direction de la baie. Comme prévu, à peine les hommes eurent ils donné quelques coups d’aviron que la pirogue se lança dans son sillage, à quelques encablures de distance. Afin de mener à bien sa mission, le canot se trouvait dans l’obligation de faire des allers-retours dans la baie, la traversant et la retraversant à maintes reprises, de telle sorte qu’il se rapprochait de plus en plus du bord. Ce voyant, les Naturels perdirent toute défiance et, serrant le canot de près, finirent par mélanger leurs rames avec les avirons tandis que M. Crook continuait sa conversation amicale avec le chef. Cette situation perdura de manière spontanée jusqu’à ce que l’officier ait terminé les opérations de sondage (162) et lance le signal au navire qu’il avait trouvé un mouillage convenable. Constatant que la pirogue se trouvait à moins d’une douzaine de mètres de distance, l’officier fit passer le mot à l’équipage qui se tenait prêt et, en un clin d’œil, le canot se propulsa le long de la pirogue ; la manœuvre fut si rapide, et les Naturels si surpris, qu’ils sautèrent tous à la mer abandonnant le pauvre chef, tremblant de peur, le laissant se sortir seul de cette situation inattendue.
M. Crook s’empressa de lui expliquer que le capitaine, grand-chef du navire, l’invitait à monter à bord afin qu’il saisisse rapidement que nous étions amis. On lui fit aussi comprendre de ne pas s’inquiéter ; on lui indiqua qu’il n’avait rien à craindre et qu’il ne lui serait fait aucun mal. Rassuré, le vieux chef répondit qu’il voulait bien monter à bord mais qu’il lui fallait, au préalable, déposer sur le pont une branche de verdure et un porcelet ; c’était, disait-il des signes de paix qui, une fois acceptés par le grand-chef du navire, seraient la preuve de notre amitié. M. Crook lui expliqua que nous comprenions cette coutume et que nous acceptions ces cadeaux.
M. Crook remonta dans le canot suivi du (163) chef dont l’esprit était toujours agité de craintes et de doutes ; il prit place entre M. Crook et l’officier. Ses craintes se dissipèrent quelque peu lorsque, à l’invitation de M. Crook, son regard se tourna vers le navire qui se rapprochait à faible allure, sous voilure réduite ; en effet, aussitôt que l’équipage eût compris que le canot avait trouvé un mouillage convenable, nous avions pris sa direction, vent arrière toute.
Quand le canot fut tout proche, nous mîmes en panne afin de permettre au chef de monter à bord ; M. Crook me demanda de prendre possession de la branche et du porcelet afin de calmer les craintes du chef, et d’assurer au mieux nos liens d’amitié. Je reçus donc le vieux chef à la passerelle où il me remit d’abord la branche de verdure accompagnée de quelques mots ; après quoi, il fit de même avec le porcelet. Une fois sur le pont, il insista pour me rendre hommage à genoux mais, tout en le relevant et en le conduisant à un siège sur le gaillard d’arrière, je lui expliquai que, dans mon pays, ce n’était pas la salutation qui seyait à des amis ; à des amis désormais assis l’un à côté de l’autre, ajoutant que je n’étais rien d’autre qu’un chef comme lui. Néanmoins, dit-il, selon la traduction de M. Crook (164), il y a une différence entre nous : vous venez du tonnerre des nuages et vous êtes donc plus puissant que mon roi lui-même.
Lorsque les Naturels virent que nous nous étions éloignés sans nous préoccuper de leur pirogue, ils remontèrent immédiatement dedans et nous suivirent, en prenant soin, toutefois de ne pas trop s’approcher du canot. Après avoir envoyé ce dernier à bonne distance en avant du navire afin de sonder, nous nous mîmes dans son sillage et passâmes entre les deux gros îlots circulaires que nous nommâmes les Sœurs en raison de leur similitude. *(Motunui à l’ouest et Mataùapuna, à l’est). Nous entrâmes alors dans une vaste baie baignant une plage sur son côté oriental en face de laquelle nous jetâmes l’ancre par vingt brasses de fond : un très beau mouillage et une côte bien dégagée. (* Probablement, au large du petit-quai actuel de Taiohae, face à la plage de Vainahō.)
Le vieux chef, M. Crook et moi-même étions retournés sur le pont après avoir parcouru toutes les parties accessibles du navire en expliquant la fonction et le fonctionnement de notre armement, et en détaillant le mobilier de la cabine ; bref, bien que nous ayons tout expliqué au vieux chef afin de nous attacher sa confiance, nos efforts restaient sans effet. Le Révérend Crook avait remarqué que mon écharpe avait capté (165) l’attention du chef et il m’en fit part : c’était un court tricot de flanelle rouge avec des franges de la même couleur. Je m’en défis sur le champ et le donnai au chef qui, paré de la sorte, perdit soudain toute retenue ; subitement transporté de joie, ce n’était plus le même homme. Arborant sa superbe acquisition, il remontait et descendait ainsi le pont, se pavanant d’une manière vraiment cocasse. Il se rendit ensuite à l’arrière d’un pas martial afin d’exposer sa personne ainsi chamarrée aux rameurs qui étaient dans la pirogue, et qui nous avaient suivi tout en restant à quelques encablures de la poupe (* À cette époque-là, la couleur rouge était l’apanage des chefs, raison pour laquelle l’attention du chef avait été attirée par l’écharpe du capitaine Fanning).
Les rameurs riaient à gorge déployée ; la pantomime de leur chef les emplissait d’une joie qui les mettait d’une humeur beaucoup plus sociable. À l’exception de deux hommes qui restèrent dans la pirogue, tous grimpèrent à bord après que le chef leur eût demandé de se rapprocher le long du navire. Pendant ce temps-là, passant de l’admiration répétée de son cadeau à la présentation maintes fois renouvelée de son statut social et de sa bonne volonté à notre égard, nous finîmes par apprendre qu’il était le grand-père du jeune roi et qu’au retour d’une ambassade aussi couronnée de succès, il serait comblé de porcs, de fruits à pain, d’ignames, etc.
Tout au long de ces péripéties, la pirogue mentionnée fut la seule visible (166) dans toute la baie jusqu’au moment où nous en vîmes s’approcher deux grandes autres en provenance de la partie ouest de la baie. (* Au large des vallées Meàu et Hōata où demeuraient la famille des chefs.)
Tandis qu’elles se portaient sur notre flanc, nous découvrîmes les cadeaux envoyés de la part du jeune roi : quatre porcs bien gras, des fruits à pain, des noix de coco, des ignames, des bananes, de la canne à sucre, etc. Pour le remercier, nous lui fîmes parvenir deux haches, des hachettes, des ciseaux à bois, des miroirs, des boutons de nacre et des perles de verroterie. À notre nouvel ami, le vieux chef, en récompense de ses services, nous offrîmes une hachette, un couteau, des taillons de cerceaux de barrique, des hameçons, des clous et des perles de verroterie ; nous n’oubliâmes pas, non plus, les deux autres chefs qui nous avaient apportés les cadeaux du roi et nous les remerciâmes de manière adéquate.
À ce stade-là, nous manquions cruellement d’eau douce ; il nous devenait crucial de voir si nous pouvions nous en procurer à l’entour. À la requête de M. Crook, le vieux chef nous expliqua que la rivière « la plus grosse » se trouvait à proximité du village du roi, dans la partie ouest de la baie ; il poursuivit en disant qu’il serait heureux de nous y accompagner si c’était notre souhait. Nous acceptâmes d’emblée cette proposition et, après avoir fait ferler les voiles, je fis descendre dans le canot deux tonnelets cerclés de fer (167) et des bricoles destinées au troc ; le Révérend Crook s’étant porté volontaire pour accompagner le groupe, le vieux chef grimpa dans sa pirogue et les deux embarcations s’éloignèrent en restant côte à côte.
Une fois les tonneaux remplis, ils revinrent en expliquant que l’aiguade était un magnifique petit cours d’eau ; néanmoins, en raison des gros rochers bordant la grève (* Taìeve, les rochers se trouvant aux pieds du tohua Temehea, de nos jours), ils n’avaient pas pu accoster et avaient dû ancrer le canot à un grappin puis, après avoir empli et bouché les tonnelets, ils avaient dû traverser le ressac à la nage en les tirant afin de les rapporter au canot. Ils trouvèrent les Naturels très amicaux et impatients de se montrer utiles ; nombres d’entre eux se portèrent volontaires pour pousser les tonneaux jusqu’au canot.
Ils étaient tout aussi nombreux à se prélasser dans la rivière, et il y en avait autant à nager autour du navire. Certains faisaient quelques brasses, puis s’agrippaient à la coque pour reprendre leur souffle ; suspendus à ses flancs, on eût dit une volée de merles accrochée à un arbre. D’autres, restés dans leurs pirogues, se satisfaisaient d’observer cet étrange vaisseau dans sa globalité, mais à une distance raisonnable ; les commentaires enjoués fusaient de leurs bouches à qui mieux mieux. Mettre un frein à cette proximité désormais établie allait s’avérer aussi difficile que de l’instituer (168) et, dans ces circonstances, je jugeai plus prudent de n’admettre à bord que les Naturels connus pour être au service des chefs.
Afin de trouver les termes d’un arrangement nous permettant de faire le plein d’eau douce, le Révérend Crook se rendit à terre dans le canot avec l’intention de retrouver notre ami, le vieux chef, et de l’inviter à remonter à bord ; nous envisagions obtenir de sa part qu’il fasse imposer un tapu (* tabou) sur le navire pour le lendemain. Non seulement ce dernier (dont nous apprîmes que le nom était Tearoroo) accepta-t-il notre invitation, mais il arriva accompagné de Toohoorebooa, le chef régent et oncle du roi, qui apporta avec lui une nouvelle série de cadeaux, à savoir des porcs, des ignames, des fruits à pain, des bananes, de la canne à sucre envoyés par le jeune roi PaePaeo. (* Concernant ces trois noms, voir la note de Jacques Iakopo Pelleau en fin d’article)
Ils refusèrent cependant de recevoir quoique ce fût en échange, expliquant que ce n’était pas là le souhait du roi dont les réserves débordaient de toutes ces denrées qu’il nous avait offertes. Toohoorebooa réclama alors que nous échangions nos noms, et Tearoroo se fit l’écho de sa requête ; une fois nos noms échangés, le régent fit remarquer que « nous étions de vrais amis désormais ». Cette cérémonie de présentation étant terminée, M. Crook poursuivit en faisant état de nos besoins (169) et de nos souhaits ; à savoir qu’il nous fallait faire le plein d’eau douce, que nous avions de nombreux tonneaux à remplir et que nous étions dans l’impossibilité de le faire en raison de la foule qui nous entourait, nous empêchant d’envoyer nos tonneaux jusqu’à l’aiguade et de les rapporter un fois pleins.
Le régent interrompit alors nos récriminations, répondant qu’il se ferait un devoir de taper sur la tête de ceux qui s’obstineraient à encombrer le terrain. Lui expliquant qu’on ne pouvait consentir à une procédure aussi sommaire, M. Crook poursuivit en lui réclamant, comme service particulier, d’imposer, pour le lendemain, un tapu sur la rivière et la baie, expliquant que l’équipage n’aimait pas l’idée d’avoir à remplir des tonneaux d’eau douce en présence d’une foule de Naturels se baignant en amont de la rivière. Le régent consentit à s’exécuter dès le lendemain à l’aube, ajoutant qu’il enverrait des messagers remonter la vallée afin de faire appliquer ce tapu jusqu’à la source de la rivière ; il termina en expliquant qu’il ferait lever le tapu dès que l’ombre portée par le soleil couchant atteindrait la cime des arbres du côté ouest afin que la population puisse se baigner avant la nuit. Considérant qu’il eût été mesquin de notre part de ne pas souscrire à cette restriction, nous nous empressâmes bien sûr d’accepter, lui indiquant aussi que nous l’avertirions une fois la tâche achevée.
Ce tapu ou restriction interdisait aussi aux Naturels de se baigner dans la baie et ses alentours, proscrivant même l’usage des pirogues, exception faite des embarcations royales, à moins que nous en ayons donné l’autorisation. De surcroit, le régent devait nous fournir un nombre suffisant de nageurs expérimentés qui pourraient transporter les tonneaux jusqu’à la grève et les rapporter à la nage jusqu’au canot.
Une fois cet accord convenu, la bonne entente régna entre nous. Ces aimables chefs prirent congé au coucher de soleil, intimant de les suivre à la foule des Naturels dont la présence soutenue ne nous avait pas facilité la tâche ; bon débarras ! Nous pûmes alors entamer les préparatifs de la corvée d’eau douce que nous espérions terminer en une journée, si possible.
Sur le pont, en même temps que nous avions posé notre jeu de grément courant, nous avions préparé une quantité de corde à cliquet à neuf fils afin d’installer un filet d’abordage qui, une fois positionné, faisait le tour du navire, étant fixé sur les hunes et les étais de foc ; il s’élevait à douze pieds (* 3.6m) au-dessus du bastingage, nous mettant ainsi à l’abri de toute intrusion pendant les nuits obscures. Néanmoins, par mesure de sécurité supplémentaire, je fis placer une sentinelle (171) au pied du mât de beaupré (* mât prolongeant l’étrave d’un navire, presqu’à l’horizontale), deux autres à côté du mât d’artimon et du grand mât, et une autre sur la demi-dunette (* ou lisse de couronnement, au-dessus de la poupe) qui, en commençant par cette dernière, devrait s’écrier : « Tout va bien ! » toutes les trente minutes ; un officier stationné sur le gaillard d’arrière était responsable du dispositif. De cette manière, je considérais avoir pris toutes les précautions nécessaires à la protection de notre petit navire contre de mauvaises surprises. En plus des canons, des mousquets chargés et des sacs de balles prêtes à l’emploi, je fis maintenir ce dispositif pendant tout séjour sur place.
Le lendemain matin au lever du soleil, tout le matériel ayant été préparé la veille au soir comme je l’ai expliqué, je fis envoyer à terre le canot remorqué d’un radeau chargé de tonneaux vides. Le Révérend Crook s’était porté volontaire pour superviser les opérations depuis la grève où, en raison des bonnes dispositions des chefs, il se réjouissait de n’avoir aucune difficulté à affronter ; le tonnelier et deux hommes d’équipage l’accompagnaient pour emplir et boucher les tonneaux. À l’embouchure de la rivière les attendaient les nageurs fournis par les chefs selon notre accord ; ils se tenaient tous prêts à remplir leur office. Ils ne durent pas attendre très longtemps car, le canot étant maintenant arrivé, le processus d’approvisionnement en eau douce pouvait commencer sur le champ. Nul Naturel n’étant visible dans la rivière : l’imposition du tapu s’appliquait à merveille.
Afin de démontrer leur désir de rendre service et d’être agréables à leurs nouveaux amis, et après en avoir demandé la permission aux deux autorités, plusieurs parmi ces nageurs entreprirent de rapporter un tonneau à la nage jusqu’au navire qui se trouvait au moins à une distance d’un quart de mille (* entre 400 et 500m) ; ils y furent adéquatement récompensés d’un clou, puis retournèrent sur la grève chercher un autre tonneau avec autant de zèle et d’enthousiasme que si on leur avait promis un pactole en gage de leurs efforts. L’impétuosité de nos amis fut si acharnée que, vers cinq heures de l’après-midi, nous disposions d’une réserve d’eau douce suffisante pour notre traversée jusqu’à Canton (* En Chine).
Nous étant ainsi assurés de disposer en quantité d’une des ressources les plus cruciales au bon déroulement de notre longue traversée à venir, nous avertîmes le chef régent Toohoorebooa qui fit derechef lever le tapu. Très peu de temps après le rétablissement des droits et privilèges dont ils avaient été privés de notre fait, une multitude de Naturels encercla le navire. Certains étaient venus en pirogue, d’autres, à la nage ; ils apportaient des figues (* Il n’y avait pas de figuier aux Marquises à l’époque ; difficile de savoir de quel fruit il s’agit réellement), de la volaille, des fruits à pain, des noix de coco, des ignames, des taros, de la canne à sucre, etc. (173)
La foule de ces chalands n’était là que pour faire des affaires avec nous, et nous ne savions pas où donner de la tête. Les morceaux de vieille ferraille étaient très recherchés, et leur valeur avait désormais atteint un niveau encore jamais égalé ; tout comme les bouteilles de Porto et de vin, en paiement de leurs articles, les Naturels acceptaient sans hésitation cette ferraille à laquelle ils accordaient une valeur inégalée par aucun autre des articles que nous proposions. Ils s’étaient parfois agglutinés en si grand nombre autour du navire, se suspendant à tout ce à quoi ils pouvaient s’accrocher le long de ses flancs, que notre petit vaisseau tanguait de droite à gauche ; ils attendaient, ou plutôt, ils étaient déterminés à ne pas nous faire oublier le pourquoi de leur présence qui se manifestait aussi par un babillage incessant et assez intense pour nous donner le mal de tête.
Notre ami, le régent Toohoorebooa, vint nous rendre visite à bord accompagné du vieux chef, celui que nous avions rencontré en tout premier ; ils voulaient aussi savoir si nous étions satisfaits de la manière dont s’était déroulé le ravitaillement en eau. Je leur manifestai ma reconnaissance pour leur amabilité et l’aide précieuse qu’ils nous avaient fournie ; ils furent heureux d’apprendre que nous étions satisfaits de la qualité et de la quantité d’eau récupérée, et conclurent en nous proposant, si nous le désirions, d’imposer un même tapu (174) pour le lendemain. En réponse à notre requête de les avoir fait monter à bord, ces chefs me firent aussi part de l’invitation pressante du roi à venir lui rendre visite. Je ne voyais aucune objection à accepter cette offre, y voyant même une occasion de renforcer leur confiance ; néanmoins, je répondis qu’il fallait que je voie s’il m’était possible ou non de quitter le navire, et que je leur ferais connaître ma décision le lendemain. Aussitôt après le coucher du soleil, on tira une salve pour annoncer la relève de la garde pour la nuit ; les chefs et les Naturels prirent congés sur le champ.
Depuis notre arrivée, le Révérend Crook n’avait cessé d’être attentif au comportement de ces gens ; prêtant l’oreille à leurs conversations, soit lorsqu’ils se trouvaient à bord, soit lorsqu’ils observaient les opérations de ravitaillement en eau sur la grève, en simples badauds, il en était venu à la conclusion que, bien loin d’ourdir des plans hostiles à notre encontre, leurs intentions étaient pacifiques, et qu’on pouvait leur faire confiance, presque sans limites ; en outre, il était certain de la générosité et des bonnes dispositions de cette tribu. Porté par cette conviction, il me pressait d’accéder à leur invitation, n’hésitant pas à proclamer qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter ; il ajouta qu’on pourrait même parcourir la vallée entière (175) en toute sécurité et qu’on y trouverait que des gens aussi amicaux et bien disposés. Il continua en expliquant qu’ils préfèreraient nous laisser leurs chefs en otage, comme ils en avaient l’habitude, plutôt que de se priver de ma présence à terre.
C’est alors que le Révérend Crook me fit part de son désir de passer la nuit avec eux afin de se conformer à l’invitation qui lui avait été maintes fois faite lorsqu’il se trouvait à terre. Je lui répondis que cette séparation serait difficile en raison des sentiments fraternels qui nous liaient depuis son arrivée à bord, sans parler des services immenses qu’il nous avait rendus ; il me fallait admettre, néanmoins, que seuls sa grande dévotion et le sens profond de son devoir missionnaire, car telle était bien sa charge, devaient l’éclairer sur la décision à prendre. En conséquence, afin de s’assurer de leurs bonnes intentions et de vérifier quel niveau de confiance on pouvait leur faire, il décida de passer la nuit parmi eux à terre.
Il revint à bord tôt le lendemain matin accompagné du régent Toohoorebooa ; il était satisfait d’avoir constaté (176) la pureté de leurs intentions, et aussi, parce qu’il se trouvait, au moins pour quelque temps, face à la charge qu’on lui avait confiée ; une cause pour la réussite totale et triomphante de laquelle tout homme juste et tout citoyen honnête devrait faire monter ses prières vers Dieu.
Conformément aux usages sacrés de ces Naturels, était venu le temps de lever le tapu qui empêchait le jeune roi de prendre la mer ; tout comme la reine-mère et d’autres membres de la famille royale, ce dernier était impatient de recevoir le commandant en chef du navire en sa royale demeure. M. Crook était d’avis qu’une telle démarche lui serait très profitable après notre départ de par l’influence que cette relation royale lui procurerait.
Ce qui me retenait de prendre ma décision, ce qui me faisait tarder à consentir à leurs invitations répétées, ce n’était pas le manque d’envie de porter assistance à ces Naturels, ou bien de leur faire des suggestions destinées à améliorer leur avenir ; non, ce n’était pas cela, mais je ne parvenais pas à justifier, sous peine de faire face aux critiques, une immobilisation du navire qui sacrifierait le temps et les intérêts de ses propriétaires, de mon équipage et de mes officiers aussi bien que les miens, sous le prétexte futile d’aller me promener à terre. Là n’était pas le but de mon mandat, et ce n’était donc ni juste, ni justifié.
Néanmoins, je répondis que si je pouvais tirer un quelconque avantage de cette visite (177) qui bénéficierait aussi à ceux qui toucheraient cette île après moi, je consentais à accepter, tout en restant sur mes gardes. M. Crook me fit alors part de ce qu’il avait entendu les chefs dire tandis qu’il était à terre, à savoir que Tearoroo, le vieux chef, et le frère du régent étaient prêts à rester à bord en qualité d’otages, et ce, jusqu’à mon retour sur le navire. Grâce à cet arrangement, M. Crook pensait qu’il me fallait accepter, tout en laissant consigne à l’officier de service de ne jamais en laisser sortir plus d’un des deux à la fois sur le pont ; ce faisant, il leur expliquerait la nécessité absolue de rester dans la cabine en notre absence.
En conséquence, je me résolus à descendre à terre, précisant qu’une heure de l’après-midi me conviendrait le mieux pour me rendre à cette invitation ; je fis alors hisser nos couleurs. Lorsque M. Crook informa le régent Toohoorebooa de notre accord, raison pour laquelle nous hissions nos couleurs, la joie resplendit sur le visage de celui-ci qui s’exclama : « Vahvee ! Vahvee ! » (Ce qui signifie : Bienvenue ! Bienvenue !) (* Il s’agit du vieux mot « Vave ! » ou « Vave mai ! » aujourd’hui remplacé par « Mave mai ! » employé effectivement pour accueillir les hôtes.) ; se levant d’un coup, il me prit les deux mains et me gratifia de ce qu’ils considèrent comme la marque la plus amicale (178) de salutation, à savoir une application plutôt ferme de son nez contre le mien, ajoutant qu’il était désormais comblé de joie, et qu’il allait sans attendre se rendre à terre afin de combler aussi de joie le cœur du roi, de la mère du roi et de ses propres amis en leur annonçant que nous avions accepté leur invitation.
Alors, M. Crook suggéra qu’il serait approprié de préparer une médaille de n’importe quelle sorte qu’on pourrait suspendre au cou du jeune roi, et qui serait du plus bel effet. En conséquence, nous choisîmes une plaque toute neuve de métal brillant sur laquelle furent gravés le nom du navire, le nom de son port d’attache et de son pays d’origine, à savoir, New York, États-Unis d’Amérique, et finalement de son port d’origine ; puis nous fîmes percer deux trous dans la bordure, à travers lesquels nous fîmes passer un mètre de ruban écarlate, et fixâmes les deux extrémités par un nœud afin que le tout puisse pendre élégamment autour du cou et reposer sur la poitrine. Nous enveloppâmes l’objet dans du papier afin que nul ne puisse le voir avant qu’il soit offert à Sa jeune Majesté. Nous venions de terminer quand Tearoroo et l’autre chef, frère du régent, montèrent à bord expliquant que le roi les avait envoyés en qualité d’otages, et qu’ils resteraient sur place jusqu’à notre retour au navire.
À une heure de l’après-midi, accompagné du Révérend W.P. Crook et du cuisinier chargé du présent, (179) je quittai le navire accompagné par une foule d’insulaires dans leurs pirogues, et j’abordai sur une plage située dans la partie est de la baie (* Probablement Vainahō) où s’étaient rassemblés le régent et un certain nombre d’autres chefs, ainsi qu’une grande quantité de Naturels ; c’est par cette multitude que nous fûmes accueillis. Deux chefs secondaires étaient chargés de s’occuper de M. Crook et de moi-même et, aussitôt que le déroulement de la procession eût été fixé, le groupe se mit en marche, précédé du régent Toohoorebooa qui avait profité de cette occasion festive pour se parer de sa tenue de tête la plus magnifique, composée principalement de plumes de phaéton alternant avec des plumes d’autres oiseaux, le tout formant un ornement splendide ; il portait aussi un pectoral de nacre. Paré de la sorte, il prit la tête du cortège, et la garda tout au long du défilé. De chaque côté de nous marchait une file de huit chefs portant un long bâton, ou canne, de couleur noire ou jaune, taillé dans un bois très dur, et dont l’une des extrémités était ornée de cheveux humains ; deux files de six chefs nous suivaient de près et, derrière eux, une grande foule de Naturels avançait en double file indienne sans vraiment se préoccuper de l’ordre de marche.
Nous progressâmes le long de la côte nord de la baie, dans la direction de la résidence du jeune roi (180) vers laquelle nous nous avancions sans hâte ; nous traversâmes d’abord un ruisseau, puis arrivâmes à la rivière où nous avions fait provision d’eau la veille. Juste avant d’arriver au premier cours d’eau, je fus placé en position très confortable de le traverser. En effet, sans me prévenir de leurs intentions, deux Naturels confectionnèrent un siège en entrecroisant leurs mains sur lesquelles on me fit assoir en me donnant un coup rapide dans les jarrets (* le creux du genou) ; recevoir un tel coup aurait pu me faire tomber en arrière car ils n’y étaient pas allés de main morte pour être sûr de faire plier les genoux. Et tout cela était destiné à nous faire traverser ces ruisseaux confortablement, sans avoir à nous mouiller les pieds.
Comme le Révérend Crook m’avait touché deux mots de cette procédure locale, je m’étais fort heureusement tenu sur mes gardes ; mais pas le cuisinier, ce pauvre homme. Quand ce même traitement désinvolte lui fut appliqué, il fut saisi de peur et exprima ses remerciements d’un hurlement horrible. De là où il se trouvait assis contre son gré, un petit peu plus loin derrière nous, il était à même de contempler les touffes de cheveux humains couronnant les bâtons des chefs nous entourant, lui rappelant probablement les coutumes barbares (181) de certains de ces insulaires des Mers du Sud qui assassinent et consomment leurs ennemis ; peut-être pensait-il que ses propres cheveux allaient aussi, un jour, décorer un autre bâton ? Quoi qu’il en soit, son cri fit éclater de rire tous les Naturels, et tous leurs regards étaient braqués sur lui ; ainsi devenu centre d’attraction générale, on pouvait aisément voir qu’il était paniqué. Cette péripétie avait grandement réjoui les Naturels, et notre pauvre cuisinier resta la cible de leurs éclats de rire jusqu’à ce qu’une bonne âme lui conseillât de ne point avoir peur, et de se joindre à l’hilarité générale afin d’y mettre un terme.
Après avoir atteint l’autre rive du ruisseau, on nous déposa délicatement afin de continuer notre chemin comme tout le monde ; on nous offrit le même service à la traversée d’un cours d’eau plus important : la résidence du jeune roi se trouvait à quelque distance vers l’ouest, et nous nous continuâmes à pied. Le long de la route se tenaient plusieurs groupes de Naturels rassemblés pour voir ce spectacle si inhabituel ; ils tombaient tous le visage contre terre et restaient dans cette position jusqu’à ce que soit passée la tête de la procession (182), à savoir les chefs et leurs bâtons ; après quoi, ils se redressaient et rejoignaient, ou pas, le défilé.
Nous remarquâmes aussi plusieurs bosquets des précieux arbres à pains et cocotiers dont les stipes étaient enveloppés de paille habilement tressée ; à ma requête de comprendre pourquoi ces arbres étaient ainsi recouverts, on me répondit que ces nattes permettaient à tous ceux vivant sous l’autorité du chef propriétaire de ce même district de disposer à volonté de ces noix de coco. Au contraire, lorsque les arbres sont démunis de ce signe distinctif, ils sont tapu et l’on ne peut y porter la main : aucun Naturel, sous aucun prétexte, ne peut cueillir un de ces cocos. Leur respect de ces lois simples est si fort qu’ils y obéissent scrupuleusement ; même en échange d’une hachette, il me fut impossible d’en convaincre un d’aller me chercher un coco sur un arbre ne portant pas de tresses de paille.
La demeure du roi se trouvait au centre d’un bosquet d’arbres à pain devancé par de magnifiques alignements de cocotiers et de palmiers ; en allant vers la mer, s’étendait une pelouse d’une surface d’une acre (* plus ou moins 4000m²) qui, telle une magnifique esplanade, mettait la touche finale (183) à ce splendide tableau.
La maison mesurait quatre-vingt pieds de long (* 24m) et vingt de large (* 6m). Son toit était composé de palmes et reposait sur une grosse poutre faîtière ; les chevrons semblaient être en bambou. Les murs étaient composés de rangées de poteaux placés à égale distance les uns des autres, devant et derrière ; l’ensemble était divisé en quatre grands appartements d’environ vingt pieds de côté (* 6m) par d’épaisses nattes tendues entre les murs qui divisaient ainsi le bâtiment en quatre parties égales. Les deux pièces de chaque extrémité sont elles-mêmes divisées en deux, munissant ainsi la maison de six alcôves, les quatre de chaque extrémité étant réservée à l’accueil des visiteurs. Le sol du bâtiment dans son entier est pavé de pierres lisses et recouvert de nattes d’une texture plus fine que celles utilisées pour diviser l’habitation en alcôves.
Tout le long de la façade antérieure de la maison s’étendaient quatre rangées de sièges en pierre lisse servant de marches ; ils étaient d’une telle largeur que, lorsqu’on était assis sur la rangée supérieure, on pouvait aisément étendre ses jambes sans importuner les gens installés sur celle en-dessous. Avec la foule qui s’y pressait, le site ressemblait exactement à nos assemblées de prière, les marches du fond étant un peu plus élevées que celles de devant, et au même niveau que la maison. (184) Cette volée de marches était surmontée d’un toit de paille mesurant environ douze pieds de large (*3.6m), dont la partie postérieure était fixée à la maison principale d’une manière que je n’ai pu distinguer, tandis que son bord inférieur était supporté par huit poteaux à la finition parfaite, placés à une distance de huit pieds (*2.4m) l’un de l’autre.
Notre procession apparut enfin devant la résidence royale au terme d’une bonne heure de marche alors qu’elle n’était tout au plus éloignée d’un mille du lieu de notre débarquement ; la cause en était les nombreuses haltes destinées aux oraisons faites par les chefs et dont nous ne pouvions comprendre un seul mot, et aussi au temps passé à remettre de l’ordre dans les rangs des Naturels. D’un pas mesuré, nous avancions sans nous hâter en direction du parvis de la grande maison sur les marches duquel, entourée d’au moins deux cents dames de sa cour, siégeait la reine-mère, une dame corpulente et imposante d’une cinquantaine d’années. Tout près d’elle se tenait le jeune roi, un beau jeune homme, robuste et trapu, d’environ quatorze ans, au visage saisissant de finesse, aux manières ouvertes et gracieuses, s’exprimant avec une facilité qui attestait de son ascendance royale. (185)
Les dames arboraient toutes des vêtements d’étoffe d’un blanc immaculé et des turbans ou tenues de tête du même cru. Mais, au préalable, chacune d’entre elle s’était fait un devoir de s’enduire le corps d’un mélange d’huile de coco et de bois de santal ; et là, l’odeur déplaisante de l’huile de coco anéantissait le parfum du santal. Si nous ne nous étions pas trouvés dans une telle situation, à savoir au beau milieu d’une foule rassemblant le roi et la noblesse du pays, et dont le nombre nous commandait de réprimer nos petites doléances, particulièrement eu égards au respect dû aux dames, j’ignore comment notre sens olfactif aurait pu nous empêcher de prendre la clé des champs et de cesser tout rapport avec une foule si mal odorante.
Un espace avait été scrupuleusement laissé libre dans chaque rangée de sièges, excepté sur celle du haut qui était bondée d’une extrémité à l’autre de jeunes demoiselles âgées apparemment de quinze à vingt ans. Après avoir été présenté à la reine-mère et au jeune roi, on me demanda d’aller m’assoir dans l’espace laissé vacant sur la rangée supérieure ; je m’exécutai sur le champ et, de la sorte, me trouvai installé entre la reine-mère et le jeune roi. Le Révérend Crook alla s’assoir dans la rangée en-dessous, tandis que la dernière rangée (186), la plus en contre-bas, était occupée par le régent Toohoorebooa qui réclama derechef qu’on étale des nattes devant lui et sous ses pieds afin d’y installer le cuisinier.
Directement derrière nous, sur la rangée supérieure, se tenaient trois demoiselles que la reine-mère s’empressa de me présenter, et dont je compris, de par la traduction du Révérend Crook, qu’elles étaient ses filles, les sœurs de sa Majesté le jeune roi. Elles ponctuaient toutes chaque présentation d’un « Vahvee ! Vahvee ! » « Bienvenue ! Bienvenue ! » accompagné d’un gracieux mouvement de la tête et de la main. La reine-mère procéda ensuite à la présentation de chacune des autres dames, en commençant par l’épouse du régent à la gauche de laquelle notre ami, M. Crook, avait pris place. Elles étaient interpelées sans égards et présentées sans attendre, chacune d’entre elles affichant le même sourire de bienvenue accompagné du même geste de la main que les princesses avant elles. Érigée en porte-parole de toute l’assemblée, la reine-mère entreprit de nous demander si les dames de notre pays possédaient une aussi belle étoffe que la leur, ou bien si elles disposaient d’une huile de noix de coco aussi fine que la leur ; nous sûmes trouver les réponses appropriées à chacune de ces questions cruciales (187) tandis que la foule nous écoutait avec grande attention.
Il s’était écoulé une bonne heure depuis que nous avions débuté ce bavardage quand, ayant un peu soif, je m’inclinai vers M. Crook pour lui faire part de mon envie. Dès que M. Crook eut traduit mon souhait au jeune roi, celui-ci manda sur le champ un serviteur chercher le rafraichissement désiré. L’homme ne tarda pas à revenir avec une coque de noix de coco curieusement ornée de motifs ouvragés qu’il présenta au jeune roi. Après en avoir bu une gorgée, celui-ci me passa le récipient ; je bus une rasade et trouvai que c’était de l’eau minérale acidulée. Je passai le récipient à M. Crook, lui demandant d’y gouter ; s’étant exécuté, il fit remarquer que c’était bien de l’eau minérale, et que c’était la première fois qu’il en voyait et en goutait. Voulant en apprendre davantage, il demanda au jeune roi la provenance du breuvage ; celui-ci lui répondit qu’on trouvait cette eau dans la montagne. Le régent ajouta que la source jaillissait dans la montagne, et que son eau était fort appréciée de la reine-mère et du jeune roi. En ce qui me concerne, ce n’était pas vraiment le cas, et je demandai à M. Crook de dire à sa Majesté qu’une noix de coco vert serait tout aussi acceptable (188).
Sans attendre, on demanda au même serviteur d’aller chercher une noix de coco vert dans un des arbres qui se trouvaient devant nous ; celui-ci se retira en s’inclinant, tout comme il l’avait fait la première fois. La cueillette fut rapide et aisée ; en effet, en raison de l’inclinaison habituelle des cocotiers, il fut en mesure de grimper à une hauteur entre quarante et cinquante pieds (* 12/15m), à quatre pattes, tout à fait à la manière d’un écureuil, et à une vitesse étonnante. Une fois la noix sélectionnée, détachée et maintenue par la queue entre ses dents, il redescendit, en détacha la bourre, en découpa une extrémité puis il l’offrit à sa jeune Majesté qui, ayant gouté son contenu tout comme il l’avait fait pour l’eau, me passa la noix que je trouvais fort rafraichissante.
Il m’apparut que le moment était propice pour offrir au roi le cadeau préparé à son intention. En conséquence, afin de donner un tour officiel à cette prestation destinée à faire forte impression, M. Crook demanda au régent Toohoorebooa de réclamer le silence général afin que nous puissions offrir au souverain notre gage d’amitié ; l’homme se leva donc, et fit part à la foule de nos intentions, puis il se rassit dans le silence total. À cet instant, tous les regards (189) se tournèrent d’abord vers le cuisinier, chargé de la plaque de métal qu’il passa au Révérend Crook ; celui-ci me présenta l’objet après l’avoir déballé. Je me levai alors, me tournai vers le jeune roi, fit délicatement passer par-dessus sa tête le ruban de la plaque étincelante qui reposait désormais sur sa poitrine ; au même moment, d’un ton solennel, M. Crook expliquait que ce présent était la marque de notre amitié. Pour conclure, il se tourna vers la reine-mère et lui adressa un signe de respect ; subjuguée par l’opulence de l’honneur faite à son fils, l’altesse royale agrippa les mains du Révérend et s’épancha en larmes de joie extrême, sans interrompre un seul instant ses mouvements de tête et de mains en témoignage de son approbation et de sa gratitude. Pendant ce temps-là, les trois sœurs s’étaient penchées sur leur frère, agrippées à ses épaules, plutôt, afin d’admirer au mieux le précieux article ; émerveillée, la foule se pressait autour de son monarque pour voir et toucher le présent étincelant, et l’air résonnait du jacassement le plus incroyable, destiné apparemment, je suppose, à manifester son admiration sans limite pour le cadeau.
Pour compléter le chaos, dans un sursaut de joie, le régent ne put réprimer son désir de me prendre dans ses bras (190), de m’étreindre triomphalement puis de me reposer sur ses genoux. Ajoutez-y la chaleur produite par une foule aussi dense et vous obtiendrez une scène d’un genre auquel Dieu me préserve de ne jamais plus participer. Néanmoins, ayant enfin épuisé son ardeur à me démontrer amour et amitié sincères, le régent lâcha prise et s’empressa d’exécuter la requête du Révérend Crook consistant à tenter de restaurer le calme et le silence parmi la foule afin que nous puissions adresser quelques mots au jeune roi. Une démarche aussi révolutionnaire ne pouvait pas être effectuée en un clin d’œil ; il fallut bien une quinzaine de minutes avant de voir le calme revenir. Petit à petit, le jacassement fut remplacé par un murmure à plusieurs voix et, finalement, un calme suffisant s’installa pour nous permettre de mener à terme notre entreprise.
Pour continuer la cérémonie, nous demandâmes au roi s’il était satisfait de son royal cadeau, et s’il acceptait la plaque en gage de notre amitié. Il répondit qu’il considérait sans hésitation l’objet comme une marque de nos bonnes intentions ; le régent Toohoorebooa confirma la déclaration du roi après lui avoir glissé quelques mots à l’oreille. La reine-mère surenchérit expliquant que le régent répondait du désir du roi d’accepter le présent, et qu’il allait échanger son nom avec moi, à la vie, à la mort, permettant ainsi à tous les navires (191) venant de mon pays et à tous leurs commandants qui viendraient visiter leur port, d’être considérés comme les amis les meilleurs et les plus chers qui disposeraient de tous les porcs et de tous les fruits à pain dont ils auraient besoin.
Il était ainsi lancé dans sa tirade expliquant combien il allait s’occuper personnellement de la réception de nos compatriotes quand tout cessa d’un coup à l’arrivée d’une petite femme dépenaillée accompagnée d’une paire de grands Naturels costauds qui firent irruption devant leur souverain, sans crier gare, et tirant derrière eux une énorme truie attachée à une corde. À l’évidence, l’animal était du même acabit que sa maîtresse car, pour en ajouter aux couinements stridents, elle n’avait de cesse de nous rappeler sa présence en hurlant « Otee pooaugah », « Otee booaugah », une formule signifiant : « Voyez le porc bien gras ! » (* Plutôt : « O te puaka ! » = « Voici le porc ! » ; sous-entendu, le fameux porc dont on a déjà parlé…). Le raffut engendré par cet épisode éclipsa la clameur entendue lors de la présentation du cadeau au roi.
Ces quatre animaux surgirent droit devant nous, sur la pelouse, et la vieille femme me demandait avec aplomb, si je voulais de sa truie. Je ne pouvais que répondre par l’affirmative, bien sûr. Avec toujours autant d’audace, elle voulut ensuite savoir s’il fallait envoyer la bête à bord, (192) et si j’allais lui donner une bouteille de verre en échange. Je lui fis savoir qu’elle ne devait pas s’inquiéter pour la transaction et que, conformément à notre accord, elle pouvait être certaine de recevoir sa bouteille. Contente et rassurée, la dame s’éloigna demandant à ses serviteurs de prendre la truie ; mais soudain, se retournant, elle s’inquiéta de savoir si je préférais emporter l’animal vivant à bord, ou bien s’il fallait le rôtir avant. Ignorant leurs pratiques en matière de rôti, j’optai pour la première solution. C’est ainsi que se termina la transaction avec la seule femme d’affaires rencontrée sur place ; l’après-midi se termina, elle aussi, par des conversations avec le roi, la reine-mère et leurs invités.
Après enquête, j’appris que cette vieille femme n’était autre que l’épouse de notre cher et vieil ami, Tearoroo, resté en otage à bord du navire ; abusant de son titre de grand-mère du jeune roi, elle ne s’était préoccupée que de son intérêt personnel, de la façon que nous avons décrite, sans se soucier du dérangement causé et de l’interruption des procédures en cours.
Pendant tout le temps que nous bavardions en compagnie royale, à quelques pas de nous, en plein air mais dans un enclos, depuis notre arrivée jusqu’à notre départ, (193) un des Naturels s’était lancé dans une de ces danses d’amitié habituelle en ce genre d’occasion. C’était un bel homme svelte portant un costume bariolé de nattes peintes qui, tout comme son turban, étaient ourlées de jolies plumes variées destinées à embellir l’ensemble.
Le moment était venu de penser à retourner à bord mais, avant cela, j’engageai M. Crook à faire part à la reine-mère et à sa cour, tous sans exception, de mon invitation à venir visiter le navire le lendemain. À son grand regret, elle ne put se conformer à cette requête car, tout comme le jeune roi, un tapu l’empêchait d’aller en mer pendant cette lunaison ; elle ajouta qu’elle serait ravie de se déplacer dès que l’interdiction serait levée. Cependant, afin de ne pas laisser notre invitation sans suite, elle demanda à ses trois filles et aux autres dames, tout au moins une bonne partie d’entre elles, de la remplacer le lendemain après-midi.
Alors que nous nous préparions à prendre congé, on nous présenta à chacun des membres de l’assistance. C’est la reine-mère en personne qui se chargea avec entrain de cette démarche. Aucune des femmes ne voulait manquer son tour ; ayant peur d’être laissées de côté ou éclipsées, elles s’avançaient vers nous l’une après l’autre, sans bousculade, afin d’être présentées par la reine-mère (194) ; il nous fallait alors frotter notre nez contre le leur, un genre de cérémonie tout à fait rustre, à mon avis, dont le déroulement nous a occupés pendant une bonne demi-heure.
La reine-mère et le jeune roi paraissaient très affectés par notre départ ; le jeune roi, surtout, qui, tout en me tenant la main, me priait de rester avec eux quelques lunes encore. Cette fastidieuse cérémonie des adieux enfin arrivée à son terme, nous repartîmes vers le navire en suivant le même ordre et les mêmes procédures processionnaires qu’à l’aller.
Le régent était intrigué par la carabine que notre cuisinier portait dans le dos, et que j’avais fait charger de petits plombs ; il voulait savoir à quoi cela servait, et si c’était une arme de guerre. En réponse à ses diverses interrogations, M. Crook lui expliqua que cela pouvait provoquer le tonnerre et un feu qui tuerait n’importe quel Naturel, ou tout autre être vivant se trouvant sur son chemin. Par un heureux hasard de circonstances, au moment de notre embarquement, une volée de petites mouettes passait à proximité et, les apercevant, le régent émit le vœu de vérifier le pouvoir de l’arme à feu. Lorsqu’elles arrivèrent au-dessus de nos têtes, je visai, fis feu (195) et en descendit une, touchée par quelques-uns de mes plombs. Le chef ramassa l’oiseau et l’examina soigneusement, pointant du doigt les blessures et le sang qui en coulait ; finalement, il fit remarquer avec beaucoup de sagacité que « le feu l’avait clairement traversé et provoqué sa mort. » J’espérais que cette démonstration de force aurait un effet favorable en les incitant à respecter ceux qui possèdent des engins admirables pouvant détruire tout ce qu’ils veulent.
À notre arrivée sur la plage, notre canot et un officier nous attendaient ; nous retournâmes sans attendre au navire où nous retrouvâmes les deux chefs gardés en otages, qui étaient fort satisfaits de la manière dont on les avait traités et qui n’avaient pas quitté la cabine un seul instant. Au vieux chef Tearoroo, et conformément à l’accord passé avec sa femme après qu’elle eût rempli sa part du contrat, je remis la bouteille de verre en échange du « booaugah » (* puaka), le porc qui se trouvait désormais à bord. Peu avant le coucher du soleil, deux grandes pirogues vinrent se ranger contre la coque chargées de huit gros porcs bien gras, de quelques porcelets, d’ignames, de fruits à pain, &c. ; c’était un cadeau commun de la reine-mère et du roi auquel je ne m’attendais absolument pas. Je considérai que c’était là la preuve de l’amitié et de la concorde (196) qui régnaient entre nous, confirmant ainsi la bonne impression que nous leur avions faite ; cela représentait aussi une forme d’assurance de voir notre très bon et très cher ami, le Révérend Crook, placé entre bonnes mains après notre départ, tout comme ceux de nos concitoyens qui feraient halte dans ce havre pour se ravitailler. Une preuve supplémentaire de leur désintéressement nous fut donnée lorsque le régent, qui était venu avec les deux pirogues, refusa de recevoir quoique ce fût en échange, pas même pour lui-même, expliquant que cela heurterait et blesserait les sentiments du jeune roi et de sa mère.
Le lendemain matin, le navire se trouvait encerclé par un grand nombre des pirogues grandes et petites dans lesquelles se pressaient des centaines de Naturels. Nous étions absorbés par nos opérations d’échanges intenses avec ces derniers et aussi, sur le pont, avec quelques chefs et leurs serviteurs, lorsqu’on entendit quelqu’un plonger ; la sentinelle de poupe s’écria alors qu’un Naturel venait de sauter depuis la fenêtre de la cabine avec quelque chose qu’il maintenait d’un bras sur sa poitrine. Nous rejoignîmes nos quartiers et un officier fut chargé de vérifier ce qui manquait ; nous découvrîmes qu’il s’agissait de la boussole azimutale qu’on avait laissé (197) sur le coffre près des fenêtres.
Soudain pris d’agitation, les Naturels et leurs chefs commencèrent à quitter le navire. Comme le régent se trouvait aussi à bord avec son frère, le Révérend Crook leur expliqua l’importance de l’objet volé, et qu’en dépit des inconvénients d’une procédure aussi pénible, il était hors de question de les laisser partir tant qu’on ne l’aurait pas récupéré. Le régent répondit que l’objet serait rapporté sans faute, et il envoya à terre un chef secondaire qui était à son service. Néanmoins, pensant qu’il serait judicieux de démontrer à nouveau la puissance de nos armes à feu, je demandai à M. Crook d’inviter le régent à porter son attention sur le bastingage qui était bien massif ; puis, me saisissant d’un petit pistolet de poche, je le chargeai d’une seule balle qui traversa le bois quand je fis feu. Il devait en déduire les conséquences identiques si l’on avait tiré sur un homme. C’est ce que M. Crook lui fit comprendre tout en lui rappelant le sort de la mouette qu’il avait si soigneusement examinée la veille au soir. Néanmoins, afin qu’ils puissent comprendre que le capitaine pouvait tout aussi bien les anéantir avec leur village, et même leur île, il décida de faire tonner un de ses gros canons (198). En conséquence, après avoir retiré le boulet d’un des canons du pont, celui-ci fut pointé sur la berge, et le coup partit. La détonation emplit de panique les Naturels qui restèrent quelques instants figés de peur et de terreur, comme pétrifiés par l’écho qui résonnait de colline en colline ; le régent fut seul à faire remarquer qu’il avait entendu les rochers se briser et les arbres se fendre dans la montagne.
Cette remarque produisit un tel affolement qu’ils en vinrent à demander à M. Crook de me supplier de ne pas détruire leur vallée ; sachant que ce dernier me comprendrait à mis-mots, je donnai une réponse évasive en supposant qu’ils s’empresseraient de restituer au plus vite la boussole disparue afin d’apaiser mon courroux. Tous les insulaires quittèrent le navire sur le champ, à l’exception des deux chefs gardés en otages et de leurs serviteurs les plus proches. Un de ceux-ci étant aussi un chef, le régent demanda l’autorisation de l’envoyer à terre dans une des pirogues restantes afin d’accélérer la restitution de la boussole ; ce qui fut accepté.
Il s’écoula ainsi une heure à patienter entre espoir et doute lorsque les deux chefs revinrent avec l’objet dérobé : il était brisé en certain nombre de morceaux, tout comme sa plaque de verre et son étui. Au terme de quelque temps (199), avec patience et énergie, nous réussîmes à en apparier et remonter les pièces ; seule l’aiguille manquait. On en informa le régent qui s’enquit alors auprès des messagers à ce sujet ; ceux-ci expliquèrent que le Naturel qui avait pris l’aiguille était parti loin dans la montagne, mais que plusieurs hommes s’étaient portés à sa recherche, et que le roi, ajouta le régent, avait donné sa parole, tout comme moi, que l’objet serait retourné le lendemain matin.
Le roi et ses chefs semblaient avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour nous restituer la boussole disparue. Il me parut donc opportun de renouer les fils d’une amitié temporairement mise à mal ; et comme aucune solution ne pouvait être apportée à notre préjudice puisque les Naturels avaient mis l’objet en pièces par ignorance, nous étions obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur.
Prenant alors le régent et son frère par la main, je leur fis part de mon espoir de voir renforcées notre amitié et notre confiance mutuelle dans la mesure où leurs efforts déployés dans le but de nous restituer notre bien dérobé prouvaient qu’ils n’étaient pas impliqués dans le larcin, ni ne l’avaient cautionné, puisqu’on savait désormais qu’il avait été commis par une fripouille de leur tribu.
Bien que ces mésaventures (200) aient quelque peu bousculé notre amitié, j’insistai pour que le régent assure le roi de mon attachement que son implication à résoudre l’affaire avait renforcé. Ces paroles plurent au régent qui revint à bord le lendemain matin avec l’aiguille de la boussole, ajoutant que le vaurien était sous bonne garde ; il se mit à ma disposition si je jugeais bon devoir lui faire administrer derechef quelques coups sur la tête ; ce mode de punition me parut un peu trop sévère et trop expéditif pour m’y conformer. Je lui répondis par la négative tout en ajoutant de m’avertir si lui ou l’un de ses amis les chefs apercevaient le voleur à bord ou à proximité du navire afin qu’ils aient l’occasion d’apprécier la manière dont moi, j’envisageais lui rendre la monnaie de sa pièce. Cette déclaration de ma part mit un terme à l’affaire, et restaura l’harmonie et la confiance entre toutes les parties concernées. Les Naturels remontèrent à bord et le brocantage reprit de plus belle.
À onze heures ce matin-là, les chefs accompagnèrent M. Crook à terre afin de prêter la main aux dames du pays qui devaient venir visiter le navire. Dans le but de célébrer au mieux l’occasion, je fis pavoiser le navire ; toutes les couleurs claquaient au vent ! Aux environs de deux heures de l’après-midi, ce qui était l’heure fixée, (201) à cinq minutes près, leur escorte les trouva prêtes, fait exceptionnel comparé à ce qui se passe en Amérique. En effet, si l’on oppose l’opération consistant à lacer un corset, &c., et celle ayant pour nature de s’oindre d’une double couche d’huile de coco pour l’occasion, on peut considérer que ces dames prirent moins de temps à préparer leur toilette que celles de mon pays natal.
On envoya le canot afin de prêter main forte si nécessaire mais ce ne fut pas le cas car nous vîmes bientôt s’approcher plusieurs de leurs pirogues les plus grandes et, en un rien de temps, une cinquantaine de ces dames parvinrent aisément sur le pont, parfumées et enduites à point d’huile de coco, vêtues de manière très convenable d’étoffe d’un blanc immaculé ressemblant à de la mousseline, et de turbans comme ornements de tête : elles étaient accompagnées par un grand nombre de chefs menés par le régent, Toohoorebooa.
Comme nous avions caché tous les objets source de tentation, et mis sous clé les articles les plus maniables, nos hôtes eurent accès à tous les recoins du navire sans aucune crainte de voir nos biens faire les frais de notre courtoisie. Tandis que le régent servait de guide aux hommes, suivant son exemple, son épouse avait pris la tête des femmes, suivies des trois sœurs du roi ; elles faisaient montre de grand respect (202), s’arrêtant fréquemment pour s’enquérir des différents objets, de leur utilisation et de tout ce qui les concernait.
Je saisis l’occasion pour demander aux trois princesses la faveur de troquer avec moi trois de leurs tenues et turbans identiques à ceux portés à l’occasion de cette visite ; à son retour à terre, M. Crook leur montrerait comment les fixer avec des épingles afin de les maintenir en forme jusqu’à ce qu’ils soient remis entre les mains de nos dames à New York ; ce qui fut fait à notre retour. Ces femmes furent enchantées de l’idée et s’inquiétèrent de savoir si nos dames les porteraient en public ou en privé et si, par la suite, elles en confectionneraient de nombreuses autres. (Cette étoffe est fabriquée avec de l’écorce d’arbre, puis elle est teinte d’une grande variété de couleurs ; le jaune et le blanc sont les plus communes, surtout cette dernière.) (* Cette étoffe végétale se nomme tapa, et les Marquisiens utilisaient le curcuma - èka ènana, symbole de joie et de fête, pour la teindre.)
Nous prîmes beaucoup de soin et d’attention à satisfaire par tous les moyens la bonne humeur de ces gens ; quand ils eurent passé en revue les différents aménagements du navire dont la plupart causèrent leur surprise, nous mîmes la dernière touche au tableau en leur faisant découvrir ce qu’ils prennent pour des richesses, à savoir un assortiment de rubans, miroirs, boutons de nacre, perles de verroterie, de ciseaux, d’aiguilles, &c. (203) ; « Motakee ! etee Motakee » « Bon, voyez, très bon ! ou beau ! », telle était l’exclamation générale à la vue de cet étalage. (* Le mot est « motaki » avec ce même sens, mais il est tombé en désuétude, remplacé par « meitaì » ou « kanahau ».)
Nous offrîmes alors à chacune des dames les cadeaux que nous avions préparés avec l’assistance de notre très cher ami M. Crook ; les trois sœurs emportèrent celui destiné à leur mère, et tout le monde retourna ensuite chez soi, le sourire aux lèvres.
Ayant manifesté au Révérend Crook mon intention de reprendre le troc le lendemain afin de faire le plein de provisions et de porcs pour lever l’ancre le surlendemain, je lui proposai aussi de me confier son courrier pour l’Angleterre au cas où il maintenait sa décision de rester sur place. En conséquence, je fis mettre un crayon, du papier et de l’encre à sa disposition, et il me remit un paquet de lettres à l’intention de la Société de Londres (* La LMS : London Missionary Society). À notre arrivée à New York, je fis suivre ce paquet à son destinataire.
À son retour à terre, M. Crook fit part de notre départ prévu sous un ou deux jours ; la nouvelle se propagea rapidement parmi les insulaires et, le lendemain, nous fûmes débordés par les opérations de marchandage. Peu avant le coucher du soleil, le régent Tearoroo et sa suite arrivèrent en pirogue ; après s’être rangés le long du navire, ils déchargèrent plusieurs porcs bien gras et de la volaille, le tout en gage d’amitié de la part du jeune roi. En échange, je remis un assortiment de haches, hachettes, couteaux et hameçons à chacun de ces chefs auxquels je m’étais vraiment attaché, et dont les visages réjouis disaient toute la satisfaction.
Je divisai alors ma garde-robe avec mon cher ami le Révérend ; afin d’assurer à ce grand Chrétien le respect des Naturels, j’y ajoutai une carabine de chasse et un stock confortable de munitions ainsi que de nombreux outils tels que des haches, des couverts et des jouets destinés au troc. Je complétai le lot par un petit meuble secrétaire, du papier, de l’encre, des plumes, des canifs et tout ce qui pourrait l’aider à assumer l’importance de sa tâche tout en contribuant à agrémenter ses moments de loisir.
Le 29 mai 1798, je fis hisser le signal de notre départ de la baie de Paypayachee comme la nomment les Naturels (* À Taiohae, après enquête auprès des anciens, je n’ai trouvé personne connaissant ce nom de Paepaeaki, un nom magnifique qui signifie « Terrasse (de pierres) céleste » et qui renvoie à l’idée d’une baie-miroir se reflétant dans le ciel/àki). Le Révérend Crook et les autres chefs étaient retournés à terre la veille au soir et, dès qu’ils aperçurent le signal, avant que nous ayons pu effectuer une quelconque manœuvre, ils étaient de retour à bord pour célébrer notre départ. Le régent expliqua que le roi désirait nous voir rester avec eux une autre lune, et que si c’était trop long, cinq jours seraient le minimum souhaité (206). « Le roi, » dit-il « possède grande quantité de porcs et de fruits à pains ; assez pour vous, et assez pour son peuple. »
Il n’est rien de plus difficile au monde que de s’aventurer, même avec prudence et application, à refuser l’invitation d’un cœur généreux, sans risquer de l’offenser ; rien n’est plus navrant que de refuser à une personne ce qu’elle vous offre pour des raisons pures et désintéressées. Je ne doute pas que telles étaient les dispositions d’esprit de mon interlocuteur à ce moment-là, et il me fallait trouver désormais une excuse valable pour refuser son offre. Après avoir exprimé mes remerciements pour l’invitation royale, je répondis que l’ordre du départ ayant été donné, on ne pouvait s’y soustraire, pas plus qu’à un tapu ; c’était une obligation, il fallait lever l’ancre le jour même.
Ce ne fut pas suffisant, et mon but ne fut pas atteint. Abattu et déçu, le régent s’assit et, sans mot dire, se mit la tête entre les mains. Je ne savais que faire mais, afin de soulager sa tristesse, je lui dis que nous pourrions, peut-être, revenir dans leur baie dans douze ou dix-huit lunes, mais qu’il devait nous laisser partir le cœur léger, sans tristesse. Il ne bougea pas. Pendant ce temps-là, à onze heures, nous avions levé l’ancre (206) et nous étions déjà sortis de la baie ; après être passé entre les deux îlots que nous appelions « Les Deux Sœurs », nous nous trouvions à une distance d’un mille du littoral, et nous mîmes en panne afin que puissent rentrer à terre dans leurs pirogues nos amis restés à bord pour nous guider dans la manœuvre.
Le vieux chef Tearoroo me prit amicalement dans ses bras, frotta son nez contre le mien et me souhaita le meilleur pour la suite. Avec mon excellent et digne ami le Révérend Crook, les adieux furent émouvants ; quant au régent Toohoorebooa, impossible de s’en défaire. Bien qu’il me fît ses adieux à plusieurs reprises, dès qu’il arrivait au bastingage, il revenait, me saisissait la main et me priait ne pas partir, pas si rapidement. Pour tenter de le persuader, on apporta sur le pont un certain nombre d’articles dont on le savait friand. On lui demanda de faire son choix ; on lui offrit même de prendre tout le lot s’il le désirait, et d’emporter le tout dans la pirogue. Mais rien n’y faisait ; il ne paraissait même pas être conscient de ce qu’on lui disait et restait là, immobile, indifférent à qui se passait autour de lui.
Cela faisait un bon moment que M. Crook et Tearoroo attendaient patiemment ; supposant que si le régent se retrouvait sans pirogue au moment de retourner à terre (207), il s’activerait pour profiter de la leur, le Révérend me suggéra de carguer les voiles et de libérer leur amarre ; ce qui fut fait, et la pirogue se stabilisa à quelque distance derrière la poupe. Finalement, je parvins à convaincre ce chef généreux d’enjamber le bastingage sur le bord duquel il resta quelques instants, comme plongé dans ses pensées. « Eh bien ! » dit-il enfin « Adieu, encore une fois ! » ; puis, selon leur coutume, il se jeta à la mer, nagea jusqu’à la pirogue qui s’éloigna en direction du rivage une fois qu’il s’y fut trouvé en sécurité. Quand ils se trouvèrent à une distance de quatre-vingt mètres environ, le régent se leva et agita amicalement la main en signe d’adieu ; à la longue vue, nous pûmes encore longtemps l’observer, la tête dans les mains.
C’était un homme à la stature quelque peu supérieure à la moyenne, mesurant bien six pieds de haut (* 1.82m), à la silhouette élancée et bien faite, d’une force immense et au caractère noble, toujours prêt à se mettre en quatre pour satisfaire ses hôtes, même si cela devait lui causer des inconvénients ; si ce n’était ses tatouages (considérés comme un ornement ou une marque de mérite personnel selon leurs critères de beauté) qui défiguraient son visage et ses oreilles, il était bien plus distingué que n’importe lequel des autres Naturels rencontrés (208) ; il aurait pu servir de modèle à plus d’un sculpteur ou peintre. Mais, en réalité, les tatouages assombrissaient tellement sa peau qu’il apparaissait aussi noir qu’un Africain. Cette coutume n’est pas réservée aux hommes ; les femmes aussi s’y adonnent, à un degré parfois moindre, parfois plus poussé, et cette pratique est source d’admiration, comme la marque du plus grand des honneurs.
Parmi les hommes, la mode est de se raser les cheveux par le milieu du crâne et de laisser de chaque côté une longue mèche qu’on laisse pendre à son aise, ou bien qu’on remonte en chignon sur le sommet de la tête, selon les gouts de l’individu. Pour les femmes, il y a deux styles de coiffure : dans la classe la plus élevée, elles laissent leur chevelure pendre librement dans le dos et devant les épaules, sans aucune fixation ; les femmes de la classe inférieure ont toujours les cheveux courts.
Étant donné que la douceur de leur climat ne nécessite que peu de vêtements, les hommes et les femmes sont vêtus de la même façon, à savoir une étoffe autour de la ceinture même si, parfois, on les voit porter des vêtements plus imposants.
Les hommes sont tous bien faits et toujours incroyablement en mouvement (209), que ce soit sur terre ou dans l’eau ; quant aux femmes, si ce n’était la couleur de leur teint légèrement cuivré, on pourrait les considérer comme belles lorsqu’elles sont vêtues de leurs toilettes d’un blanc éclatant et de leurs turbans, et que pend librement sur leurs épaules leur longue chevelure qu’elles peignent avec autant de soins que nos dames ; en tous cas, telle est leur physionomie. Hommes et femmes possèdent tous une dentition excellente, aussi blanche et saine qu’on puisse le désirer.
Ils ne sont pas aussi nombreux ni aussi belliqueux que les habitants de l’île de Wepoo (* Ua Pou), et bien qu’ils se fassent parfois la guerre, particulièrement contre la tribu située à l’est de leur vallée (* les Hapaa de Hakapaa), ils nous ont paru un peuple amical et paisible dans l’ensemble. C’est le comportement dont ils ont fait montre envers nous, et le déploiement général de cette conduite tout au long de notre séjour, particulièrement chez les chefs, mérite indubitablement notre souvenir reconnaissant.
Le port de Paepaeaki est excellent et possède de nombreux atouts : il est situé dans une baie exceptionnelle d’un côté de laquelle, face à la plage (* de Vainahō), se trouvait notre mouillage. Au cours de nos opérations de reconnaissance et de sondage, nous ne trouvâmes ni rocher ni danger affleurant à la surface de l’eau, si bien qu’un navire peut se présenter fièrement devant les « Deux Sœurs » (un bon point de repère pour reconnaître ce port) (210), passer entre les deux, et se diriger vers la plage au nord-est en face de laquelle il pourra jeter l’ancre à sa convenance suivant la profondeur de l’eau qui varie de dix à vingt brasses (* de 18 à 36 mètres) en fonction de l’éloignement de la plage. Lorsque les alizés soufflent du nord-est, les gros navires devraient jeter l’ancre entre les « Deux Sœurs », puis entrer en se faisant remorquer car le vent qui descend des montagnes alterne entre fortes rafales et accalmies qui pourraient le faire dévier de sa route ; les goélettes à deux mâts, quant à elles, peuvent y pénétrer en toute sécurité même dans de telles conditions.
Cette île possède d’autres ports comme j’ai pu l’apprendre de par les traductions menées par M. Crook ; à savoir, sur la côte sud, deux à l’est (* Taipivai/Hooumi) et un à l’ouest (*Hakauì/Hakatea). Il y en a aussi deux sur la côte nord (* Trois en fait, Anaho, Hatiheù et Aakapa).
La disposition de la vallée qui se nomme Tiuhoy (* Taiohae) n’est pas sans rappeler la forme d’un triangle faisant une lieue de largeur environ à sa base, le long du front de mer (* 1 lieue = 4828m). Elle se rétrécit peu à peu en remontant et, vers le fond, on aperçoit un grand nombre d’arbres coincés entre deux pans de montagnes élevées et parfaitement perpendiculaires ; çà et là, sur des corniches, se dressent les habitations des insulaires. Il faut vraiment la voir après une forte averse, lorsque le soleil étincèle sur les nombreux cours d’eau (211) ruisselant des montagnes à travers des vallons verdoyants comme autant de coulées d’argent poli. Ajoutez-y, de ci, de là, quelques habitations indigènes, dont certaines perchées près des montagnes, comme autant de nids d’oiseaux, et vous comprendrez que la vallée offre au regard le spectacle le plus magnifique et le plus romantique jamais contemplé par l’œil d’un mortel.
La tribu vivant dans cette vallée se nomme les Taeehs (*Teii), la tribu voisine à l’est, les Happah (* Hapaa) et celle de l’ouest, les Tiohahs (* Taiòa). À notre arrivée, nous trouvâmes des porcs, de la volaille, des fruits à pain, des noix de coco, des ignames et des taros en abondance.
Je pense vraiment que leur canne à sucre est la plus belle et la plus grande jamais cultivée. Nous pûmes nous procurer du ravitaillement à des prix très honnêtes : par exemple, pour un porc entre quarante et soixante livres, le tarif était un petit hameçon, un clou ou un taillon de cerceau de fer de trois ou quatre pouces de longueur (* 7.5 ou 10 cm).
La finition de leurs massues de guerre, de leurs lances, de leurs casse-têtes et de leurs rames, mais aussi de leurs pirogues, de leurs hameçons en nacre, et de tout leur matériel de pêche, est étonnamment remarquable, et tout aussi élaborée, si l’on considère qu’ils n’ont pas été travaillés avec des outils d’acier ou de fer, mais avec des instruments bruts en pierre, en coquillage ou en os ; ces Naturels se sont révélés (212) des artisans de première classe.
Nous avons acquis des brasses et des brasses de leurs cordes et de leurs lignes de pêche tressées à partir d’écorce d’arbre et de très belle qualité ; les premières nous servirent à la perfection de manœuvres courantes (* nom appliqué aux cordages divers servant à manœuvrer les vergues et les voiles).
Leur armement de guerre se compose d’une lance, d’une massue et d’une fronde. Leur musique martiale est produite par le tambour (un tronc évidé et dont les deux orifices sont recouverts de peau de requin), et par la conque de guerre, un gros coquillage multicolore, entièrement poli et recouvert de touffes ou des tresses de cheveux humains.
Si l’on considère que manger la chair de ses ennemis fait de vous un cannibale, ils sont cannibales, comme je pus le constater, un jour, lors de nos opérations de troc. Parmi les pirogues venues se ranger le long du navire afin de marchander, à bord de l’une d’entre elles, je remarquai quelque chose d’enveloppé dans des palmes, et que le Naturel refusait de troquer. Comme c’était un comportement inhabituel, je défis les palmes et découvris un morceau de chair humaine cuit au four ; je sursautai de surprise et d’horreur, et demandai à l’homme ce qu’il faisait de la chose. Le bonhomme comprit ma réaction, replaça les palmes autour du paquet comme ci-avant et me répondit seulement que c’étaient les restes d’un ennemi, donc très bons pour lui, et qu’il en mangeait un morceau quand il avait faim. C’est la seule preuve (213) que je pus observer personnellement de cette pratique ; j’entrepris de lui faire comprendre combien elle était affreuse, horrible et dégoutante, mais j’ignore à quel point je fus entendu…
La première fois que notre navire était arrivé en vue des îles Marquises (* du sud), j’avais réuni l’équipage afin de lui faire part du règlement établi par la compagnie dans le but de déterminer le comportement à tenir lors des futurs échanges avec les indigènes ; la peine encourue pour toute infraction était un confinement immédiat à fond de cale jusqu’à ce que le navire quitte l’île, ou l’endroit où l’infraction avait été commise ; sinon, au cas où le délit ne nécessitait pas de punition aussi sévère, on pouvait appliquer au coupable un châtiment plus proportionné.
Toutes ces règles étaient absolument nécessaires à la bonne tenue des marchandages et, afin de superviser les opérations d’achat et de vente, un officier était affecté chaque jour avec deux consignes : s’assurer de la sécurité de l’équipage et éviter à quiconque de trouver une bonne excuse pour truander. Cet officier supervisait toutes les démarches d’achat et de troc ; il inspectait toutes les acquisitions apportées à bord, de quelque sorte qu’elles fussent. Au cas où un membre de l’équipage désirait acquérir un article d’intérêt singulier, une curiosité, sans en avoir les moyens financiers, l’officier reportait le nom du marin et le montant concerné dans le livre de bord du navire.
Il n’y eut qu’une seule infraction à ce règlement, ce qui est tout à l’honneur de notre équipage. Il s’agissait d’un jeune homme qui portait un vieil hameçon autour du cou. À sa vue, un Naturel lui offrit de l’échanger contre un de leurs hameçons en nacre ; l’offre fut acceptée et l’affaire conclue. Peu après, un des chefs appela son compatriote à la poupe du navire, et celui-ci apparut, l’hameçon entre les lèvres. Interrogé sur la manière dont il l’avait acquis, l’homme balbutia ; le chef lui demanda alors de montrer du doigt la personne concernée, et le marin admit sa faute, reconnaissant avoir enfreint le règlement en toute conscience ; on l’envoya à fond de cale. Néanmoins, son confinement ne se prolongea guère car tous ses camarades m’apportèrent une pétition demandant sa relaxe et, considérant qu’il s’agissait là d’une toute première infraction, je lui fis rejoindre son poste après qu’il se fût conformé aux excuses d’usage et aux promesses de meilleure conduite dans le futur.
CHAPITRE XII - Traversée de Nuku Hiva à Canton (* Chine), et découverte de nouvelles îles.
Le 30 mai 1798
Comme précisé dans le chapitre précédent, après le départ de nos trois amis, nous arrivâmes vent arrière et longeâmes la côte vers l’ouest, toutes voiles dehors. À 6h00 P.M., nous nous trouvions à une distance de cinq lieues environ (* 24km) de Nuku Hiva ; l’île de Fettooeeva se tenait à une distance de six lieues (* 29km) à l’ouest nord-ouest (* Fatu Iva ; il s’agit plutôt de l’îlot Hatu iti - qu’il ne connaissait pas - car Fatu Iva est l’île la plus méridionale des îles Marquises, à 80km sud-est de Hiva Oa). Cela faisait à peine cinq ou six jours que les îles Washington (* le groupe nord-ouest des Marquises) nous étaient apparues et, depuis ce moment-là, nous avions recherché et trouvé un bon mouillage, nous avions fait le plein d’eau douce en vue d’une longue traversée, et nous avions une réserve de ravitaillement (216) si abondante que les ponts en étaient recouverts ; on ne peut donc dire, en aucune manière, que le temps passé sur ces îles magnifiques ait été sottement gaspillé.
À 5h00 A.M., la vigie signala une terre au nord-est. En nous approchant, nous découvrîmes deux îles : l’une assez haute et étendue, et l’autre plus basse. Nous appelâmes la première New York Island et la deuxième Nexen Island en l’honneur de mon ami et armateur, M. Elias Nexen. (* Il s’agit de Eiao, au sud, et Hatu Taa/Hatu Tu, au nord). Le nombre important de colonnes de fumée s’élevant depuis différentes parties de l’île nous portèrent à croire qu’elles étaient habitées mais, celle-ci se trouvant dans notre est nord-est, à une distance de quatre à six lieues (* 19/29km), nous ne jugeâmes pas utile de perdre notre temps à remonter le vent dans leur direction, d’autant moins que nous n’avions rien à y faire. À midi, notre latitude était de 8° 13’ sud, longitude 141° 31’ ouest, heure à laquelle nous nous trouvions par le travers de New York Island, à une distance de huit lieues (* 38km).
Le 7 juin
Les alizés dont nous avions bénéficié ces derniers jours ont pris la forme d’une brise modérée soufflant de l’est au nord-nord-est avec de fortes averses de pluie à l’occasion. Des fous bruns, des frégates, de petites mouettes, des sternes toujours en bandes et de nombreux poissons volants, d’une taille plus grande qu’à l’habitude ; nous trouvâmes ces derniers tout à fait à notre gout, et leur arrivée tomba à pic pour varier notre menu. À 4h00 A.M. nous traversâmes l’équateur pour la seconde fois à 154° 43’ de longitude ouest.
( … / … )
NOTES DU TRADUCTEUR, JACQUES IAKOPO PELLEAU
1) – Concernant les noms des chefs marquisiens : le vieux chef Tearoroo, le régent Toohoorebooa et Paeroroo, le jeune roi.
a) - À la suite de son séjour aux Marquises (juin 1797-janvier 1799), le Pasteur Crook rédigea un « An Account of the Marquesas Islands » publié en 2007, avec sa traduction française, « Récit au îles Marquises », aux éditions Haere Pō de Tahiti.
On y apprend qu’à Nuku Hiva, il était familier du grand-chef des Teii, Kiatonui et de sa famille, dont il a pris soin de relever tous les noms qui sont listés à la fin de l’ouvrage, dont celui de la reine-mère, Putahaii. Or, pas un de ces trois noms, ou même s’en approchant, n’apparaît dans cette liste. Cela provient probablement de la compréhension imparfaite des sons marquisiens maltraités par les sonorités anglaises. Si la reine-mère correspond à la description de Crook, le jeune roi dont parle Fanning ne peut être Kiatonui qui avait entre 40 et 50 ans à l’époque. Il s’agit probablement d’un de ses fils, ou petits-fils ; l’absence de Kiatonui à la cérémonie racontée avait peut-être des raisons que les Américains n’ont pas eu le temps de saisir en une semaine de séjour.
b) – Juste deux ans après le départ de Crook, en janvier 1801, un autre anglais faisait lui aussi ses premiers pas sur Nuku Hiva où il restera jusqu’en février 1806 : il s’agissait d’Edward Robarts qui, lui aussi, nous a laissé le récit de son voyage : « The Marquesan journal of Edward Robarts », « Le journal marquisien d’Edward Robarts » traduit pas mes soins et publié en 2018 aux éditions Haere Pō. Robarts est resté plus de cinq années à Taiohae ; lui aussi était un proche de Kiatonui dont il était même le beau-frère, et dont il cite le nom à plusieurs reprises ; mais il ne parle à aucun moment de ces trois personnages mentionnés per Fanning.
2) - Le lieu de rencontre : le tohua Temehea et le paepae Pikivehine

De nos jours; le tohua de Temehea avec, au fond, le paepae Pikivehine (où dormit Edward Robarts en 1801). À droite, on peut voir le soubassement d’une maison qui aurait pu être là en 1798 ; les estrades de pierre, semblables à celles décrites par Fanning, ont été construites à l’époque de la rénovation complète du site entre 1987 et 1989. C’est sur ce site que c’est tenu le 2ème Matavaa en 1989, le 1er sur Nuku Hiva.
Après la procession le long de la baie, les visiteurs arrivent à un endroit de la côte ouest où se trouvent des centaines de personnes et une esplanade bordée de travées en escalier ; cela correspond au site du tohua Temehea et du paepae Pikivehine à l’embouchure des vallées Meàu et Hōata de Taiohae. C’est l’endroit où habitaient Temoana et Vaekehu et où cette dernière reçut les grands visiteurs de la fin du XIXème siècle avant sa mort en 1901. Le site nommé Viihenua est surmonté des tombeaux de ces anciens. La description qu’en fait Fanning nous laisse à comprendre la grandeur du site.
3) – Paepaeaki, nom oublié de la partie de baie où le Betsey était au mouillage :
Publié par Jacques Iakopo Pelleau - Août 2020
Mis en conformité avec la graphie académique marquisienne le 26/08/2022.
(À l'exception de certains mots extraits des dictionnaires anciens pour lesquels la graphie originale incertaine a été conservée.)
BIBLIOGRAPHIE
*- Cook, James : « Relations de Voyages autour du Monde », éditions La Découverte, Paris, 1998
*- Crook, William Pascoe - Récit aux îles Marquises, 1797-1799 ; traduit de l’anglais par Mgr Hervé Le Cléac’h, Denise Koenig, Gilles Cordonnier, Marie-Thérèse Jacquier et Deborah Pope-Haere Pō-Tahiti-2007
*- MS Robarts, Edward : « Memoirs of Edward Robarts, an ordinary seaman, describing his travels and adventures in the South Seas from 1797 to 1824, particularly his seven year stay on the Marquesas Islands. Identifier : Adv.MS.17.1.18 - 1824. (Creation) 171 pages. Folio. Microfilm available : Mf.Sec.MSS.222. The volume was published as « The Marquesan Journal of Edward Robarts 1797-1824 », Pacific History Series, number 6 (Canberra, 1974), edited by Professor Gregory M Dening. »
*- Robarts, Edward « Journal Marquisien, 1798-1806 » ; traduction de Jacques Iakopo Pelleau, Haere Pō, Tahiti, 2018.