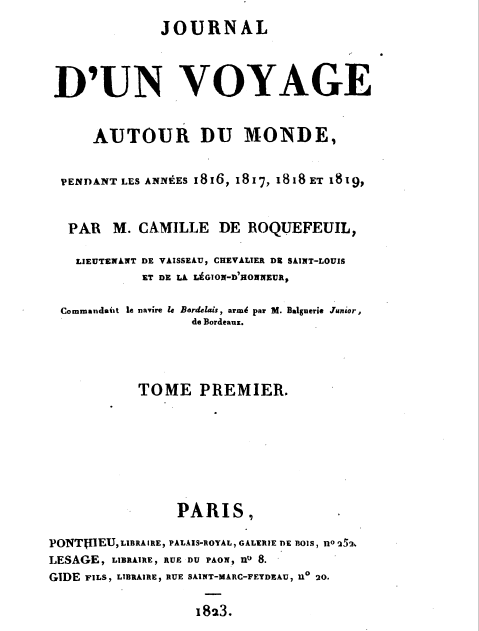AVANT-PROPOS
Les notes avec des numéros sont de l’auteur, de même que les parenthèses sans *. Les parenthèses commençant par * sont de Jacques Iakopo Pelleau. Les nombres à 3 chiffres entre parenthèses renvoient aux pages de l’ouvrage cité en référence.
L’orthographe de 1823 a été conservé même si elle comporte des fautes par rapport à celle de notre époque (enfans, très-bien, etc.)
Étant le plus souvent peu éloigné de l’orthographe actuelle, le nom des îles donné par de Roquefeuil n’a pas été modifié, juste expliqué par une note.
Mis en conformité avec la graphie académique marquisienne le 26/08/2022.
En 2010, Serge Legrand-Vall publiait aux éditions ELYTIS « Les îles du santal », une magnifique version romancée de l'expédition.
INTRODUCTION
Extrait de la publication de 1823 expliquant les motivations du voyage ; de plus amples renseignements sont disponibles en suivant le lien :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9dition_du_Bordelais
(… / …)
« Après ces considérations préliminaires, nous allons présenter succinctement les faits principaux du voyage de M. de Roquefeuil, et développer les divers points qui sont susceptibles d'une analyse particulière. Mais avant tout, nous croyons devoir donner un précis du voyage, afin de faire connaître plus particulièrement les avantages qu'on peut en retirer.
M. de Roquefeuil, commandant du Bordelais, part de Bordeaux le 11 octobre 1816, double le cap de Horn, et, après cent dix-sept jours de traversée, relâche à Valparaiso ; il se trouvait dans cette ville lorsque les insurgés de Buenos-Ayres s'en emparèrent et détruisirent le gouvernement de la métropole. M. de Roquefeuil donne quelques détails sur la ville, la situation politique du pays, le caractère des Chiliens, et les articles de commerce qui sont d'une défaite avantageuse au Chili. De Valparaiso, il fait voile pour le Pérou, séjourne deux mois au Callao et à Lima, où il est accueilli avec bienveillance par le vice-roi, dont la protection lui facilite les moyens de se défaire d'une partie de sa cargaison. Se bornant à ne parler principalement que de ce qui peut intéresser le navigateur et le commerçant, il traite des différens articles de commerce propres à être importés dans ce pays. Il donne la description de quelques établissemens et fêtes publics, fait connaître l'état politique de cette partie de l'Amérique, et motive l'esprit d'indépendance qui commençait alors à s'y manifester, et qui a éclaté depuis.
Du Pérou, il passe en Californie, relâche au port San Francisco. De la Californie, il se dirige vers la côte Nord-Ouest pour s'y procurer des pelleteries en échange des produits de l'industrie française ; c'était là le but principal de l'expédition du Bordelais, ces pelleteries devant être portées en Chine et converties en marchandises de ce pays, recherchées en Europe, et qu'on aurait par ce moyen sans extraction de numéraire. Il arrive à Noutka, y est bien accueilli par Macouina, chef de ces contrées, déjà connues par les voyages de Cook et de Vancouver. Il commence ses échanges avec les naturels.
La saison, trop avancée, oblige M. de Roquefeuil à aller hiverner aux îles Marquises de Mendoça. Une relâche de deux mois dans cet archipel le met à même de prendre des notices exactes sur la navigation de ces îles, les mœurs et les coutumes des habitans, les productions du pays et les objets recherchés par les naturels. Il donne sur ces différens points des détails circonstanciés et intéressans qui seront utiles aux navigateurs, et qui piqueront la curiosité des gens du monde.
Après avoir fait sa cargaison de sandal (* le bois de santal ; à l’époque, on disant sandal, imité de l’anglais « sandalwood »), principale production de ces îles, article d'une bonne défaite en Chine, M. de Roquefeuil retourne à la côte Nord-Ouest, relâche à la Nouvelle-Archangel, chef-lieu des établissemens russes dans cette partie du monde. Il conclut avec le gouverneur général, capitaine de Heigmeister, une convention pour faire la chasse aux loutres de compte à demi, et par laquelle le gouverneur doit lui fournir soixante chasseurs de l’île de Kodiack, et M. de Roquefeuil s'engage à payer 2oo piastres pour chaque chasseur qui serait tué dans l'expédition.

Portait de Camille-Joseph de Roquefeuil-Cahuzac (1781-1831), capitaine du BORDELAIS

Illustration d’une médaille commémorative en l’honneur du BORDELAIS
(… / …)
CHAPITRE VI (246)
Départ de San-Francisco pour les îles Marquises de Mendoza. - Promotion dans l'équipage. - Échange de poudre contre du bois de sandal (* à l'époque, on disait "sandal", comme en anglais: sandalwood.). Observations importantes. - Suspicions de l'auteur envers les Naturels que tout porte à croire anthropophages. - Tentatives des sauvages contre le Bordelais. – Reconnaissance de l'anse d'Hacahoui. (* Hakaui) - Grotte remarquable. - Poètes et musiciens ambulans. - Tentative de vol et de meurtre. - Tendre amitié d'un prêtre sauvage pour le capitaine. - Détails utiles et nécessaires aux navigateurs dans ces contrées.
Le 2o novembre. - La brise étant forte, on prit les ris dès le point du jour ; mais la chaloupe du Présidio (* Navire espagnol rencontré à San Francisco) qui devait nous porter quelques provisions s'étant fait attendre, on ne leva l'ancre qu'à 1o heures du matin, et le navire dériva avec le jusant. Nous trouvâmes la mer très-dure au dehors, à cause de l'opposition du courant et du vent qui était S.-O. bon frais. Ce conflit la faisait briser fréquemment, principalement à la bande nord que nous hantions, le jusant y étant plus fort. La brise s'étant faite du S.-E. après un calme très-pénible dans (247) notre position, à 2 heures du soir nous fîmes route pour les îles Marquises de Mendoça, où j'espérais mettre à profit une partie de la saison que la rigueur du climat ne permet pas d'utiliser à la côte nord-ouest. Nous éprouvâmes des vents contraires et très violens, souvent avec tourmente, jusque par les 3o degrés.
Le 1er décembre. Nous entrâmes dans les alisés par 27 deg., en nous félicitant d'être exempts pour quelques mois des hasards et des fatigues des côtes orageuses d'Amérique. Les vents alisés varièrent d'abord de l'E.-N.-E. au N. (248) et ensuite au N.-O. jusqu'au Tropique du Cancer. Ils commencèrent à hâler le sud par le treizième parallèle et furent après très-variables du N.-N.-E. au S.-S.-E. et même au S.-O. La brise était fraîche et accompagnée de beaucoup de pluie et de grains qui, des 12 deg. aux 7 deg., prirent l'apparence et la force de ceux de Sumatra.
Le 7. - Nous étions près de la position assignée par Espinosa au banc découvert par Villalobos vers l'an 16oo, qui trouva 6 brasses d'eau par 13 deg. nord et 121 deg. ouest. Ce banc, s'il est de corail, ayant pu devenir dangereux depuis cette époque, je ne voulus pas doubler de nuit son parallèle. Je courus à l'ouest, route qui faisait perdre peu de chemin. Le matin, on ne vit que quelques pailles en queue et une goëlette. La couleur de l'eau n'éprouva aucune altération ; mais nous eûmes pendant quelque temps une mer battue et irrégulière. La force du courant de rotation augmenta progressivement en approchant de l'équateur, et donna 89 min. de différence ouest.
Le 17.– Jour où nous le coupâmes pour la troisième fois par 13o deg. 3o min. ouest, (249) la mer était agitée de clapotis et de remous violens comme dans les Maldives. Je fis porter considérablement au vent, pour me prémunir contre les différences ouest et les variétés de sud que la saison me faisait craindre. Mais la brise ne varia que de l'E.-N.-E. à l'E.-S.-E. et la force des courans ainsi que leurs indices, diminuèrent considérablement aussitôt après avoir passé la ligne. Depuis notre entrée dans la région des beaux temps, chacun des ouvriers était occupé dans sa partie respective. Au moyen d'un petit moulin de campagne, on faisait de la farine, et j'en fis donner une ration journalière en pudding pour le dîner.
Le 2o.- On vit beaucoup d'oiseaux : l'horizon était couvert et présentait des apparences de terre dans le nord-ouest. Je fis tenir le vent, mais après avoir couru deux lieues au N.-O. ¼ N., l'espoir de découvrir quelque terre nouvelle s'évanouit avec les nuages qui l'avaient fait naître.
Le 21.- M. P. Portarieux, embarqué pilotin, fut fait sous-lieutenant. Cette promotion était exigée par le mauvais état de la santé de M. Siepky, et par les besoins du service, à la veille de notre arrivée dans un archipel dont les habitans doivent être continuellement surveillés. C'était pour M. Portarieux une récompense méritée.
Le 22.- Nous eûmes connaissance des îles les plus orientales du groupe des Marquises découvertes par Mendana. Nous vîmes d'abord Hatouhougou (1), (île Hood de Cook) (* Fatuùku) et peu après Ohévahoa (la Dominique de Mendana) (* Hiva Oa) et une terre qui paraissait détachée, si elle n'est liée à la grande île par quelque terrain bas (2), et qui ne peut être que San Pedro (* Mohotani). La vue plus rapprochée de ces terres confirmant le jugement que j'en avais d'abord porté, je dirigeai au N.-O.-O. en forçant de voile afin de prendre connaissance de l'île Raouga (ou de Hergest) (* Ua Huna) avant la nuit.
(1) On m'a assuré qu'il existe des brisans autour de Hatouhougou. Nous vîmes de loin des pointes de rochers dans la partie ouest. Il doit y en avoir de moins apparens dans le nord-est.
(2) Si c'est San-Pedro (Motani), il faut que la position soit mal déterminée sur les cartes, où elle paraît être au sud de la pointe Est d'Ohévahoa, et même un peu ouest. Nous avons relevé San-Pedro au sud-est, encore détaché de cette grande île. La pointe ouest de Ohévahoa et la pointe Est de Hatouhougou gisent sud 35 deg. ouest et nord 35 deg. est. (251)
À 9 heures, en latitude de Raouga sans en avoir connaissance, je dirigeai au sud. À minuit, à mi-canal entre cette île et celles du sud, j'arrivai à l'ouest. On eut connaissance de Raouga dans le nord nord-ouest. On loffa au sud-est sous petites voiles : peu après cette île disparut. Je pris ces précautions qui, dans notre position au vent, n'entrainaient qu'un retard insignifiant, pour éviter la rencontre inopinée de quelque rocher ou autre danger à fleur d'eau, tel qu'il s'en trouve dans les petits archipels. Quoique Marchand et Hergest n'en eussent vu aucun dans cette partie, les reconnaissances éloignées qu'ils avaient faites ne me paraissaient pas des garans suffisans, non plus que les rapports vagues que j'avais recueillis sur les navigations postérieures.
Le 23 - À 4 heures du matin je ralliai Raouga, dont nous eûmes connaissance au nord nord-ouest à 5 lieues de distance, et Hatouhougou parut dans l'est-sud-est. Nous prolongeâmes la première de ces îles, dans sa partie sud, à 5 milles de distance. Elle nous a paru peu boisée ; on voit cependant d'assez beaux massifs d'arbres dans les vallons qui se rencontrent entre les mornes très-escarpés. La pointe sud-ouest est remarquable par une montagne dont le sommet forme deux mamelles qui sont détachées quand on vient de l'est et qui paraissent fermées lorsqu'on vient Est dans le sud (3).
(3) L'îlot le plus au large de la pointe sud-ouest est un coin de mire dont le talus court nord-est. Il est porté trop Est dans les cartes. Sa position, par rapport à la pointe ouest, est sud-sud-est au lieu d'est-sud-est. Du reste, la configuration qu'Hergest a donnée aux terres m'a paru très-exacte. (252)
À 9 heures nous eûmes successivement connaissance de l'île Nouhiva (* Nuku Hiva) dans l'ouest, et de l'île Marchand (Rahopou) (* Ua Pou) dans le sud-sud-ouest. Nous portâmes sur la première, et on fit toutes les dispositions de mouillage. Nous dirigions sur la pointe Martin (* Tikapo) qui forme l'extrémité sud-est de l'île Nouhiva et ferme la baie du Contrôleur (Chiaumé) (* Hooumi) dans l'est. C'est une langue de terre, ou plutôt de rochers, très-étroite, d'une hauteur considérable et très-escarpée, surtout le côté du large, qui s'élève à pic en sortant de la mer : l'ensemble offre un tableau pittoresque (4).
(4) À 3 ou 4 encâblures au large, il y a un rocher de forme pyramidale dans le sud-quart-sud-ouest de la pointe Martin, et au sud 15 deg. Est d'un banc adjacent à la côte au fond de la baie du contrôleur. Il n'est pas porté sur la carte d'Hergest, où l'on voit un rocher détaché sur la bande Est de la baie, dont nous n'avons pas eu connaissance.
De la baie du Contrôleur, nous longeâmes la côte à un mille de distance. Elle est partout élevée, (253) accore et taillée en rempart dans plusieurs endroits où sa coupe présente des couches parallèles de nuances variées. La végétation ne paraît pas vigoureuse dans cette partie, qui n'est habitée et habitable que dans un seul endroit, où les mornes, qui partout ailleurs ferment la côte, laissent un espace libre au bord de la mer. Cette petite vallée, coupée d'un filet d'eau, est couverte d'une riante verdure, parsemée de cocotiers et d'arbres à pain, sous lesquels nous vîmes deux ou trois pirogues et autant de cases d'où les habitans sortirent pour jouir du spectacle que leur offrait le navire. En doublant l'îlot Tahia-Hoy (* Il donne à l’îlot Mataùapuna le nom de la baie de Taiohae, ce qui prouve combien ces lieux étaient alors inconnus des Français) qui forme la pointe Est du Port Anna-Maria (d'Hergest) (* Hergest, capitaine du Daedalus, 1er navire à jamais faire escale à Nuku Hiva en 1792 ; c’est lui qui donna les noms de Comptroller’s Bay – Baie du Contrôleur, à Taipivai - et Port-Anna-Maria à la baie de Taiohae. Le 1er nom à survécu jusqu’à notre époque ; le 2ème fut encore utilisé tout au long du XIXème siècle), nous distinguâmes au fond de ce beau mouillage un bâtiment à trois mâts qui mit aussitôt le pavillon américain. Nous avions arboré le nôtre sur la côte. Nous louvoyâmes pour gagner le mouillage avec la brise du N.-E. qui mollit, et hâla le N. à mesure que nous avancions. (254)
À 4 heures et demie, il vint à bord une baleinière nagée par des naturels, portant un Américain des États Unis, nommé Ross (* Il était déjà là en 1813-1814 avec Porter et avait survécu aux émeutes précédant le départ de son second en mai 1814), qui résidait depuis plusieurs années dans ce pays, où il traitait pour les bâtimens qui venaient charger du sandal. Il m'offrit ses services ainsi que ceux du capitaine Cornelius Sowle, du navire la Ressource de New-York, que nous voyions au mouillage. Après m'avoir donné quelques renseignemens généraux, M. Ross s'en retourna en se chargeant de remercier de ma part le capitaine Sowle, et de l'assurer que je m'estimerais heureux de pouvoir lui être utile. Peu après, le capitaine vint lui-même me réitérer ses offres obligeantes.
À 8 heures nous mouillâmes par onze brasses, sable gris, fin, à quatre encâblures de terre. Pendant que je m'entretenais avec le capitaine Sowle, et qu'il me parlait des motifs qui l'avaient engagé à exclure les femmes de son navire, on vint m'avertir qu'il s'en était introduit sur le mien une cinquantaine, qui venaient d'arriver à la nage, et qu'elles y étaient montées lestement à l'aide des bouts de manœuvres (254) qui s'étaient trouvés le long du bord. Malgré les avis du sage M. Sowle, je ne jugeai pas à propos de repousser cet abordage, et d'ailleurs je n'aurais su quel moyen prendre pour chasser un pareil ennemi, qui s'était déjà emparé du pont. J'ajouterai que je ne crus pas devoir être plus rigoriste que les navigateurs nos devanciers, sans en excepter Cook, qu'on ne saurait accuser de faiblesse dans ce genre. La plus âgée de ces femmes n'avait pas plus de 25 ans.
Le 24. - On travailla à faire de l'eau et du bois. Le grand canot porta de bonne heure une ancre à jet en affourche dans l'ouest de la grosse (5).
(5) On relevait les pointes de l'entrée au sud deux deg Est, et sud 28 deg. Ouest ; la pointe Est du rocher accore où l'on débarque au fond du port au nord trois deg. Est ; un petit morne battu par la mer à l'extrémité nord d'une plage de sable blanc, à l'Est 5 deg. Sud. (256)
J'allai faire ma visite au vieux chef Kéatanoui dit Porter (* Kiatonui qui continue à se faire appeler Pota/Porter ayant échangé son nom avec l’Américain en 1813) qui, dans ce pays où il n'existe pas d'autorité reconnue, jouissait de toute celle que peuvent donner l'amour et l'estime. Je trouvai ce bon vieillard sous un hangar élevé au bord de la mer, sur une plate-forme revêtue de gros galets (* Le paepae Pikivehine du Tohua Temehea à Taiohae) : il m'accueillit de la manière la plus affectueuse, me fit asseoir près de lui sur une natte, et parut charmé de voir chez lui un navire du pays aux bons fusils, car il ne connaissait la France que comme le lieu où ceux portés par le capitaine Sowle avaient été manufacturés.
Ce qu'il apprit de la quantité d'armes, de poudre, de dents de baleines, etc., que nous avions à bord, lui causa une satisfaction qu'il manifesta avec beaucoup de vivacité et de gestes qui, joints à l'expression de la physionomie la plus heureuse, servaient d'interprètes à ses paroles.
Le vieux chef ayant fait apporter des cocos pour me désaltérer, nous conversâmes quelque temps par l'intermédiaire d'un matelot anglais qui habitait l'île depuis plusieurs années. Nous fûmes bientôt environnés de naturels. Quelques femmes entrèrent sous le hangar, un plus grand nombre d'hommes vint s'asseoir sur la plate-forme ou resta debout à l'entour.
Les hommes étaient d'une stature supérieure à la plupart des Européens, et ne l'emportaient pas moins par la perfection de leurs formes. À l'exception d'une ceinture, ils étaient sans vêtemens, à moins qu'on ne considère comme tels (257) le tatouage pratiqué sur le corps et les membres des adultes. Les femmes, généralement de la taille des françaises, étaient pleines de grâces, parfaitement bien faites et d'une physionomie piquante et régulière. Les Nouhiviennes possèdent tous les attraits et toutes les grâces de leur sexe, à la pudeur et la modestie près.
Taïa, fille du chef, se faisait remarquer par les agrémens de sa figure, par sa physionomie jolie, et son regard doux, simple et coquet (* Peut-être Tahatapu, la fille aînée de Kiatonui, mère de Paètini). La couleur de leur peau est une nuance de citron clair. À l'exception de l'huile, dont elles font usage pour entretenir l'élasticité, les femmes, comme les hommes, étaient d’une propreté remarquable. Leur vêtement se compose d'une ceinture qui couvre la partie inférieure du corps, en tombant jusqu'aux genoux, et d'une espèce de manteau noué sur l'épaule gauche. L'un et l'autre sont d'une étoffe d'écorce d'arbre, aussi bien qu'une coiffure enveloppant les cheveux, qui sied très-bien à leur physionomie.
Le 25. - Les travaux furent suspendus à cause de la fête de Noël. Le capitaine Sowle vint dîner à bord. Le but de son expédition avait été originairement la pêche aux loups marins (258) (* les otaries à fourrure), mais les contrariétés survenues dans l'armement ne lui ayant pas permis de partir à temps pour employer la saison de 1816, ses armateurs lui avaient donné des fusils pour faire la traite du sandal, en attendant l'époque de la pêche. Il avait recueilli environ 6o tonneaux de bois pendant cinq mois de séjour dans cet archipel, dont il avait fouillé presque toutes les îles. Il était sur son départ pour poursuivre l'objet principal de son voyage. Ce qu'il me dit, et surtout ce qu'il venait de faire lui-même, confirmant les rapports que j'avais recueillis, sur l'utilité d'explorer les îles du vent (* Le groupe sud-est) où l'on se procure facilement et à peu de frais des provisions, dont une partie peut être employée en échange à Nouhiva, je me décidai à faire cette tournée, dès que je pourrais y être accompagné par M. Ross, celui des blancs résidant dans ces îles qui méritait le plus de confiance.
Le 27.- La Ressource partit pour la Chine, où elle devait disposer de son sandal avant d'aller à la pêche. Elle pouvait faire route après avoir visité la partie nord de l'île, où le capitaine Sowle espérait augmenter son chargement. Il voulut bien se charger d'un paquet (259) pour la France et d'une lettre pour Manille. Il devait laisser l'un et l'autre à Macao.
Le départ de la Ressource mettant M. Ross à ma disposition, je ne voulus pas différer plus long-temps de visiter les îles du vent. On avait fait de l'eau et du bois dès le lendemain de notre arrivée, les grès, devenus mols dans les chaleurs, avaient été ridés ; le bâtiment était en état de prendre la mer pour cette exploration. On désaffourcha de bonne heure. En même temps, pour dégager le pont, j'envoyai à terre sous le hangar de M. Ross, la drome de rechange et la baleinière qui étaient hors de service pour le moment. Nous appareillâmes sous toutes voiles, et à 4 heures, étant hors du port, nous mîmes en travers pour embarquer le grand canot, ainsi qu'une baleinière appartenant à M. Ross. Nous avions, outre ce traitant, cinq naturels, ses canotiers (* rameurs), et deux Anglais, résidant depuis quelque temps dans ces îles, qui m'avaient demandé passage dans l'intention de faire des provisions à Ohévahoa (* Hiva Oa). La nuit fut superbe ; à la faveur de la lune nous eûmes continuellement la vue des deux îles Nouhiva et Rahopou (* Nuku Hiva et Ua Pou). (260)
Le 29. - Nous fîmes peu de progrès. La faiblesse de la brise qui fut variable du N.-E. au S.-E., avec des intervalles de calme, nous retint toute la journée sous Rahopou, louvoyant pour doubler la pointe de l'Est.
À 11 heures du matin, en étant à petite distance le cap à terre ; la brise ayant molli pendant l'évolution, le navire manqua à virer vent devant. Après avoir été quelque temps sans obéir au gouvernail, il prit vent arrière à la faveur d'une risée de l'E. qui se leva au moment où la baleinière allait prendre la touline (* remorquer). Pendant cette manœuvre nécessairement lente, le bâtiment fut porté à une encâblure de la pointe devant laquelle est un rocher qui n'en est séparé que par un très-petit canal. Après avoir orienté, on trouva 25 brasses fond de gravier, à 2 encâblures de terre ; à deux milles de distance, il n'y avait pas de fond à 13o brasses.
L'île, dans cette partie, est stérile et inhabitée ; la côte est formée de rochers noirâtres dont quelques-uns sont détachés, mais qui s'étendent peu au large. Je n'ai pas appris qu'il y en eût de cachés. L'intérieur de l'île est en grande partie occupée par des montagnes, les plus hautes de (261) l’archipel, et encore plus remarquables par leurs formes pyramidales, par leurs coupes verticales et par leurs profils bizarres. La partie sous le vent est fertile et bien peuplée.
Le 3o. À 2 heures du matin nous doublâmes l'extrémité orientale de Rahopou et fîmes route largue pour Ohévahoa. Au jour, nous eûmes connaissance de cette île dans l’Est ; nous mîmes le cap dessus. Peu après on vit Taouhata (Santa-Christina) (* Tahuata) dans le sud-est. Après nous être mis en position de ne pas craindre les variétés, nous portâmes en dépendant sur la pointe sud-ouest d’Ohévahoa ; cette île, la plus fertile de l'archipel, devant être la première à visiter. En la ralliant, je dirigeai à en passer au sud dans le canal qui la sépare de Taouhata, pour gagner le mouillage de Taogou (Ontario des Américains) (* Tahauku) que Ross indiquait comme le plus favorablement situé pour nos projets. (À une heure du soir, nous trouvant à un mille par le travers de la pointe sud-ouest, un grain nous obligea de diminuer de voiles et fut bientôt suivi de calmes et de petites variétés, qui nous tinrent pendant 12 heures sans faire de progrès sensibles. (262)
Le 31. À une heure du matin, la brise se leva du N.-N.-O. et nous mit à 3 heures à petite distance par le travers du port, où nous restâmes sous les huniers pour attendre le jour. Contrariés par une variété de nord-ouest qui nous surprit dans l'ouest, ce ne fut qu'à onze heures et demie que nous laissâmes tomber l'ancre à l'entrée du port par 12 brasses, fond de sable gris.
Aussitôt mouillé, le navire fut environné d'Indiens venus principalement de la partie de l'ouest, tant en pirogues qu'à la nage. À midi, on élongea une touée pour hâler le navire dans l'intérieur ; mais la brise fraîchit et fit chasser l'ancre à jet, ce qui obligea à mouiller celle de bossoir avant d'avoir atteint la position désirée.
J'allai avec le traitant, dans sa baleinière, visiter le village de Taoa (* Taaoa) au fond d'une grande baie située à l'ouest du port Ontario (* Tahauku). Il n'y avait que trois mois qu'une embarcation du Flying-Fish, que nous avions connu au Callao, avait été enlevée dans cet endroit. Les malheureux qui composaient son équipage avaient payé de leur vie leur négligence, et leurs cadavres (263) étaient devenus la proie de leurs assassins.
Ross, qui deux ans auparavant avait fait dans ce village un séjour de plusieurs semaines, ne jugeant pas à propos de se livrer à ses anciens hôtes, nous restâmes sur les avirons à portée de fusil du rivage qui fut bientôt couvert d'Indiens des deux sexes. Il en vint un certain nombre à la nage le long des embarcations. La majorité était composée de femmes et de jeunes filles qui, sans être aussi jolies que celles de Nouhiva, étaient pleines de gentillesses ; elles n'annonçaient pas moins de complaisance, et je ne pouvais me faire à l'idée que des physionomies si engageantes appartinssent à une race de cannibales.
Les hommes, que la curiosité, ou peut-être quelque motif coupable, attirait près de nous, ne le cédaient pas pour la taille et les formes à ceux de Nouhiva, mais leurs membres annonçaient plus de vigueur et leur visage plus de rudesse ; on y remarquait une empreinte de férocité qui ne se trouve pas sur la physionomie de leurs voisins. Ils avaient la peau d'une teinte plus sombre, le corps plus velu et plus chargé de tatouage.
Nous ne restâmes là que fort peu de temps, (264) n'ayant pu avoir que quelques cocos ; les insulaires ne nous procurèrent ni bois de sandal, ni cochons, but principal de nos recherches.
À 6 heures nous allâmes dans la baleinière de Ross, escortée du grand canot, à l'anse d'Atouona (* Atuona), qui n'est séparée du port que par la langue de terre qui le ferme dans le nord-ouest ; nous accostâmes à la bande ouest bordée de rochers accores. Les Indiens nous y attendaient avec plusieurs lots de bois de sandal, dont nous obtînmes, en très-peu de temps, neuf quintaux pour autant de livres de poudre.
Les embarcations étaient de retour à sept heures. Afin d'entretenir le bon voisinage, il avait fallu donner passage à quelques jeunes filles qui avaient témoigné le désir de faire connaissance avec nos gens. On prit pour la nuit les mêmes dispositions qu'à la côte nord-ouest, à l'exception des filets qu'on ne hissa pas ; les pirogues à balanciers de ces insulaires et leur maladresse à les manier, ne permettant pas de craindre l'abordage de leur part.
Le 1° janvier 1818 - Nos embarcations furent le matin à Atouona, et en rapportèrent huit (265) à neuf quintaux de sandal et quelques cochons.
Le 2.-Je partis de bonne heure avec le traitant, dans sa baleinière, pour visiter les anses à l'Est du port. Le grand canot nous escorta, portant, outre son armement, des fusils et autres objets de traite. Le temps était beau, la brise faible du N.-N.-O. avec des accalmies.
À 7 heures nous arrivâmes à la petite anse de Hanahéhé, où nous mouillâmes. La vallée qui y aboutit paraît s'étendre dans l'intérieur. Elle est parsemée de cases jusqu'au rivage ; cependant le nombre des Indiens qui s'y rassemblèrent ne fut pas considérable. Il en vint quelques-uns des deux sexes le long des embarcations. Ross traita avec eux ; mais après avoir attendu pendant trois heures l'arrivée des cochons qu'ils avaient promis, nous fîmes route pour Hanamaté. Cette anse offre un meilleur abri que la première, s'avançant davantage dans les terres ; à l'une et à l'autre le fond est de sable : au reste, elles sont sans importance, à cause de la proximité du port Ontario qui est préférable à tous égards.
L'anse de Hanamaté est fermée à l'est, à (266) l'ouest et au nord par de hautes terres qui s'élèvent sur les rochers dont toute la côte est bordée. Notre tournée ne fut pas infructueuse, car nous nous procurâmes avec facilité trente cochons, dont une partie avait été portée d'Hanahéhé. Nous payâmes le tout avec trois fusils. Nous appareillâmes avec ce chargement, et arrivâmes à bord à 4 heures. Pendant notre absence, on avait eu des Indiens 4 quintaux de sandal et 6 cochons.
Le 3.- À 4 heures du matin, nous partîmes avec les embarcations armées comme précédemment. Nous nous rendîmes directement à Hanamaté, qui me parut être à 7 ou 8 milles de Taogou. Excepté au fond des deux anses où nous avions été, et de trois ou quatre autres points, où aboutissent des ravins, la côte s'élève en falaise jusqu'à plus de cent pieds de hauteur, et rarement au-dessous de trente. Elle est généralement revêtue d'un rocher noirâtre dont la composition et les formes déposent de l'origine volcanique de l'île. Des fragmens détachés à quelques brasses de la côte sont percés d'un grand nombre de trous disposés avec une sorte (267) de symétrie, et représentent quelquefois des ruines de façades gothiques. Dans plusieurs endroits, le rocher forme une espèce de quai au pied de la falaise. Nous en remarquâmes un, en deçà de Hanahéhé, occupé par des Indiens qui y avaient une pêcherie. Leur case était construite sur une espèce d'élévation que la nature avait pratiquée.
Quoique M. Ross eût pris la veille des mesures qui devaient prévenir toute espèce de retards, il fallut beaucoup de temps pour rassembler le chargement qui fut encore composé de cochons. M. Ross descendit avec son ami pour lever quelques difficultés. Voyant beaucoup de femmes et d'enfans au bord de la mer, je voulus en faire autant, et je mis à terre sur un rocher au pied de la montagne qui forme la bande Est de l'anse. Je fus bientôt entouré de femmes ; elles étaient généralement plus grandes et plus fortement constituées que celles de Nouhiva, mais elles leur étaient fort inférieures pour les grâces des formes, ainsi que pour la douceur et la délicatesse de la physionomie. Ross revint après une courte absence, et trouva ma démarche imprudente, malgré la (268) garantie que devait donner la proximité du canot armé. Nous nous rembarquâmes accompagnés de son ami. Peu après, la femme de ce dernier, qui, depuis notre arrivée, s'était souvent fait voir à la nage autour des embarcations, voulut bien nous honorer de sa présence, et vint dans le canot en costume de bain, c'est-à-dire, avec une ceinture de feuilles de bananier destinée à voiler ses charmes. J'appris de M. Ross que cet heureux époux avait une seconde femme et qu'il partageait leurs faveurs avec une douzaine d'amis. Pour vaincre mon refus à l'invitation qu'il m'avait déjà faite de passer une journée chez lui, il m'offrit, pour la nuit, la compagnie de celle de ces dames dont la visite avait annoncé des dispositions si hospitalières : c'était une grosse réjouie d'environ 22 ans : malgré les devoirs très-multipliés qu'elle avait à remplir, sa santé n'en paraissait pas moins florissante, mais je ne jugeai pas à propos d'accéder à la proposition de son mari.
Un jeune Américain nommé Ch. Person, natif de Boston, qui demeurait depuis plusieurs mois avec un vieux chef, père de l'ami de Ross, s'était rendu à Hanamaté, au moment (269) de notre départ, pour voir ce dernier. Je l'engageai à venir à bord, espérant en tirer quelques renseignemens ; il se louait beaucoup de ses hôtes, mais il faut dire qu'il n'avait rien qui pût les tenter (6).
(6) J’ai su en Chine que Person ayant reçu d'un bâtiment des Etats-Unis des fusils et de la poudre pour traiter du sandal, n'avait échappé qu'avec beaucoup de peine aux Indiens, qui voulaient s'emparer de ses marchandises, dont ils firent leur proie. Malgré cette leçon, ce jeune homme, appartenant à une famille connue de Boston, avait fait un second essai de la société des sauvages aux îles Fidji.
Nous emmenâmes à bord 31 cochons, dont deux arrivèrent morts. On avait établi un parc pour ces animaux et on en avait tué deux qui, la veille, avaient souffert dans les embarcations. Nous eûmes aussi quelques fruits à pain. Le soir, les canots allèrent traiter avec les Indiens réunis en grand nombre à la bande Est du port. Ils revinrent à bord avec 19 cochons et quelques quintaux de sandal.
Le 4. À 11 heures du matin, je repartis avec Ross pour Taaoa, où d'après les promesses qu'on nous avait faites précédemment, nous devions trouver du bois et des vivres. Vu le mauvais état de la seule embarcation légère qui restât au (270) navire, je désirais aussi faire acquisition de la baleinière du Flying-Fish, que les Indiens avaient hâlée à terre après le massacre de l'équipage.
Peu d'instans après leur arrivée, les deux canots furent environnés d'Indiens des deux sexes, venus à la nage. La plupart étaient de jeunes Indiennes qui folâtraient comme des néréïdes et cherchaient à se surprendre en plongeant ; elles nageaient dans les positions les plus variées, et ne manquaient pas de venir ensuite demander la récompense du spectacle qu'elles nous avaient donné : un morceau de biscuit les contentait.
Les anciennes connaissances de Ross étaient aussi venues le visiter, et lui apporter des témoignages de leur affection. Ils l'engagèrent à descendre, mais leurs démonstrations voilaient des desseins perfides. Un canotier du traitant (* un des rameurs du commerçant), envoyé pour prendre connaissance de l'état de la baleinière que je voulais acheter, rapporta que les Indiens avaient déposé des armes dans un endroit couvert par des rochers, et que sans aucun doute ils les auraient tournées contre nous, si on s'était laissé aller à leurs invitations fallacieuses. Nous nous séparâmes de ces anthropophages, (271) sans avoir rempli l'objet de notre course. À trois heures nous étions de retour ; je repartis presqu'aussitôt pour relever les points principaux du port et de la côte environnante. La pluie me fit renoncer à l'exécution de ce projet.
Le 5.- La nuit, on prit les précautions ordinaires. Le temps fut très-chargé et sombre, une grande pluie tomba presque sans interruption ; une petite fraîcheur du nord succéda au calme vers minuit.
À une heure et demie du matin, le chien aboya avec furie ; peu après on s'aperçut que l'amarre d'avant du grand canot avait été coupée ; on en frappa aussitôt une autre, et on redoubla de surveillance. À deux heures un quart, les deux amarres furent coupées en même temps, absolument sous les yeux des gens de quart, dont l'attention excitée par la première tentative était plus particulièrement fixée sur l'embarcation. Mais l'extrême obscurité ne leur avait permis d'apercevoir que le déplacement du canot qui commençait à s'éloigner du bord ; il était encore assez près pour qu'on pût y sauter et s'en assurer. L'équipage fut aussitôt sur pied. Je fis tirer quelques coups de fusil sur les deux rives, quoique le plus profond (272) silence y régnât. Aussitôt armé, le grand canot fut visiter les amarres. On s'était déjà assuré en le hâlant que le grelin d'affourche était coupé : un toron du câble l'était aussi.
On découvrit sur la sous-barbe à la flottaison une petite amarre de bastin (bourre de cocotier) très-roide, dirigée sur la côte de l'Est ; on tira de ce côté une caronade à mitraille et plusieurs coups de fusil : l'amarre fut aussitôt larguée. J'envoyai le grand canot lever l'ancre d'affourche, mais dans l'obscurité il ne put pas trouver la bouée. On continua à faire bon quart et de fréquentes rondes jusqu'au jour : deux hommes restèrent dans le canot amarré le long du bord. À 5 heures, on eut connaissance de la bouée de l'ancre d'affourche, qu'on alla lever aussitôt.
Notre courte relâche nous avait procuré, outre quelques provisions végétales, 4 milliers de sandal et plus de 8o cochons (* Le millier valait 10 quintaux ou 1 000 kg. Il représentait le poids de 1 m3 d'eau pure à 4 °C. Sous l'Ancien Régime, le millier valait 3,5 charges, équivalant à 489,51 kg - Wikipédia) Ayant rempli le principal but que je me proposais, je ne voulus pas prolonger mon séjour parmi ces perfides sauvages, et je résolus de retourner à Taïa-Hoy (*Taiohae), où nous appelaient les besoins du navire, sans toucher aux autres îles du sud de (273) cet archipel, toutes habitées par des peuplades aussi méchantes que ceux d'Ohévahoa. D'ailleurs le sandal y est inférieur à celui de Nouhiva.
Pendant qu'on s'occupait des dispositions d'appareillage, un vieux chef que nous avions vu plusieurs fois vint avec plusieurs autres Indiens nous porter quelques quintaux de sandal et des cochons. Afin d'en connaître les auteurs, je feignis de le croire impliqué dans la tentative hostile dont nous venions d'être l'objet. Quoique sa démarche actuelle déposât de son innocence, à cette accusation, le vieillard fut frappé d'un effroi plus difficile à peindre qu'à expliquer. Il protesta de son innocence, et désigna ceux d'Atouona comme coupables de l'attentat, auquel il n'avait pu prendre part, appartenant à une vallée ennemie et éloignée. Sa déposition fut confirmée par les autres Indiens. Tous en partant parurent s'estimer heureux de n'avoir pas éprouvé les effets de notre vengeance ; peut-être est-ce à la crainte des représailles que nous dûmes d'obtenir pour un pistolet les objets qu'ils avaient apportés (274).
À une heure, nous appareillâmes du port de Taogou et louvoyâmes pour sortir de la baie. Quoique remorqués par le grand canot et la baleinière, nous fîmes peu de progrès, la brise étant faible et la houle portant en dedans vers le village de Taoa. À 4 heures le vent fraîchit et nous gouvernâmes pour nous détacher de la côte. La quantité d'animaux parqués sur le pont ne permit pas d'embarquer la pirogue de Nitinat (* ?) ; elle fut laissée à la remorque.
Nous eûmes dans la nuit des rafales assez fortes, avec un temps nuageux et très-sombre. Obligés de mettre à terre l'Américain que j'avais pris à Hanamaté, nous louvoyâmes pour nous élever dans l'Est, poussant des bordées sur Ohévahoa et jusqu'à Motani. Nous éprouvâmes sous cette dernière île de forts courans portant ouest, qui nous empêchèrent de la doubler. Le matin, la bosse de la pirogue cassa. Motani étant alors à petite distance sous le vent et la mer grosse, je ne voulus pas mettre en panne pour recueillir cette embarcation, qui nous était peu utile, et qui d'ailleurs se trouvait en mauvais état.
À 9 heures, étant sous le vent d'Hanamaté et assez près de terre, M. Ross y mena son (275) jeune compatriote. Lorsqu'il fut revenu, on força de voiles pour donner dans le canal (* du Bordelais, justement). À notre retour, nous nous occupâmes des travaux que la navigation pénible, les pertes et les avaries que le navire avait éprouvées, rendaient indispensables. Le charpentier fut employé à terre au radoub de la baleinière, ses aides à calfater l'extérieur, l'armurier à faire des outils pour nettoyer le sandal, c'est-à-dire enlever l'aubier et le bois détérioré, ainsi qu'à divers travaux d'entretien. Le reste de l’équipage fut employé à disposer la cale pour recevoir le sandal, et ensuite à faire du bois, du charbon, à visiter le grément, etc.
Dans les premiers jours de notre retour nous eûmes quelques milliers de bois en échange pour des cochons ; mais ce trafic fut de courte durée, l'époque des grandes solennités à laquelle il se fait une consommation énorme de ces animaux étant éloignée de plusieurs mois.
Le 11. - Le temps, qui depuis notre retour avait été généralement pluvieux et à grains, fut assez beau. J'allai avec le traitant à Hacahouy (* Hakaui), à 2 lieues dans l'ouest. Les Américains appellent cet endroit Louis Bay, du nom du premier (276) de leurs capitaines qui y entra, quoiqu'il eût été devancé par le célèbre capitaine russe Krusenstern, qui l'a appelé Port Tchitchagoff (* en juin 1804), nom qui probablement ne sera jamais prononcé par un habitant des îles Marquises.
Nous sortîmes par la passe en dedans du rocher de l'ouest, qui n'est praticable que pour les embarcations ; nous passâmes devant l'anse de Chaoutoupa (* Haaotupa/Haèotupa/Aotupa ; la 1ère baie à l’est de Taiohae, appelée Baie Collet par les Français en 1842 du nom du 1er commandant des îles Marquises du Nord, Jean Benoit Amédée Collet), séparée de ce port par une langue de terre. On voit au fond quelques cases et des bouquets clairsemés de cocotiers et d'arbres à pain.
De là à Hacahouy, la côte est formée par une falaise de plus de 1oo pieds de haut, qui offre à peine une coupure où l'on puisse débarquer. Comme à l'Est de Taïa-Hoy, on y voit souvent des couches parallèles de diverses nuances et des rochers volcaniques, dont quelques-uns s'élèvent jusqu'au haut de la falaise.
En rangeant la côte, on ne peut manquer d'en remarquer un situé à peu près à moitié chemin. Le choc perpétuel de la mer y a miné une caverne profonde dans laquelle la lame s'engouffrant avec une force prodigieuse, y produit une détonation semblable à celle d'une forte bouche à feu, tandis qu'une partie des eaux (277) s’échappent par un soupirail que les mêmes vagues ont également pratiqué dans la voûte, s'élance à une hauteur considérable, où elle se disperse en brume. Ce double phénomène a fait donner à ce rocher le nom de la Baleine, par nos gens, dans les courses que nous fîmes plus tard à Hagatia (* Hakatea).
À un mille de cette entrée en venant de l'est, la côte forme une anse que les naturels appellent Ouahouga (* Uauka). Après l'avoir doublé, on voit deux petits enfoncemens contigus, dont l'un, celui de Hacahouy (* Hakaui), courant nord, aboutit au village ; l'autre, Hagatea (* Hakatea), forme dans le Nord-Est un petit port, qui pour la sûreté du mouillage ne laisse rien à désirer. La passe extérieure n'a pas plus d'une encâblure et demie de large entre la pointe Est et la côte opposée, qui du village s'étend en falaise dans le sud-sud-est, à 2 milles environ. Au milieu et jusqu'à ½ encâblure de la pointe, on trouve 18 et 2o brasses d’eau, sur un fond de sable gris, vasard dans la passe, et des coquilles brisées au-dehors.
L'anse d'Hacahouy termine, dans le sud, une vallée que nous parcourûmes dans la partie opposée, à plus d'une lieue. À l'Ouest et à l'Est, (278) elle est resserrée par deux remparts de rochers, qui, au bord de la mer et à plus d'une demi lieue dans l'intérieur, bornent sa largeur à 3 ou 4 cents toises au plus. La montagne de l'Est s'abaisse ensuite, et se repliant vers cette partie, elle permet à la vallée de s’étendre dans le nord-est. L'autre se lie au sud avec la falaise et se prolonge dans l'intérieur vers le nord. Toutes deux dominent de beaucoup les plus grands arbres de la vallée. Un grand ruisseau, qui coule entre le village et la montagne de l'Est, répand dans cette heureuse vallée une fertilité extraordinaire. Tout le terrain qui n'est pas occupé par les nombreuses cases des naturels est entièrement couvert de diverses plantes, de cocotiers, d'arbres à pain, de bananiers, de papayers et autres grands végétaux des tropiques. Les uns produisent des alimens aussi agréables que salutaires, les autres fournissent des matériaux pour les habitations, ou pour le peu de vêtemens que la coutume et la vanité, plutôt que le climat, imposent aux naturels. Enfin ils procurent un ombrage paisible et rafraîchissant, qui dans la longue durée des chaleurs est l'abri le plus agréable et le plus salutaire. (279)
Les Indiens des deux sexes ne sont pas moins favorisés de la nature que ceux de Taïa-Hoy. Je remarquai une plus grande proportion d'individus à taille colossale, et en général ils étaient plus fortement constitués. Le teint des femmes me parut aussi se rapprocher davantage du blanc que celui de leurs voisines, différence qu'on peut expliquer par l'ombrage presque continu qui couvre la vallée.
Quoique Ross m'assura que ces gens-là ne valaient pas ceux de notre port et qu'il ne fallait pas se fier à eux, nous fûmes partout accueillis avec les démonstrations les plus satisfaisantes. Dans plusieurs cases que nous visitâmes en cherchant du sandal, on nous offrit des cocos excellens et superbes. Étant entré seul dans une des plus apparentes, je trouvai, dans le négligé de la nature, deux jeunes femmes, les plus belles que j'aie vues dans cette partie du monde. La curiosité de ces houris (* En Islam, vierges du paradis, récompense des bienheureux) et de leurs voisines, dont je fus bientôt entouré, étant excitée par mon costume et par la couleur de ma peau, j'eus quelque peine à me soustraire aux recherches singulières dont elles voulaient me rendre l'objet.
Avant de partir nous fîmes une collation avec (280) les vivres que nous avions apportés du bord et avec des fruits du pays, dans une petite case située au bord de la mer, sous un ombrage délicieux. Elle était occupée par une veuve et sa fille, qui nous accueillirent de la manière la plus affable.
Le 14. – (* À Taiohae) Il vint deux doubles pirogues d'Ohévahoa, qui n'entrèrent qu'après avoir croisé quelque temps dans le port et annoncé leur arrivée en soufflant dans de grosses conques qui produisaient un son semblable à celui des cornemuses. Elles furent halées sur la grève avec beaucoup de pompe et de grandes acclamations, par les habitans du port accourus en grand nombre des différentes vallées, dans le costume le plus recherché. Le beau sexe ne manqua pas une occasion si favorable à sa curiosité et surtout au désir de se faire voir, qu'il éprouve partout pays ; mais ici où la nature n'a pas d'entrave, il se manifeste de la manière la plus franche. Au reste tout se passa avec la plus grande décence et même avec une certaine gravité cérémonieuse. Dans la journée, ces étrangers, au nombre d'environ quarante, nous apportèrent, outre des (281) pièces de toile, des calebasses et autres richesses de leur pays, un poëme en l'honneur du premier né du jeune chef, petit-fils de Kéatanoui Porter, et d'autres productions de leur génie poétique, qu'ils chantaient sur des airs assez monotones et qui tenaient un peu de notre plain-chant.
Le 21. - Je fis acquisition d'une baleinière appartenant à un naturel d'Otahiti. Sans être en bon état, elle pouvait nous être très-utile après avoir subi un radoub ; elle coûta au navire un fusil et 8 livres de poudre. Le même jour une décharge nous annonça la mort d'un jeune chef, petit-fils de Kéatanoui Porter. À notre première arrivée nous l'avions trouvé dans un état de marasme affreux, causé par une consomption à laquelle était joint un vice vénérien.
Le 25.- On vit descendre des différentes vallées un grand nombre de femmes qui se rendaient à la case d'un vieux chef, nommé par les Indiens Pahoutéhé, et l'Éléphant par les étrangers, à cause de sa grosseur énorme. J'appris de Ross que ce concours extraordinaire du beau sexe avait lieu à l'occasion de l'état désespéré de sa femme, auprès de qui elles (282) allaient célébrer les cérémonies lugubres dont je parlerai plus loin.
Outre la traite du sandal, on s'occupa dans le courant de ce mois à finir la visite du grément, à achever le calfatage extérieur, à compléter l'eau, le bois et le charbon. L'armurier termina la visite des armes de traite et les réparations dont elles avaient besoin. Malgré les courses des pilotins qui allaient fouiller les vallées autour du port, la traite du sandal n'était pas très-productive. À la fin du mois nous n'en avions à bord que 22 milliers.
Le 5 février. Quoiqu’il restât pendant la nuit une garde de quatre hommes aux futailles (* genre de tonneau) que nous avions au hangard de Ross pour les réparer, on s'aperçut, à minuit, qu'il en manquait deux. Trois de nos hommes furent aussitôt à la recherche et en trouvèrent une, apparemment la dernière dérobée, que les Indiens abandonnèrent à leur approche. L'autre fut perdue sans retour. On apprit que ce vol avait été commis par les voyageurs venus d'Ohévahoa. On enlevait fréquemment des outils à nos ouvriers.
Le 9. - Je descendis à terre de bonne (283) heure, et j'allai avec Partarieux et Ross faire une tournée sur la plus élevée des montagnes qui ferment les vallées dans la partie nord-est du port. Nous éprouvâmes beaucoup de fatigue pour gravir le sentier escarpé, tantôt à pic, tantôt en rampe, qui conduit au sommet.
Dans cette course, j'eus l'occasion d'admirer l'agilité avec laquelle les indigènes franchissent les endroits les plus dangereux. Quoique souvent chargés de 5o à 6o livres de sandal, ils avançaient beaucoup plus lestement que nous qui ne portions rien. Heureusement que les buissons et les roseaux qui bordent les précipices en rendent le passage moins périlleux. À moitié chemin de la montagne, on trouve une fontaine d'eau délicieuse, près de laquelle nous déjeûnâmes. Quelques naturels que nous rencontrâmes, se montrèrent très-affables et obligeans.
Arrivés sur le sommet d'où l'on domine la côte et l'intérieur, la plus belle vue s'offrit à nos regards. De la partie Est on plonge sur la baie du Contrôleur, la grande vallée des Taïpis (* Taipi), celle des Happas (* Hapaa) dont on voit les cases, les premiers à une lieue, les autres à deux. Il y a de ce côté un chemin moins mauvais que (284) celui par lequel nous avons monté, quoiqu’encore très-escarpé. C'est par là que le capitaine Porter a passé, marchant contre les Taïpis, et que les naturels de Taïa-Hoy, ses alliés, ont monté un canon jusqu'au fort : entreprise qui, pour ces sauvages, présentait autant de difficultés, que celle du passage du Mont-Saint Bernard par nos armées.
Le 16.-Les voyageurs d'Ohévahoa partirent pour retourner dans leur île. Ils avaient tiré bon parti de leurs marchandises, et surtout des productions de leur muse qui leur avaient valu l'accueil le plus hospitalier et beaucoup de présens que leur faisaient les nombreux amateurs qui accouraient à leurs concerts. Ces représentations s'étaient répétées très-souvent, particulièrement dans les premiers jours de leur arrivée. La multitude des deux sexes qui venait des parties les plus reculées des vallées et se réunissait dès le matin, me fit présumer que la fête était annoncée d'avance, et que le jour et le lieu étaient fixés.
Ce dernier était toujours une de ces arènes qu'on trouve dans toutes les vallées, en forme de rectangle (* le tohua koìka, ou place des festivités) de trois à quatre cents pieds de long, et large du quart, à peu (285) près, entourée d'un parapet à hauteur d'appui, de dix pieds d'épaisseur, revêtu et couvert de gros galets, et quelquefois de dalles d'une pierre taillée très-molle. Il règne souvent une rangée d'arbres sur le terre-plein ou à l'intérieur, à petite distance du revêtement. Il y a toujours à l'extérieur plusieurs allées qui forment des promenades agréables dont la fraîcheur ajoute aux avantages de ces amphithéâtres. Les musiciens se réunissent à une des extrémités, où ils se tiennent accroupis. Le principal de la troupe ou le poëte lui-même, chante d'abord seul chaque couplet qui est aussitôt répété en chorus par les autres. Les uns s'accompagnent en frappant dans leurs mains, les autres, tenant l'avant-bras gauche appuyé sur la poitrine, frappent à la fois de la main droite la poitrine et la partie externe du bras, à l'articulation (poko). Par la force qu'ils emploient, chaque coup rend un son très-fort, et il arrive quelquefois qu'ils se meurtrissent au point de s'enlever la peau du bras. Ils ont aussi de grands tamtams (pahou) (* pahu), seul instrument que j'aie vu chez eux.
À leur arrivée au lieu du concert, la plupart des amateurs déposent leur offrande (286) aux pieds des musiciens. Les individus des deux sexes ne se présentent que parés de ce qu'ils ont de plus beau et de plus précieux. Les toiles neuves sont réservées pour ces occasions où tout leur extérieur offre l'apparence d'une propreté recherchée, mais on est désagréablement détrompé en approchant, lorsque le témoignage de plus d'un sens annonce à l'étranger que l'huile de baleine a coulé à grands flots. Au reste, les femmes ne s'étaient pas montrées moins attentives que les hommes, pour traiter ces heureux visiteurs de la façon la plus hospitalière ; il y avait tous les soirs autour de la grande case, qu'on leur avait cédée, un nombreux rassemblement de jeunes filles, qui ne laissaient rien désirer à ces étrangers de ce qui pouvait leur faire oublier les belles de leur pays.
Le 17.- Nous n'avions pu nous procurer que 1o milliers de sandal depuis le commencement du mois ; il en restait peu dans les vallées du port, je pensai à en extraire d'Hacahoui. À 6 heures et demie du matin, je partis dans la grande baleinière de bord, armée, accompagné du traitant dans la sienne qui marchait beaucoup mieux. Le temps qui avait été très-pluvieux (287) la nuit, s'embellit, et à la faveur de la brise N.-E., notre traversée fut agréable et prompte.
Je descendis avec Ross et une partie des Indiens de son embarcation, nos canotiers restèrent dans la baleinière, mouillée à une petite distance de la plage. Nous fûmes accueillis avec bienveillance par les amis de Ross, et surtout par un chef, dont nous avions eu la visite à bord, qui n'était pas moins remarquable par sa taille de près de sept pieds, que par la parfaite proportion de toutes les parties de son corps gigantesque (* Probablement Pautini, admiré par Crook en 1798 et par Krusenstern en 1804).
Il me sembla cette fois que les habitans d'Hagatea ne recevaient pas les étrangers avec cette expression de cordialité et de satisfaction qui donne tant de charmes à l'accueil qu'on éprouve à Taïa-Hoy. Il faut avouer, cependant, que si les femmes n'avaient pas autant de grâces et d'enjouement que nos voisines, elles ne se montraient pas moins disposées à nous faire les honneurs du pays.
Nous poussâmes nos recherches jusqu'à plus de deux lieues dans l'intérieur. Nous entrâmes dans une vingtaine de cases dont les propriétaires avaient du sandal. La plupart de ces cases étaient construites sur la rive droite d'un joli ruisseau, que (288) nous passâmes à gué. Près de là, nous fîmes un repas de cocos et de biscuit, chez un ami de Ross. En retournant nous suivîmes un autre chemin et visitâmes les cases que nous n'avions pas encore vues. Nous repassâmes près de celle du chef (le colosse) qui avait fait préparer pour notre déjeûner un mélange de fruit à pain et de noix de cocos réduit en pâte, dont les canotiers de Ross se régalèrent.
Nous retournâmes ensuite au bord de la mer, où j'entrai en marché pour du sandal. Dans cette occasion, un acte de confiance irréfléchi de ma part faillit avoir les suites les plus graves. Un des propriétaires de sandal était venu avec moi dans la baleinière, pour voir la poudre que je lui offrais pour prix de son bois : après avoir conclu le marché, je crus pouvoir accéder à la demande qu'il me fit d'emporter sa poudre à terre, d'autant plus que le bois était sur la plage prêt à être embarqué. Lorsque Ross vit la poudre entre les mains de l'Indien, il s'exprima formellement sur l'imprudence d'un pareil abandon ; en effet, lorsqu'environ la moitié du bois eût été embarquée, l'Indien, sous prétexte qu'il n'était pas suffisamment payé, refusa de (289) livrer le reste. Il était assis près du monceau de bois, tenant à la main une espèce de massue. Les pensées qui l'agitaient donnaient à sa physionomie une expression de férocité, qu'il était aussi difficile de méconnaître que de voir sans un sentiment d'horreur.
Après lui avoir fait faire par Ross des représentations pressantes sur l'injustice de ses prétentions, jugeant par son silence et sa contenance qu'il fallait des argumens plus forts pour l'engager à s'en désister, je hélai la baleinière d'accoster et de prendre les armes, en recommandant de ne pas en faire usage sans ordre. Je retournai aussitôt à l'Indien et faisant sauter le bâton de sa main, d'un coup de billot, dont à son exemple je m'étais pourvu, je lui demandai sèchement son ultimatum. Il laissa encore cette question sans réponse ; mais son silence morne, son regard de tigre, l'expression farouche de sa figure, annonçaient qu'il était agité par les passions les plus furieuses.
Pendant qu'il flottait entre les tentations de la cupidité et la crainte du châtiment, son père, qui était présent, craignant les suites de son opiniâtreté, en me voyant résolu de soutenir par la force la justice de mes droits, (290) prit une brassée de bois et la jeta dans la baleinière. Son exemple fut aussitôt suivi par plusieurs autres sauvages, et en un instant le bois fut embarqué. Je me félicitais de l'avoir emporté sans en venir aux dernières extrémités ; mais l'Indien, furieux de n'avoir pu tirer parti de mon imprudence, méditait une vengeance cruelle. Après avoir porté la poudre chez lui, il revint armé d'une massue de hauteur d'homme et grosse à proportion, telle que ces insulaires portent souvent en guise de bâton, et pendant que je me promenais sur la grève dans la plus grande sécurité, il vint à moi par derrière, tenant sa massue à deux mains, et déjà il l'avait levée sur ma tête, lorsque son père s'élança à temps pour lui arrêter le bras ; ensuite il l'entraîna d'un autre côté.
Je ne sus ce fait de Ross que dans notre trajet au retour, le bruit que faisaient les Indiens répandus sur la plage et quelques pensées dont j'étais préoccupé, m'ayant empêché de faire attention à ce qui se passait derrière moi. Cet homme, que Ross signalait comme un des plus méchans et des plus dangereux des îles, était du petit nombre de ceux qui avaient (291) deux femmes attitrées. C'étaient les deux belles personnes si blanches dont j'ai déjà parlé, et quelle que fût chez lui la violence des passions, on put s'assurer du moins que la jalousie n'accompagnait pas celle dont j'avais fait l'épreuve.
J'eus beaucoup à me louer dans cette occasion des bons offices de Jahouhania (* Peut-être Hahuhania), prêtre (* tauà ou tuhuka ooko, comme la possession d’une conque le décrit plus bas) d'une des vallées près d'Hacahoui. Nous étions de connaissance depuis quelque temps ; il était venu me voir à bord, et m'avait demandé de changer de nom avec lui : il était connu depuis sous le nom de Roki, le mien (* Roquefeuil) ne pouvant pas être prononcé par ces insulaires.
J'eus lieu de croire que ce n'était pas de la part de cet homme, chez qui tout annonçait un bon caractère, une démarche dictée par la vanité ou l'intérêt. Il joignit ses instances à celles de ses compatriotes pour m'engager à conduire le navire à Hagatea ; mais tous les compatriotes de ce brave homme ne m'inspiraient pas, à beaucoup près, les mêmes sentimens que lui ; d'ailleurs ce changement de mouillage ne m'offrait aucun avantage pour l'expédition.
Depuis cette liaison mon ami me visita de temps en temps, et m'apporta quelques présens (292), entr'autres un bel éventail du pays : il ne manquait pas chaque fois de me faire remarquer l'état d'épuisement où était réduite la bouteille d'eau-de-vie, qu'il avait reçue précédemment, et qu'il portait en sautoir comme pour faire le pendant de la conque garnie d'une touffe de cheveux, qui est la marque distinctive de ceux qui, chez les Indiens, se mêlent des choses religieuses.
Nous fîmes encore trois courses à Hacahoui, qui produisirent environ 11 milliers de sandal, généralement plus gros que celui de Taïa-Hoy. Tout se passa tranquillement dans nos relations avec les naturels ; nous traitâmes toujours sur la plage à portée des embarcations. Je ne m'écartai plus de ces précautions, d'après l'avis de Ross, qui me dit qu'aucun étranger n'avait été si avant que moi dans la vallée d'Hacahoui.
Dans ces différentes tournées, je mesurai une base au fond d'Hagatea et quelques angles, et je pris des sondes pour esquisser le plan du mouillage.
Le 25.- Nous nous trouvâmes avoir à bord 420 quintaux de sandal qui prenaient plus de (293) 80 tonneaux d'encombrement, et qui, avec la cargaison de traite, remplissaient tellement le navire qu'il fallut en mettre dans le logement de l'arrière, dans les caissons, et même en laisser sur le pont.
Les travaux pour mettre le navire à même de prendre la mer furent retardés par le gros temps qui régna à la fin du mois, et nous incommoda aussi dans nos courses. Depuis le 17 (* janvier), il venta presque tous les jours avec beaucoup de pluie. Le 23, la chaîne entalinguée sur l'affourche cassa encore dans un saut de vent de la partie sud. L'orin (* câble avec bouée) ayant aussi manqué, il fallut draguer l'ancre pendant plusieurs heures. Malgré le désir que j'avais de me rendre à la côte nord-ouest le plus tôt possible, ces diverses contrariétés ne nous permirent d'achever nos dispositions que le 27. On désaffourcha de bonne heure, mais le calme nous retint encore au mouillage. M. Siepky, troisième officier, fut débarqué à sa sollicitation et sur l'attestation de M. Vimont, chirurgien, que sa santé mauvaise dès le commencement de la campagne, était dans un état (294) à ne pas lui permettre de la continuer. Je réglai aussi avec Ross, des services duquel j'avais été satisfait.
Le 28. - À 9 heures et demie du matin, nous appareillâmes.
VOYAGE AUTOUR de MONDE (295)
CHAPITRE VII
Détails sur les îles Marquises - Productions de leur Sol - Nature de leurs mouillages - Caractère, mœurs et coutumes des naturels.
Les îles Marquises sont une bonne relâche pour les bâtimens qui, après avoir doublé le cap Horn, seraient appelés, par la nature de leur expédition, dans quelques parties de l’Australasie ; pour les baleiniers qui fréquentent le grand Océan méridional ; pour les navires allant à la côte nord-ouest, à qui des besoins urgens ne permettraient pas de pousser jusqu'aux Sandwich, en tout préférables. Enfin les Marquises sont la relâche naturelle des navigateurs destinés à aller des ports de l'Amérique méridionale à la Chine, et de ceux qui, partant de la côte nord-ouest, vont doubler le cap Horn.
Malgré les facilités qu'offre le port de Taïa-Hoy (* Taiohae) pour l'eau et le bois, et la confiance que doit inspirer la conduite paisible des habitans jusqu'à ce jour, celui de Taogou à Oévahoa (* Tahauku à Hiva Oa) (296) me semble devoir être préféré, surtout par les navigateurs dont la relâche n'est motivée que par le besoin de rafraîchissemens. La cascade de la bande nord-ouest, et le petit bois qui l'environne, leur fourniront l'eau et le chauffage, avec cet avantage qu'amarré par le travers de l'aiguade, le navire aura ses corvées sous la protection de sa mousqueterie en cas de tentatives de la part des Indiens ; d'ailleurs une vigie au haut des mâts pourrait éclairer tous leurs mouvemens, le pays étant absolument nu dans cette partie, à l'exception du petit bois ou plutôt d'un bouquet dont les arbres sont clair-semés.
Il serait bon de garder à bord jusqu'au départ quelques filles de chef, qui sont aussi empressées de visiter les étrangers que celles de la plus basse classe. Les embarcations bien armées, et sous la direction d'un officier prudent, pourront aller dans les anses de la partie de l'est recueillir des rafraîchissemens. Outre les cochons dont il est facile de se procurer un nombre quelconque, à raison de dix pour un fusil, cette île produit beaucoup de cannes à sucre, des patates, des citrouilles, ainsi que des bananes, des petites oranges à (297) chair rouge, et plusieurs espèces de fruits, outre celui à pain, qui, avec les cocos, est la base de la nourriture des habitans.
On y trouve aussi une espèce de noix appelée ahi (* probablement « ihi », fruit du châtaigner éponyme - inocarpus fagifer -appelée aussi de son nom tahitien « māpē » et le ty, (* tī, la cordyline fructifosa) racine dont le suc a la même qualité et est presque aussi abondant que celui de la canne, et qui, cuite sous la cendre, est un aliment agréable et sain.
Tout vaisseau mouillé sur la côte recevra probablement comme nous, des naturels mêmes, une quantité de ces objets qu'il n'est pas possible de se procurer à Nouhiva, où, à l'exception de quelques cocos, on ne trouve que de l'eau et du bois. Si en passant aux Marquises on a l'intention d'y prendre du sandal, la relâche d'Oévahoa aura encore son utilité, quoique ce bois y soit d'une qualité inférieure, et on pourra s'y procurer divers objets d'un échange avantageux à Nouhiva (* Nuku Hiva).
Cette dernière île produit le meilleur sandal de l'archipel. Le capitaine Rogers, américain, fut le premier à en extraire pour le commerce, après avoir fait la découverte de ce bois précieux en passant près d'un feu, à l'odeur que répandaient quelques morceaux que les Indiens y avaient jetés. En 1810, il s'en procura plus (298) de 260 tonneaux en échange d'objets dont la valeur primitive n'allait pas à mille piastres, composés de haches et autres outils, de grosses rasades et de quelques dents de baleine, qui se trouvaient par hasard à bord, et dont l'une valait alors 3 ou 4 tonneaux. Il vendit sa cargaison à la Chine à raison de 20 piastres le pickle (* pas trouvé d’équivalence) et revint en faire une seconde avec la valeur de 3000 p. d'échange. Il avait cette fois de l'ivoire qu'il façonna à bord en forme de dents de baleine, dont il n'avait pu se procurer qu'une petite quantité. Cette fraude lui procura de grands bénéfices ; mais les naturels la reconnurent bientôt, et ils ne s'y laisseraient plus tromper aujourd'hui.
Quelques semaines suffisaient alors pour faire une cargaison d'une défaite sûre et avantageuse, tant par la qualité que par la grosseur du bois. Tout est changé maintenant, l'exportation de près de 1800 tonneaux a presqu'entièrement épuisé les ressources de cette petite île ; le peu de bois de sandal qui se trouve encore dans l'intérieur, est tortu, rabougri et de très-faibles dimensions, la plupart des morceaux n'ayant pas deux pouces de diamètre.
D'après les résultats des recherches du (299) capitaine Sowle et notre propre expérience, on ne peut recueillir, au plus, que dix ou douze tonneaux de sandal par mois. À quelques exceptions près, comparativement insignifiantes, les naturels ne reçoivent plus en échange que des fusils, de la poudre et autres munitions. Ces objets doivent conserver leur valeur, vu l'état continuel d'hostilité dans lequel vivent ces peuplades. Les dents de baleine n'ont de prix qu'autant qu'elles sont de la grosseur énorme de trois travers de doigt en diamètre. Les dents de souffleurs (black-fish) et de phoques sont aussi de quelque valeur lorsqu'elles sont fortes et assorties. Les haches et quelques autres outils sont recherchés, mais en général le fer l'est peu. Les mouchoirs, les toiles bleues et blanches ont de la vogue auprès des femmes principalement. Elles ont aussi pour les miroirs la prédilection ordinaire à leur sexe. Les plumes à panaches sont recherchées, surtout les rouges.
Au reste, tous ces objets n'entrent que comme appoint dans les échanges, dont les armes et la poudre font toujours la base. La valeur comparative de ces objets par rapport au sandal (300) a subi une baisse considérable ; un fusil valait, il y a encore peu de temps, un tonneau de bois. Voici celle que nous leur avons trouvée dans nos échanges. Pour un fusil, 500 liv. de sandal ; pour deux livres et quart de poudre, 100 liv. ; un hachot, 45 liv. ; une dent de baleine 100 liv. ; de ces dernières nous n'avons placé que les plus belles, et il n'y en avait pas de fortes dimensions, parmi celles que nous nous étions procurées au Callao.
Il faut se méfier des blancs que l'on trouve dans ces îles, la plupart sont des matelots déserteurs qui ont tous les vices de la civilisation, sans aucune des qualités de l'éducation. Malgré leur petit nombre, ils ne contribuent pas peu à faire perdre aux Indiens les qualités qui les distinguaient encore à la fin du dernier siècle, au dire des navigateurs de ce temps. Je crois pouvoir faire une exception en faveur de M. Ross, qui a été envoyé dans ces îles par M. Wilcocke, consul des États-Unis à Canton, pour faciliter la traite du sandal aux bâtimens de sa nation.
D'après les rapports de M. Ross, il paraît qu'il n'y a que très-peu d'années que les indigènes (301) étaient tels que les ont peints Quiros, Marchand, etc. Depuis, ils ont beaucoup changé, quant au moral, car il est incontestable que la douceur et l'humanité étaient le fond du caractère des Mendoçains (* Ce nom, parfois donné aux Marquisiens à l’époque, provient du nom compet des îles Marquises de Mendoza) antérieurement à leurs communications avec les Européens. Ross, qui était plus à même de les connaître que personne, leur rend cette justice. Mais quelques années ont amené un changement déplorable dans toutes les îles. À Wahitoa (* Vaitahu) même, les fils de ceux que la vue du sang de leur compatriote ne porta à aucun excès envers les étrangers imprudens qu'ils pouvaient croire ses assassins, ont, en 1815, enlevé traîtreusement un canot américain, massacré et mangé l'équipage : car malgré la douceur de leurs mœurs, les Mendoçains sont, depuis très-long-temps, anthropophages.
Du reste, c'est incomparablement la plus belle espèce d'hommes que j'ai vue, tant pour l'élévation de la taille et la beauté des formes que pour la force. Jamais on n'en voit de contrefaits. J'ai observé parmi eux des différences très-prononcées dans la couleur de la peau, dans les traits du visage et dans les cheveux ; mais ceux qui se faisaient ainsi remarquer (302) n'étaient pas en assez grand nombre pour faire présumer qu'il existât deux races. Les uns sont d'un noir pâle, comme les Malgaches, les autres sont moins basanés que beaucoup de Provençaux.
Les femmes, qui sont de taille ordinaire, sont jolies et très-bien faites, elles ont de l'embonpoint, la physionomie spirituelle et agréable, et les dents du plus bel émail. Il y en a dont le teint ne se ferait pas remarquer dans le midi de la France, aussi prennent-elles les soins les plus assidus pour le conserver ; elles ne sortent jamais de leur case dans les grandes chaleurs, où lorsqu'elles sont obligées de s'exposer au jour, elles se préservent du soleil avec leur éventail et l'étoffe dont elles s'enveloppent. Quoiqu'admirateur des Mendoçaines, je ne puis souscrire à la préférence que Quiros leur donne sur les beautés de Lima, qui, à la perfection des formes, joignent l'avantage de traits plus délicats et d'une physionomie plus fine. Au reste, le portrait qu'en font les voyageurs français, n'est pas trop flatté.
Les hommes portent ordinairement un morceau d'étoffe (* le « tapa »), extraite de l'écorce d'une espèce (303) de mûrier (* « ute », le murier à papier – broussonetia papyfera), dont ils font plusieurs tours sur la ceinture. Aux Marquises les plus amples sont les plus estimés ; ils sont épais et de couleur brune-jaunâtre. Comme la plupart viennent d'Oévahoa, ils sont d'un grand prix dans les autres îles. Un bout passe entre les cuisses et tombe par-devant, c'est le langouti des noirs des colonies.
Quand un Mendoçain n'a pas sa ceinture, comme il arrive quelquefois, il ne manque pas de se fabriquer une ligature qui couvre et met à l'abri la partie du corps la plus susceptible d'impressions. C'est autant par précaution que par pudeur, car ils ont aussi la leur, et elle se borne là, tout le reste est compté pour rien ou à peu près. Une fois la ligature faite, on est en mise décente et on peut se présenter.
Quelques insulaires, mais ce sont les petits-maîtres de ces contrées, portent une pièce d'étoffe en manteau comme les femmes. Dans les matinées fraîches, on en voit qui se couvrent de la natte sur laquelle ils couchent.

Portrait de Marquisien de Nuku Hiva – Löwenstern 1804
Ils se rasent la tête depuis le milieu du front jusqu’à la nuque, et portent de chaque côté de cette raie, qui a un pouce environ de largeur, les cheveux noués en pompon et pendans (304) sur leurs épaules. Dans les grandes occasions, ils ornent leur tête d'un diadème de plumes de queue de coq, ou d'autres oiseaux. À Oévahoa nous vîmes un ariki (chef) décoré d'un diadème d'écaille, incrusté d'ivoire et de nacre d'un assez bon goût.

Paèkaha, diadème des îles Marquises en os/ivoire et écaille de tortue
L'habillement des femmes consiste dans une ceinture qui les couvre jusqu'aux genoux, et une grande pièce d'étoffe, dont elles s'enveloppent les épaules et qui tombe un peu plus bas ; mais elles n'en font usage que lorsqu'elles sortent de leur case, car dans leur intérieur, elles se débarrassent de ce manteau et restent alors dans un négligé très-simple, mettant souvent même la ceinture de côté. Quand elles veulent se parer, elles se coiffent d'une toile très-fine dont elles se font un bonnet qui leur serre la tête et cache les cheveux. Les coins tournés sur eux-mêmes forment un pompon qui complète cette coiffure très-gracieuse.
Peu de femmes ont une chevelure à laisser flotter ; presque toutes ont les cheveux coupés courts ou au ras des épaules. Elles portent souvent des colliers composés de petits bouquets de fleurs de franchipane (* frangipanier/tipanier), de petits concombres, ou de (305) pommes de vacois (* le fruit du pandanus tectorius). Elles ont aussi pour les grandes occasions des colliers de dents de phoques, des pendans d'oreille faits de dents de baleine ; les plus gros sont les plus beaux, on en voit qui ont plus de deux pouces de diamètre, mais ceux qu'on porte ordinairement n'ont pas la moitié de cette dimension énorme. Ce sont moins des pendans d'oreilles que des oreilles postiches perpendiculaires à celles que donne la nature. On les fait tenir au moyen de deux petites chevilles, dont celle d'en-haut, la plus petite, est fixée à l'ornement et traverse le cartilage de l'oreille, l'autre plus grosse traverse et le lobe et la parure. Elles sont retenues au moyen d'une brochette ou épingle qui passe dans ces chevilles entre la tête et l'oreille. Les hommes portent aussi cet ornement.


À gauche, pūtaiana, pour femmes ; à droite, haakai, pour les hommes
Les rassades (* perles de verre ou d’émail) et les verroteries sont passées de mode. Quelques femmes suspendent à leur cou des morceaux d’ivoire, des coquillages ou du corail de diverses figures, imitant souvent celle d'une grosse dent.
Les hommes ont de la barbe comme les Européens, mais ils ne la conservent jamais entière. Quelques-uns portent des moustaches, (306) d'autres quelques poils isolés, la plupart l'arrachent. Si ce que dit Roblet (* Claude Roblet, 1er chirurgien du Solide, commandé par Étienne Marchand, le 1er navire français passé aux Marquises en 1791 qui prend possession de Ua Pou en juin de la même année) sur la dépilation était vrai de son temps, il en est différemment aujourd'hui, pour faire usage de ses paroles : il est certain que les femmes, dans les parties que la nature a voilées à dessein, respectent son ouvrage. Il faut ajouter que la nature a négligé ce soin-là pour beaucoup d'entre elles, et c'est peut-être ce qui a trompé Roblet.
Il n'existe aucun obstacle à l'union des deux sexes, le consentement mutuel suffit, et la consommation est la seule cérémonie. Filles et garçons sont absolument maîtres de leur personne, et se laissent aller aux impulsions de la nature, dès qu'ils en éprouvent le désir. Les uns et les autres devancent ordinairement l'époque de la nubilité, les jeunes filles surtout. On m'a cependant assuré, et tout ce que j'ai vu porte à le croire, que les jeunes gens des deux sexes cherchent rarement à se réunir avant l'époque où ils ont acquis la faculté de se reproduire. La force et la santé des individus prouvent que même alors, ils ne se livrent pas avec excès aux plaisirs de l'amour. C'est peut-être à la liberté (307) illimitée dont jouit la jeunesse, qu'il faut attribuer cette retenue dans l'âge de l'effervescence de la plus violente et de la plus douce des passions. Ici, sacrifier au plaisir est un droit que personne ne conteste, dont l'exercice n'expose à aucune flétrissure et qui n'est soumis à aucune entrave ; la propriété même y vient rarement apposer son veto. On se prend, on se quitte le lendemain ou au bout de quelques jours, soit pour se séparer entièrement soit pour se réunir encore. Une jeune fille reçoit en même temps les hommages de plusieurs amans, qui ont eux-mêmes plusieurs belles ; et personne ne s'en mêle.
Il arrive souvent qu'à l'âge où elle commence à attirer les regards des jeunes gens, une fille sort de la case paternelle et va vivre où bon lui semble, avant même d'avoir fait un choix. Cependant après avoir passé cette saison d'ardeur et de licence, quelquefois même dès ses premiers pas dans la carrière de la volupté, la jeune Indienne, parmi ses adorateurs éphémères, en distingue un plus tendre ou plus assidu. Si elle a obtenu sur son cœur la même préférence, un attachement plus sérieux et plus solide se forme alors. Bientôt elle devient mère (308) et les soins qu'exige un enfant établissent naturellement chez le jeune couple, une partie des rapports de devoirs et d'attachement qui existent dans nos ménages. Mais ici rien d'exclusif dans ce genre ; parmi les devoirs conjugaux, la constance n'est pas d'obligation, et même la fidélité en est exclue par l'usage.
C'est surtout aux îles Marquises que les mœurs sont non-seulement différentes, mais même en opposition avec, celles du monde civilisé. Chez les Orientaux, l'homme, se faisant illusion sur ses forces, s'attribue la possession de plusieurs femmes, l'Européen se contente d'une seule : le Mendoçain, n’apercevant chez l'un et l'autre sexe que les facultés physiques, laisse la femme jouir sans contrainte de cette liberté que l'homme partout ailleurs s'est exclusivement réservée. Le mari en titre n'est presque jamais seul, non seulement il a des suppléans, mais ce qu'il y a de singulier ; ces suppléans sont avoués par la femme et agréés par le mari. Chaque femme dispose de deux hommes au moins, et ce sont les plus modérées qui se contentent de ce nombre-là. Le suppléant est ordinairement le frère ou l'ami du titulaire, elle couche entre (309) les deux. Le mari de son côté peut s'indemniser sans que cela tire à conséquence, ni que la femme y trouve un sujet de se plaindre. Les enfans appartiennent à celui qui nourrit la mère, ou bien à celui qu'elle désigne pour en être le père.
Très-peu d'hommes ont plusieurs femmes attitrées, et dans toutes ces îles on cite les maris qui sont dans ce cas-là ; j'en ai connu deux dont j'ai déjà parlé. Quelques époux s'avisent cependant d'être jaloux et de châtier rudement leurs femmes pour les infidélités qu'elles se permettent avec les hommes qui ne sont pas de leur association. Aux Marquises la parenté exclut l'union des sexes, mais au premier degré seulement, c'est-à-dire entre le père et la fille, la mère et son fils, le frère et la sœur.
Ces insulaires paraissent aimer tendrement leurs enfans, tant qu'ils sont en bas âge ; le père et la mère leur prodiguent alors les soins les plus touchans, quoique les titres du premier soient presque toujours douteux ; mais dès que les facultés se développent, les jeunes gens se séparent de leurs parens, chacun devient ce qu'il peut et vit à sa guise. Cette séparation influe sans doute sur les sentimens réciproques, (310) et ce doit être une suite de leur manière de vivre avec les femmes qui sont presqu'en communauté.
Entr'autres singularités de ces peuples, il n'est pas permis à un homme de porter, même de soulever, aucune partie du vêtement d'une femme, ni la natte sur laquelle elle couche. Aucun individu de l'un et l'autre sexe ne peut s'asseoir sur les oreillers, objet dont les femmes seules ont le privilège de se servir.
Les insulaires des Marquises croient que la transgression de ces usages est punie par des maladies ou par la mort. Ils ont une sorte de superstition respectueuse pour la chevelure ; j'ai vu une femme ramasser avec soin et avaler quelques cheveux qu'elle avait aperçus par terre. Ross me dit que c'était leur coutume : ils ne veulent pas que les étrangers touchent les cheveux de leurs enfans, ni qu'on passe la main sur leur tête.
Quand des amis se rencontrent, ils se frottent nez à nez ; mais c'est un témoignage d'amitié qu'ils se donnent peu fréquemment, et je n'ai reçu cette faveur-là que de mon ami Roki. Je n'ai vu que très-peu d'individus dont le tatouage (311) offrît un dessin régulier ; on dirait que pour le visage surtout ils évitent la symétrie et cherchent les contrastes. J'ai aussi vu sur la poitrine des tatouages en forme de cuirasse brisée. Il est rare que les deux mains soient tatouées, et plus encore qu'elles le soient de la même manière. Je crois que la quantité du tatouage tient au rang et plus encore à l’âge ; et je trouve, comme Chanal (* Pierre Chanal, 3ème capitaine en second du Solide) que ces cuirasses tatouées forment un bon effet sur des corps nus, vigoureux et fortement dessinés. Les femmes ne se tatouent guère que les mains et les pieds ; mais on en voit qui ont au lobe de l'oreille un cercle concentrique au milieu duquel est pratiquée l'ouverture ordinaire. Beaucoup de femmes sont aussi marquées d'une espèce d'épaulette, ou bien elles ont sur les bras ou sur les cuisses la figure d'un lézard ou d'un poisson : quelques-unes ont ces mêmes parties couvertes de dessins, ainsi que le contour des reins ; et des Américains m'ont assuré avoir vu à la Madeleine (Hatouhiva) (* Fatu Iva) une femme de la plus haute taille qui était tatouée de la tête aux pieds, comme le sont les hommes. Ceux dont le tatouage a le même dessin ou se (312) ressemble par un trait principal, tel qu'une marque particulière au nez, sur l'œil, etc., forment entr'eux une espèce d'association ou de fraternité et se secourent mutuellement dans l'occasion, comme nos francs-maçons ; aussi le choix du tatouage est-il une affaire importante.
Ces insulaires résistent rarement à la tentation que leur fait éprouver la vue d'un objet précieux : il est dangereux de les y exposer. Les jeunes filles que nous recevions à bord, et non-seulement celles de la basse classe, mais aussi les demoiselles les plus comme il faut, ne se faisaient aucun scrupule de commettre des larcins, même après avoir reçu des présens dont elles paraissaient très-satisfaites. Entr'autres choses, elles m'enlevèrent un jour mon chapeau dans lequel se trouvaient deux ou trois livres qu'on y avait mis pour l'élargir : elles faisaient volontiers main-basse sur les livres à cause du papier dont les naturels savent faire des cartouches.
Au reste, il est aujourd'hui fort imprudent de s'aventurer à terre partout ailleurs qu'à Taïa-Hoy (Port Anna-Maria), et là même les insulaires volent toujours lorsqu'ils en trouvent (313) l'occasion, mais du moins c'est sans violence. Ils n'attachent au vol aucun déshonneur ; et cet acte, infâme parmi nous, n'entache l'individu qui s'en rend coupable qu'autant qu'il est pris sur le fait ; il passe alors pour être maladroit et voilà tout. Si le propriétaire légitime retrouve ses effets volés chez le larron ou ailleurs, il n'a pas le droit de les reprendre et ne peut rentrer en possession qu'en les enlevant furtivement à son tour. Ce qui est encore plus étonnant que ce défaut de police, c'est qu'il est très-rare qu'il en résulte des rixes ; et ces peuples ont naturellement tant de douceur dans le caractère qu'il n'arrive jamais de meurtres dans ces occasions. D'après le témoignage de Ross et ce que j'ai vu moi-même, aucun chef n'a assez d'autorité pour faire restituer un objet volé. Le seul moyen est d'arrêter le voleur ou un de ses parens, ou même un des chefs, et c'est alors à l'attachement qu'on leur porte et non à leur autorité qu'il faut attribuer la restitution.
Je dois dire à la louange de ces insulaires que l'assassinat est également inconnu entre eux, à moins qu'il ne soit inspiré par l'esprit de vengeance ou de parti, ce qui le fait rentrer (314) dans la classe des homicides autorisés par le droit des gens, dans un pays où chacun a celui de faire la guerre à son voisin. D'un autre côté, il faut avouer que depuis quelque temps il n'est pas d'île dont les habitans ne se soient portés aux derniers excès envers les étrangers. L'introduction des armes à feu, en diminuant la crainte que leur inspiraient les blancs et l'idée de leur supériorité, a causé sous ce rapport une révolution fâcheuse dans leurs mœurs, et pour peu que l'intérêt soit en jeu, ces insulaires ne font pas difficulté d'égorger un étranger.
Les habitans de Taïa-Hoy font à cet égard une exception honorable, quoique plusieurs meurtres y aient été commis ; mais si les naturels sont quelquefois sortis de leur caractère de douceur, c'est qu'ils y ont été poussés par une conduite révoltante ou par des insinuations perfides. Nous avons nous-mêmes parcouru ces vallées, portant des objets d'un très-grand prix pour eux ; nous les avons étalés à leurs yeux sans éprouver de vexations, sans jamais courir de danger ; bien entendu cependant qu'ils se réservent de voler tout ce qui n'est pas bien gardé.
Excepté à Carnicobar (dans le golfe de Bengale) (315), je n'ai vu nulle part de tableau de bonheur comparable à celui qu'offre ce pays. La nature prodigue à ses fortunés habitans tout ce qui leur est nécessaire ; et ce qui n'est pas moins heureux, elle n'a donné à leur terre aucune richesse factice, aucune de ces productions précieuses recherchées des peuples civilisés, et qui font souvent le malheur des pays où elles se trouvent.
Leurs habitations sont entourées de cocotiers et d'arbres à pain qui ne coûtent aucun soin, et dont les fruits donnent une nourriture saine, abondante et agréable, tandis que le tronc, l'écorce et les feuilles fournissent à leurs vêtemens et à leurs habitations. Les Marquises étant beaucoup plus saines que les Nicobars, leurs productions plus riches, plus variées, leurs habitans seraient sans doute aussi plus heureux, s'ils ne se privaient pas d'une portion de la félicité domestique, non-seulement par la licence de leurs mœurs qui enlève à l'union conjugale son plus doux apanage, mais encore par leur penchant au vol. Ce vice, qui n'est pas réprimé par la crainte de l'autorité, les porte à enlever les fruits que la hauteur des tiges ne met pas hors de l'atteinte (316) de leur rapacité. La méfiance qu'ils s'inspirent mutuellement, à cet égard, les empêche de s'adonner à la culture facile de plusieurs végétaux sains et agréables qu'on trouve en abondance dans d'autres îles mieux policées. Elle leur a fait prendre, par manière de précaution, l'habitude de cueillir les bananes avant qu'elles soient parvenues à maturité, et même qu'elles ne soient entièrement formées.
Il n'y a d'habité que les terrains garnis de cocotiers et d'arbres à pain. La nature fait presque toujours les frais de ces plantations, les naturels se donnant rarement la peine de faire pousser ces arbres précieux dans les lieux où ils ne viennent pas spontanément. Les terres sont en propriété : les chefs en ont de considérables ; ils habitent ordinairement les bords de la mer, et afferment les terres situées dans le haut des vallées pour une redevance modique en produits du sol. La volonté des deux parties fixe seule la durée du bail. Les propriétaires exercent naturellement une grande influence sur leurs fermiers, qu'on peut considérer comme vassaux ; mais ce vasselage volontaire est un échange de bons offices entre le chef et ses fermiers (317). C'est la principale source de l'autorité des arikis (chefs), car ils n'ont d'ailleurs d'influence dans leurs vallées et dans leurs tribus que celle que donnent parmi des égaux les qualités physiques ou morales. Mais il n'y a réellement aucune autorité publique ; nul ne doit compte de ses actions à qui que ce soit, et celui qui lèse en quelque manière les intérêts d'autrui n'a à craindre que de la part de la personne offensée ou de ses amis. On voit souvent des hommes possédant peu de terres jouir de plus de considération et être d'un plus grand poids que certains arikis, témoin l'ami de Ross, Agomohiti (* ?). Les chefs n'ont aucun ornement ni marque distinctive, que dans la manière de porter leurs cheveux. Ils n'adoptent pas la coutume de se partager les cheveux en rasant la tête depuis le milieu du front jusqu'à la nuque, et n'en font qu'un nœud derrière la tête ; encore cette distinction ne leur est pas uniquement réservée, car j'en ai vu quelques-uns qui, sans être chefs, conservaient leur chevelure entière.
La propriété des terres n'est pas entièrement assurée aux possesseurs ; il arrive quelquefois que le fort s'empare des biens du faible ; un (318) parent puissant, de ceux d'un héritier en bas âge.
J’ai été témoin d'un différend excité par les prétentions injustes d'un oncle sur une portion de terre de son neveu, fils du protecteur défunt de Ross. On avait tenu de bonne heure une espèce de conseil de famille, qui n'avait rien décidé. Nous arrivâmes peu après sa dissolution. Outre les parens et les amis de part et d'autre, les habitans de cette partie de la vallée étaient réunis en divers groupes ; presque tous étaient armés de leur grand bâton, quelques-uns avaient des lances de bois dur (sagaies). On se disputait, on se faisait des reproches ; de temps en temps la querelle s'échauffait jusqu'à faire croire qu'on allait en venir aux mains ; mais tout se passa sans effusion de sang. Les seuls coups portés le furent par une tante de l'enfant à un de ses cousins : celui-ci eut le dessous ; ce fut l'affaire d'un moment. Cette femme encore jeune et d'une grande taille, soutenait ainsi que sa sœur les intérêts de son neveu ; toutes deux faisaient très-bien leur partie au milieu de ce vacarme, et n'y paraissaient pas déplacées. Lorsque la querelle s'échauffait le plus, on voyait plusieurs des compétiteurs abattre (319) les buissons avec leurs bâtons, comme pour essayer la force de leurs bras ou pour dégager le champ de bataille. Quelques hommes et beaucoup de femmes étaient simples spectateurs et se tenaient, pour la plupart, un peu à l'écart. Aucun d'eux cependant ne témoignait de crainte dans le cas qu'on en vînt aux mains. Les protecteurs de l'enfant étant les plus nombreux, son adversaire parut se relâcher d'une partie de ses prétentions. Mais quelques jours après, ayant pris des mesures dont il espérait plus de succès, il revint sur les terres de son neveu. Cette nouvelle tentative n'eut pas un meilleur succès. Ross ayant réuni dans la nuit, à l'insu de l'usurpateur, les partisans du fils de son ami, l'oncle n'osa tenter le sort des armes, et on le chassa de nouveau du terrain dont il se bornait alors à demander une partie. Ses projets iniques ayant complètement échoué de ce côté, il se tourna contre un de ses frères plus âgé que lui et aveugle, qui après l'avoir secondé dans ses tentatives contre leur neveu, ne se trouvant pas aussi bien appuyé que l'enfant, fut obligé de se réfugier dans un coin de sa (326) terre et d'abandonner le reste de sa propriété à son cadet. Il est à remarquer que Kéatonouï Porter (* Kiatonui), quoique premier chef, ne prit aucune part à ces querelles. Les amis ou parens des parties intéressées, s'en mêlèrent seuls.
Dans les guerres de tribu à tribu, les prisonniers, sans exception d'âge ni de sexe, sont mis à mort et mangés, exceptés ceux qu'il plaît aux prêtres de consacrer aux dieux, et qu'on enterre après les avoir égorgés. Ni les femmes ni les enfans ne peuvent assister à ces horribles repas ; ce privilège est réservé aux guerriers et aux jeunes gens qui sont déjà tatoués. Dans les guerres civiles de vallée à vallée ou entre familles d'une même tribu, on ne mange pas les prisonniers. J'ai acquis par moi-même la certitude que les enfans sont non-seulement épargnés, mais peuvent aussi passer en toute sûreté sur les terres et devant la porte de l'ennemi de leur père. Lors des grandes fêtes, toute hostilité est suspendue pendant le temps des préparatifs et trois jours après la célébration ; les ennemis mêmes y sont accueillis, et pour traverser tout (321) le pays, il leur suffit de dire qu'ils vont à la fête de telle vallée. On les reçoit avec hospitalité ; ils prennent part aux repas et aux divertissemens, pêle-mêle avec ceux de la tribu qui en fait les frais. Ils partent ordinairement la nuit du troisième jour : cependant ceux que les suites du repas ou d'autres causes retiennent quelques heures au-delà du terme, sont épargnés.
Les habitans de Taïa-Hoy traitaient en ennemis les habitans des autres vallées ; ils tuaient et mangeaient tous ceux qui abordaient sur leurs côtes. Il n'y a que peu d'années que cet état d'hostilité permanent n'existe plus ; c'est au vieux chef Kéatanouï que l'humanité en a l'obligation. On n'est actuellement en guerre qu'avec Rahouga (* Ua Huna). Les habitans de cette île sont partagés en deux tribus entre lesquelles il règne beaucoup d'animosité. Nouhiva prend part à leurs querelles. Les Hapas étant alliés d'une tribu, les Havaux (* Haavao, au nord et au fond la vallée Pākiu à Taiohae) de l'autre, ils font des expéditions qui tournent toujours au détriment de cette île. Chaque parti enlève les cochons et les récoltes de son adversaire, coupe les cocotiers, les arbres à pain, en un mot, exerce toute (322) sorte de ravages.
L'homme à peine sorti des mains de la nature ainsi que celui qui est corrompu par la civilisation, ne trouve pas d'ennemis plus redoutables que son semblable. Cette rage n'est pas moins étonnante que déplorable chez un peuple exempt de toute oppression, vivant des dons de la nature qui lui prodigue tout ce qu'exigent ses vrais besoins et ses plaisirs, et ne connaissant ni les richesses ni les jouissances factices. Pour leur malheur ils font une exception en faveur des instrumens de destruction. Les bons habitans de Nicobar ont, à cet égard, plus de sagesse ainsi que plus de vertu et de bonheur. Après avoir ravagé les terres des Taïpis, le capitaine Porter (7) les avait obligés à faire la (323) paix avec ceux de Taïa-Hoy qui étaient très disposés à ne plus prendre les armes.
(7) Le capitaine Porter, commandant la frégate américaine l'Essex, fit un séjour de plusieurs mois aux îles Marquises, pendant lequel il se joignit au parti de Keatanoui, et l'aida à soumettre les vallées voisines de Taïa-Hoy. Depuis cette alliance, Kéatanoui, qui avait changé de nom avec lui, s'est toujours fait appeler Porter. Cet officier était venu relâcher aux Marquises à la suite d'une croisière dans laquelle il avait détruit sur la côte du Pérou et aux Galapagos les baleiniers anglais, dont un seul lui avait échappé. Le plan de cette belle campagne, qui a élevé le capitaine Porter au premier rang dans la brillante marine des Etats-Unis, avait été connu et proposé au gouvernement par le capitaine Ch. Baudin, alors lieutenant de vaisseau et une des espérances de notre marine, à qui sa perte, après plusieurs années, fait éprouver les plus justes regrets. Il est inutile de dire que le mauvais génie qui planait depuis si long-temps sur la marine française ne permit pas que ce projet fût adopté, quoique le capitaine Baudin ne demandât pour l'exécuter qu'une corvette à batterie couverte.
Mais quand la crainte de voir revenir l'Essex fut évanouie, les Taïpis, qui gardaient toujours du ressentiment, recommencèrent les hostilités en tuant un prêtre qui était venu chez eux de confiance. Maintenant, la plus grande animosité paraît régner entre les deux tribus. Je n'ai pas connaissance qu'il se soit fait d'expédition importante contre les Taïpis ; mais de petits détachemens passent quelquefois les montagnes, s'avancent furtivement sur les lisières peu habitées de leurs vallées, et enlèvent les malheureux qu'ils peuvent surprendre à l'écart. Ni le sexe ni l'âge n'est épargné ; rien ne peut arracher la victime à la mort, ni l'empêcher de devenir la pâture de ses ennemis. Les prêtres seuls peuvent la réclamer au nom de leurs Eatouas (dieux) (* etua). Ordinairement cette espèce (324) de consécration ne sauve pas la vie du prisonnier, mais il n'est pas mangé et on l'enterre auprès des cases où sont enterrés les fétiches. On m'a cité comme un fait unique qu'une jeune fille avait été préservée par un prêtre qui, après l'avoir gardée quelque temps chez lui, l'avait fait passer dans son pays.
Quoique ces insulaires aient leurs prêtres, je n'ai pu découvrir chez eux aucune trace de culte, ni aucune idée d'un être suprême. Les fétiches qu'on pourrait d'abord prendre pour des idoles, sont jetées sans soin dans des cases, et l'on ne montre pour elles aucune espèce de vénération. Tout ce que j'ai pu découvrir sur leurs croyances, c'est que les chefs et généralement tous ceux qui ont été renommés dans cette vie, pour leur force ou pour toute autre qualité physique ou morale, jouissent des mêmes avantages dans l'autre vie.
Les pirogues sont tabou pour les femmes, il leur est défendu d'y entrer lorsqu'elles sont à flot, et même de les toucher quand elles sont hâlées à terre. Le tabou s'étend sur les mâts, les balanciers, etc. de ces embarcations, quoiqu'on recueille souvent ces objets dans des (325) cases ou sous des hangards. On m'a assuré que ce tabou est en vigueur dans tout l'archipel. Ce que j'ai vu à Ohévahoa, me fait croire que le rapport est exact au moins quant à cette île. Un fait qu'on m'a cité, prouve qu'il en est de même à la Madeleine (Hathouheva) (* Fatu Iva). Je n'ai pas les mêmes preuves pour les autres îles. Il paraît d'après la relation de Marchand, qu'il n'était pas adopté à Taouhata, de son temps. Il peut y avoir été introduit depuis, car cette institution n'a souvent qu'une existence locale et même éphémère. Tel objet est tabou dans une vallée et ne l'est pas dans la vallée voisine ; tel autre l'est aujourd'hui et ne l'était pas il y a un an. Ces interdictions n'ont lieu qu'à la volonté des prêtres ; mais pour devenir générales dans une tribu, il faut que la proposition qu'ils en font soit adoptée par les chefs.
Un prêtre déclare avoir communiqué avec un de ses confrères ou un chef défunt et devenu étoua (dieu) dans l'autre monde, en vertu du rang qu'il occupait dans celui-ci. Cet esprit lui a annoncé qu'il ferait éprouver les effets de sa colère à tout individu qui mangerait du cochon ayant telle marque, à la femme qui toucherait (326) certaine arme ou autre objet à l'usage des hommes. Voilà l'animal, l'objet désigné, sous interdit.
Quelques vêtemens à l'usage de l'un des deux sexes sont tabou pour l'autre. Au reste ces peuples ont le bon esprit de laisser à leur étoua le soin de se venger eux-mêmes, et de punir ceux qui enfreignent le tabou. Aussi arrive-t-il souvent que les maladies ou tout autre malheur survenus à un individu peu scrupuleux observateur des tabous, sont considérés comme une vengeance de la divinité.
Beaucoup de ces insulaires meurent de vieillesse, sans presque avoir éprouvé les infirmités dont elle est si souvent accompagnée chez les peuples civilisés. Ils sont en général emportés par une consomption qui les mine lentement et sans les faire souffrir, jusqu'aux approches du dernier moment. Ils n'emploient aucun moyen pour le retarder, et ils ne paraissent pas y perdre ; au moins ont-ils l'avantage de ne pas se tourmenter inutilement. J’ai vu plusieurs individus attaqués de ce mal. Ils se couchent dès qu'ils en sont atteints et attendent la conclusion, sans sortir à peine de leur case, avec une tranquillité au moins apparente : leurs proches s'empressent (327) de pourvoir à leurs besoins ; on leur porte à boire, à manger ; on les masse fréquemment, et voilà tout. Quand la maladie a fait des progrès, on s'occupe des funérailles et du cercueil ; c'est une grande pièce de tronc de cocotier, évidée en forme de tuile, sur laquelle on expose le mort sans l'enfermer. On travaille aussi à faire la case où le corps doit être déposé. Elle est ordinairement attenante à celle qu'habite la famille. Tous ces préparatifs se font sous les yeux du malade, auquel ils doivent annoncer sa dissolution prochaine. Toutes ces dispositions, dont la vue serait pénible pour nous, ne sont considérées par ces insulaires que comme des témoignages de l'attachement de leurs proches, et ne leur causent sans doute aucun sentiment douloureux, car j'en ai vu plusieurs en pareil cas, qui ne paraissaient nullement affectés de ces soins lugubres. On trouve de ces bières dans presque toutes les cases. Elles sont polies avec soin, au moyen de corail pulvérisé : à la forme, on les prendrait pour des boucliers romains. J’ai aussi vu quelques hommes travailler à leur cercueil, quoiqu'il ne parût pas qu'ils dussent en avoir besoin de long-temps. (328) Aux approches de la mort, on fait une décharge de toutes les armes de la maison : les parens et les amis du même sexe que le malade s'assemblent autour de lui. Si c'est un personnage important par lui-même ou appartenant à une famille considérable, on y voit accourir tout ce qui tient un certain rang.
J'ai été témoin à Nouhiva d'une de ces scènes de douleur. La personne qui en était l'objet était femme du vieux chef Pahoutéhé, surnommé l’Éléphant ; depuis plus d'un an, elle était minée par une consomption qui paraissait devoir l'emporter incessamment. Quarante à cinquante femmes étaient réunies dans la case au milieu de laquelle on avait placé la malade, qui ordinairement occupait un petit réduit séparé à une extrémité. Toutes étaient vêtues de toile blanche, parées de leurs plus beaux ornemens et surtout d'une propreté parfaite, l'usage de l'huile et du safran étant absolument interdit pour ces cérémonies lugubres. Celle-ci ne l'était réellement qu'autour de la malade. Son mari lui tenait la main droite, un de ses fils la gauche ; ils les frottaient doucement, les réchauffaient dans les leurs et les arrosaient de larmes. Les (329) pieds et les jambes étaient massés de même par des femmes qui, avec quatre ou cinq autres, les plus près de la malade, louaient ses bonnes qualités et déploraient en sanglotant la perte qu'elles allaient faire. Il régnait un certain accord dans ces lamentations ; toutes les pleureuses n'employaient pas les mêmes expressions, mais elles parlaient sur le même ton, et terminaient simultanément leurs versets par des cris et des gémissemens cadencés qui étouffaient leur voix. Cet exercice étant d'autant plus fatigant que, pour la plupart, c'était un jeu forcé, les actrices étaient relevées de temps en temps, et allaient un peu à l'écart pour se reposer de la contrainte que leur avait imposé ce rôle pénible. Excepté les pleureuses en scène, le reste de l'assemblée paraissait très-peu affecté ; on causait, on riait même, comme on aurait fait ailleurs, seulement en faisant moins de bruit. Si les jeunes filles s'abstenaient de faire des agaceries aux étrangers que la curiosité attirait, les vieilles les récompensaient de cette retenue peu commune, en faisant remarquer leur beauté aux nouveaux venus, et en les engageant obligeamment à leur rendre des hommages auxquels (330), par leur âge, elles n'osaient plus prétendre elles-mêmes. Cette comédie se répéta deux jours de suite, et chaque fois pendant cinq heures. Le troisième jour la malade avait recouvré une partie de ses forces, et lors de mon départ, plus de six semaines après, elle luttait encore avec vigueur contre la maladie, qui dans ces contrées-là du moins, n'a jamais la médecine pour auxiliaire.
Ces insulaires n'ont pas d'expression qui signifie lieu de sépulture. Ils ont cependant des cases destinées à recevoir exclusivement les morts : on m'a assuré qu'ils ne leur présentaient pas de vivres, et je n'en ai pas vu le moindre indice dans aucun endroit où on les déposât. Il est probable que les Espagnols qui en font mention furent conduits dans une case tabouée, où on avait préparé un repas pour les prêtres, à l'occasion de la mort de quelque chef, ou de quel qu’autre événement remarquable.
D'après ce que j'ai appris, les Indiens des Marquises n'ont pas la coutume d'aller pleurer leurs morts sur les montagnes, comme le dit Cook, mais bien dans les petites cases où on (331) les conserve. Celle où on avait porté l'homme tué par les Anglais était sûrement vers la montagne, et c'est peut-être d'après les signes qu'on faisait pour indiquer que les femmes avaient été de ce côté, que Cook a cru qu'elles pleuraient les morts sur le sommet des montagnes.
Les dimensions données dans Marchand, sur leurs habitations, sont celles des plus petites. La largeur ne varie guère que de huit à quinze pieds ; mais on en voit qui ont plus de cinquante pieds de longueur et celles des propriétaires en ont rarement moins de vingt. Il est étonnant que les voyageurs français et anglais n'aient pas remarqué la disposition de la partie de la case qui sert de lit commun. Il règne sur le sol, le long de la muraille opposée à la porte, une pièce de bois arrondie de huit à dix pouces de diamètre. Parallèlement et à quatre pieds et demi de distance, il y a une autre pièce de bois aussi arrondie, mais plus forte que la première. L'espace intermédiaire est un air bien applani et couvert d'une herbe forte ou de petit jonc, sur lequel on étend des nattes. Leurs armes se composent d'un arc, d'une fronde et d'une espèce de pique de bois très-dur. (332)
Les habitans des Marquises, de même que ceux d'Otahiti, ont une manière de faire rôtir les viandes qui mérite une description toute particulière. Ils construisent des fours souterrains dont le fond est pavé ; on y allume du feu sur lequel plusieurs pierres sont mises. Lorsque le four est suffisamment échauffé, on retire le charbon et les cendres, ensuite la viande, enveloppée de feuilles, est placée sous les pierres : le tout est recouvert de terre, et la viande ainsi cuite devient un mets délicieux.
Les étoffes sont tissues avec l'écorce d'un arbuste cultivé avec le plus grand soin. Cette écorce est mise en macération dans l'eau pendant quelques jours, lorsqu'on en a enlevé la surface extérieure, qui ne peut être utilisée à cause de sa dureté. Cette écorce est ensuite battue, et devient gluante en acquérant la viscosité d'une pâte ferme. Cette étoffe a autant de consistance que de force, et par le blanchissage elle acquiert une blancheur parfaite. Pour battre ces étoffes, les Indiens se servent d'un morceau de bois très-dur, qui est équarri et rayé sur ses quatre faces. La circonférence est ordinairement de six pouces, et sa longueur, (333) le manche excepté, en a quinze.

Battoir à tapa « ike »
Cette étoffe devient extrêmement mince quand on la bat ; aussi quand les insulaires désirent en avoir d'épaisses, ils en étendent deux ou trois pièces l'une sur l'autre et les collent ensemble.
La langue est douce, harmonieuse, flexible, et facile à prononcer. Le grand nombre de voyelles dont elle est composée lui donnent cet avantage, qui, au reste, est commun aux peuples qui vivent entre les tropiques.
Les habitans de Rahopou (une des Marquises) (* Ua Pou) ont sur tous les autres l'avantage de ne pas avoir été troublé depuis long-temps par des querelles intestines; j'ignore si c'est à leur sagesse qu'ils doivent les douceurs de la paix , au moins est-il certain qu'en vertu d'un tabou depuis long-temps en vigueur, l'exportation du sandal est interdite : cette disposition, dont l'effet naturel est d'empêcher l'introduction des armes meurtrières dont la navigation inonde les autres îles, prouve combien cet interdit religieux, seule législation des insulaires du grand océan équinoxial, pourrait contribuer à leur bien-être , entre les mains de sages dépositaires qui, au lieu de l'usage frivole et ridicule (334) qui s'en fait souvent, sauraient l'employer avec adresse pour l'intérêt et le bonheur de leurs compatriotes. Mais si les habitans de Rahopou sont paisibles entre eux, d'un autre côté ils sont cruels envers les prisonniers étrangers que le sort fait tomber entre leurs mains (8).
(8) Voyez Asiatic journal, nº 15 (* The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its dependencies N° 15)
Le brick anglais la Matilda, capitaine Fowler, étant à l'ancre devant cette île, fut pillé au mois d'avril 1815. Cinq naturels des îles de la Société, embarqués comme matelots, avaient déserté peu de jours auparavant et s'étaient joints aux Naturels. Profitant d'une nuit obscure et d'un vent qui soufflait avec violence vers la terre, ils coupèrent les câbles qui retenaient le navire ; la mer étant très-grosse, il fut en peu de temps jeté à la côte et rempli d'eau. Lorsque les Naturels virent qu'il était impossible de le remettre à flot, ils résolurent de massacrer tout l'équipage ; ce qui paraît être en général la coutume des différentes îles de cet archipel, lorsque le mauvais temps ou quelqu'autre accident fait chavirer un canot étranger sur les côtes. Le capitaine Fowler avait heureusement (335) gagné l'amitié du chef, nommé Nouhatou (* Peut-être Nuhatu, ou Nuahitu), qui présidait l'espèce de tribunal qui devait décider du sort de ces infortunés marins. Il permit sans peine le pillage de la Matilda, mais ne voulut jamais consentir au massacre de l'équipage. Ces malheureux voyaient, par le peu d'expressions qu'ils pouvaient comprendre et tous les gestes qu'on faisait, que leur vie dépendait de l'issue du débat qui s'était élevé à leur sujet. Plusieurs chefs, mais d'une autorité inférieure, s'opposaient fortement à Nouhatou ; ce ne fut qu'après les plus ardentes sollicitations que celui-ci parvint à soustraire les naufragés à la fureur de ces barbares. On rapporte même que voyant que toutes ses prières et ses argumens ne faisaient aucune impression sur l'assemblée, il prit une corde et l'attachant autour de son cou, et de celui de son fils, il ordonna au chef qui était le plus près de lui de les étrangler tous deux, « afin que je ne voie pas, dit-il, de mon vivant, une action aussi infâme, et que moi et mon fils ne soyons pas accusés d'avoir sanctionné par notre présence la mort d'hommes qui ne nous avaient jamais fait de mal. »
Une action aussi magnanime (336) excita la surprise et l'admiration de ces sauvages, qui restèrent un instant stupéfaits d'étonnement, et ensuite s'écrièrent d'un mouvement unanime : Ariky ! Ariky ! (Chef ! chef) que les étrangers vivent ! nous voulons garder notre Ariky. La vie des malheureux Anglais fut sauvée, mais le navire fut entièrement pillé.
FIN DU PREMIER VOLUME
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE V
Départ de San-Francisco page 246
Note sur les îles Marquises 247
Promotion dans l'équipage 249
Marquises de Mendoça 25o
Iles Marchand et Nouhiva 252
Ross, Américain établi parmi les Indiens. 254
Le Bordelais est assailli par un grand nombre de jeunes et jolies femmes. ibid.
Visite à Kéatanoui, dit Porter, chef indien. 255
Réception que ce chef fait au capitaine du Bordelais 256
Portraits des Nouhiviennes 257
Iles Nouhiva et Rahopou.259
Village de Taoa. 262
Détails sur les insulaires de cette contrée. 263
Anse d'Atouona.264
Anse d'Annamate.265
Départ pour Taoa 269
Échange contre des cochons et du sandal. 272
Travaux à bord du Bordelais. 275
Caverne remarquable 276
Curiosité de deux Indiennes envers le capitaine du Bordelais 279
Poème en l'honneur d'un petit-fils de Kéatanoui Porter page 281
Pahoutéhé, chef indien, surnommé l’Éléphant. ibid.
Traite de sandal. 282
Vol de deux futailles. id.
Étonnante agilité des Indiens. 283
Poètes et musiciens ambulans. 284
Observations sur les habitans d'Hagatea. 287
Acte de confiance de la part du capitaine du Bordelais, qui faillit lui coûter la vie. 288
Amitié de Iahouhania, prêtre indien. 29I
La mauvaise santé de M. Siepky l'oblige à débarquer. 293
CHAPITRE VII
Détails sur les îles Marquises. 295
Ile Nouhiva. 277
Objets de commerce. 299
Observations importantes sur les blancs. 3oo
Mœurs indiennes. 3o1
Habillement des hommes. 3o2
Habillement des femmes. 3o4
Union parmi les deux sexes. 3o6
Liberté des femmes. 3o8
Amitié des pères et mères pour leurs enfans page.3o9
Respect pour ce qui appartient aux femmes. 31o
Salut indien. ibid.
Tatouage.311
Penchant que les insulaires ont pour le vol. 312
Caractère particulier.314
Comparaison des Marquises avec Carnicobar.315
Propriété des terres.316
Pouvoirs et marques distinctives des chefs indiens aux Marquises.317
Querelle indienne.318
Hostilités suspendues pendant les fêtes. 32o
Guerre entre tribus 32 1
Les insulaires mangent leurs prisonniers. 323
Les prêtres seuls peuvent sauver la vie aux prisonniers. ibid.
Tabou sur les pirogues.324
Le tabou.325
Maladies communes aux Indiens.326
Cercueil.327
Cérémonie funèbre.328
Habitations. 331
Armes. ibid.
Manière de faire rôtir les viandes. Page 332
Étoffes. ibid.
Détails sur les habitans de Rahopou.333
Magnanimité d'un chef indien envers un équipage anglais.335
BIBLIOGRAPHIE
*- Crook, William Pascoe - Récit aux îles Marquises, 1797-1799 ; traduit de l’anglais par Mgr Hervé Le Cléac’h, Denise Koenig, Gilles Cordonnier, Marie-Thérèse Jacquier et Deborah Pope-Haere Pō-Tahiti-2007
*- Gannier Odile et Picquoin Cécile, « 1791, le Voyage du Capitaine Marchand ; les Marquises et les îles de la Révolution. Au Vent des Îles, Tahiti, 2003.
*- Krusenstern, Adam von : « Voyage autour du monde fait dans les années 1803, 1804, 1805 et 1806 », Paris, 1821/ Hachette - BNF
*- Legrand-Vall, Serge « Les Îles du Santal », Elytis, 2011
*- Legrand-Vall, Serge « La Part du Requin », Elytis, 2015
*- Roquefeuil (de), Camille : « Journal d’un Voyage autour du Monde, 1816-1819 », Paris, 1823.
LIENS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9dition_du_Bordelais
http://slegrand.vall.free.fr/?paged=4
https://livre.fnac.com/a7881261/Serge-Legrand-Vall-La-part-du-requin
https://www.amazon.fr/Iles-du-Santal-Serge-Legrand-Vall/dp/235639057X
Publié par Jacques Iakopo Pelleau le 14/06/2020
Mis en conformité avec la graphie académique marquisienne le 26/08/2022.
(À l'exception de certains mots extraits des dictionnaires anciens pour lesquels la graphie originale incertaine a été conservée.)