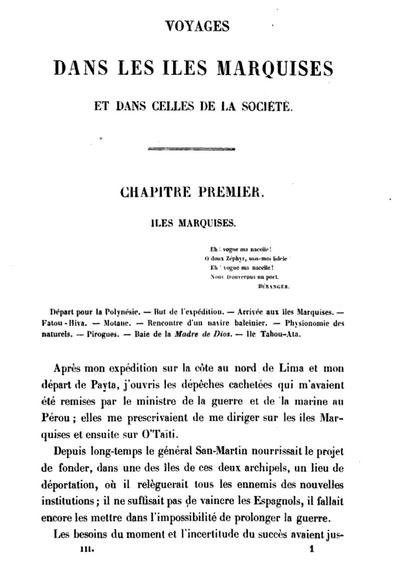NOTES PRÉLIMINAIRES
*- Les notes entre parenthèses marquées de* sont de Jacques Iakopo Pelleau ; celles sans* sont de l’auteur.
*- Afin de conserver à ce récit son authenticité, les patronymes et toponymes employés par l’auteur n’ont pas été modernisés.
*- Si l’épisode se passe en 1823, les remarques historiques sur l’annexion de 1842 prouvent que le récit a été rédigé bien plus tard
L’AUTEUR
Gabriel Pierre Lafond de Lurcy (1801-1876) est un navigateur, explorateur et aventurier français qui participa à l'indépendance du Pérou et de l'Équateur, et comme représentant du Costa Rica en France.
En 1823, José de San Martín (« Protecteur » du Pérou dont il vient de proclamer l’indépendance) lui donne le commandement de l'Estrella pour intercepter les navires espagnols opérant au nord de Callao, et chercher un lieu de déportation pour les opposants ; il part vers les Marquises et Tahiti.
Pour connaître plus détails sur l’auteur, cliquer sur le lien suivant.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Lafond_de_Lurcy

Gabriel Lafond de Lurcy (1801-1876)
Portrait de 1844 par Demoussy, gravé en 1845 par Gustave Levy.
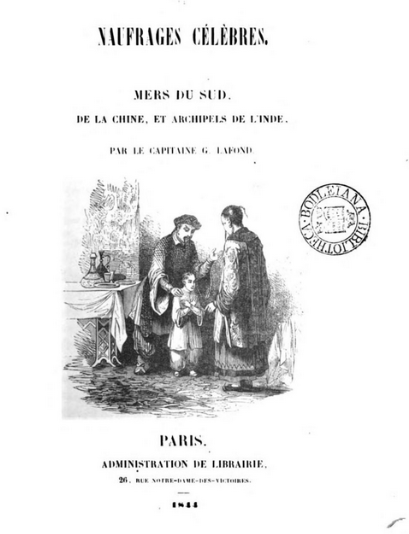
Illustrations de l’ouvrage : la page de titre et la 1ère page
LE RÉCIT
CHAPITRE PREMIER. ÎLES MARQUISES
« Eh ! vogue ma nacelle !
Ô doux Zéphyr, sois-moi fidèle.
Eh ! Vogue ma nacelle !
Nous trouverons un port. »
Départ pour la Polynésie. But de l‘expédition. Arrivée aux îles Marquises. Fatuiva. Motane. Rencontre d’un navire baleinier. Physionomie des naturels. Pirogues. Baie de la Madre de Dios. Île Tabou-Alu.
Après mon expédition sur la côte au nord de Lima et mon départ de Payla, j’ouvris les dépêches cachetées qui m’avaient été remises par le ministre de la guerre et de la marine au Pérou ; elles me prescrivaient de me diriger sur les îles Marquises et ensuite sur O'Taïti. Depuis longtemps le général Sun-Martin nourrissait le projet de fonder, dans une des îles de ces deux archipels, un lieu de déportation, où il relèguerait tous les ennemis des nouvelles institutions ; il ne suffisait pas de vaincre les Espagnols, il fallait encore les mettre dans l’impossibilité de prolonger la guerre. Les besoins du moment et l’incertitude du succès avaient jusque-là fait ajourner l’exécution de ce projet; mais il devenait tous les jours de plus en plus nécessaire de mettre fin aux exactions sanglantes de Monte-Agudo, et le Protecteur, dont l’âme noble et généreuse avait toujours été ennemie des mesures oppressives, résolut d’exiler les principaux agitateurs dans une de ces îles, dont le climat doux et tempéré leur permettrait d’attendre patiemment que la république fût assez consolidée pour n’avoir rien à craindre de leur présence. Obéissant aux ordres que j’avais reçus, je laissai arriver vent arrière et me dirigeai sur les Marquises.
Entre les tropiques, l’0céan offre un spectacle entièrement nouveau : tout s’anime ; le soleil, en agitant son prisme sur les flots, y répand le mouvement et la vie ; la mer se peuple d'une multitude d’habitants de toutes les formes, de toutes les couleurs, qui semblent suivre le navire pour égayer la monotonie de la navigation ; on dirait, pour nous servir de la belle image de Bernardin de Saint-Pierre, que des Néréides se sont chargées de séduire dans ces mers des flottes de poissons.
Ce fut par une belle soirée que nous aperçûmes l’archipel des Marquises, ainsi appelées du nom de la femme d’un gouverneur du Pérou, la marquise de Mendoza, par l’Espagnol Mendaña, qui découvrit cinq de ces îles en 1595. Les autres îles formant le groupe complet furent reconnues plus tard et à différentes époques par Cook, Ingraham et Marchand. Fatuiva, la plus méridionale du groupe sud-est de cet archipel, se montra la première devant nous. Notre curiosité s'éveille aussitôt avec une ardeur nouvelle : tout le monde se précipitait sur le pont ; heureux celui dont une longue-vue pouvait seconder l’impatience ! Motane nous apparut ensuite à tribord ; bientôt nous fûmes assez près des îles Dominique ou Hiva 0a et Tahuata pour pouvoir facilement distinguer les anses et les 3 criques de ces côtes bizarrement découpées.
Quelques petites maisonnettes blanches, surmontées de pavillons, étaient éparses sur la plage et attirèrent mon attention. Un des matelots anglais de la goélette, qui avait déjà visité ces parages, me dit que nous avions devant les yeux les abris temporaires des pêcheurs baleiniers ou les habitations de criminels évadés de Port-Jackson (* futur Sydney), qui s’étaient octroyé de leur propre autorité un brevet de liberté.
Pendant cette nuit, passée en prolongeant la côte pour arriver à la baie de la Madre de Dios, un navire nous apparut ; il naviguait à contre-bord. Je pensai de suite à profiter de la circonstance pour écrire à mes amis du Pérou, et ma lettre était prête lorsque ce bâtiment se trouva par notre travers : c’était un baleinier. Je demandai au capitaine s’il voulait se charger de lettres pour l’Amérique ; la réponse ayant été affirmative, une embarcation fut lancée à la mer pour les lui porter. Cet instant eut quelque chose d’imposant. La mer, d'un air foncé, était unie comme une glace ; une brise légère murmurait par intervalles dans nos agrès, et la lune, répandant des flots de lumière argentée, brillait aux cieux d’un éclat inconnu dans nos climats. À droite, s’étendait la côte de Hiva Oa, boisée et montagneuse ; un doux zéphyr apportait du rivage les émanations les plus suaves, tandis qu’à gauche, une île du groupe de Tahuata, faiblement éclairée par les rayons pâles et tremblants de la lune, semblait reposer endormie sur les flots. L’équipage lui-même éprouvait l’ascendant de ces harmonies ; attentif à mon commandement, le silence solennel qui régnait à bord n’était interrompu que par le bruissement du sillage du navire. Celui que nous attendions glissait sur la mer calme et unie, et s’avançait dans l’ombre comme un fantôme majestueux, ne laissant entendre d’autre bruit que le cri plaintif de quelques poulies mises en mouvement dans la manœuvre.
Ces scènes maritimes frappent toujours vivement l’imagination, et les émotions qu’elles font éprouver s'effacent difficilement de nos souvenirs. Nous passâmes la nuit au large, à l’est de Hiva 0a ; l'équipage ne quitta pas le pont, où il respirait plus à l'aise que dans les hamacs. Dès l’aurore, je commandai de laisser porter afin de doubler la pointe sud de Tahuata et de gagner la baie de Vaitahu ou Madre de Dios.
Un tableau merveilleux s’offrait alors à nos regards : le ciel était d’une pureté admirable ; une brise fraîche tempérait les ardeurs du climat des tropiques ; les montagnes de Tahuata s’élevaient devant nous couvertes d’une végétation vigoureuse, éclatantes de fraîcheur et de verdure ; sur la grève, des bouquets de cocotiers balançaient leurs tiges sveltes au-dessus des cases des habitants, d’où s’échappaient des colonnes de fumée.
Cette côte, remplie de sites ravissants, pouvait se comparer à un parc immense. D'innombrables pirogues couvertes de voiles de nattes partaient de la plage, allant à la pêche ou se disposant à venir nous accoster ; c’était un coup d’œil enchanteur. Je demeurai longtemps plein de saisissement devant cette scène, dont ma description n'a pu donner qu’une idée bien imparfaite.
Nous eûmes un moment de calme avant d'arriver à la baie que nous cherchions. Ce fut une cruelle épreuve pour moi, qui aurais voulu abréger les heures. Je descendais à chaque minute dans ma chambre et remontais aussitôt pour voir si le vent ne soufflait pas ; attiré du côté où l'on attendait la brise ; chaque bouffée de vent faisait battre mon cœur, tant je brûlais d’impatience de faire connaissance avec cette contrée. Enfin la brise s’éleva, et peu à peu nous approchâmes de terre.
À mesure que nous avancions, le nombre des pirogues augmentait ; bientôt il devint si grand que le navire en fut entouré. Déjà le brocantage commençait, lorsque j’ordonnai à chacun d'être à son poste, attentif au commandement. On pense bien que malgré cet ordre l’équipage eut plus d'une distraction.
Le moment que j’attendais avec tant d'ardeur arriva cependant ; nous laissâmes tomber l’ancre dans la baie de Madre de Dios, où le capitaine Cook mouilla en 1774, lorsqu’il visita les Marquises. Les voiles carguées et serrées, les hommes de quart désignés, je permis à tout le monde de faire des achats. Alors, une véritable foire commença, non seulement sur le pont, mais encore dans la batterie et jusque sur le beaupré.
Sur le gaillard d’arrière, j’achetai de la volaille, des tortues, des fruits, des cochons. Les cochons étaient tellement abondants à cette époque, qu’on en donnait un du poids de deux cents livres pour la valeur d’une piastre (* à cette époque-là, une piastre avait à peu près la même valeur qu’un dollar américain) ; dix poules, vingt-cinq poulets, ou un paquet de cinquante à soixante cocos ne coûtaient pas davantage.
Sur le gaillard d’avant, c‘était un autre genre de trafic. L’on échangeait des pots, de la faïence, des mouchoirs, des vestes, des pantalons, de la quincaillerie, de la fausse bijouterie, enfin tout ce qui pouvait plaire aux naturels, peu difficiles alors, car nous étions un des premiers navires qui depuis longtemps eût visité ces parages. On nous donnait des cocos, des oranges, des tamarins, des ignames, des taros, et enfin des articles de simple curiosité, tels que des coquillages, et surtout ceux connus sous le nom de porcelaines, qui se trouvent à profusion sur ces côtes, ou des oiseaux du pays. Il faut avoir vu ces scènes de brocantage pour s'en faire une idée ; il faut avoir entendu les bons mots, les quolibets, les facéties grivoises des matelots pour comprendre toute l’originalité de leur esprit. L'un folâtrait avec une Noukahivienne jeune (* Bien qu’il se trouve à Vaitahu, Tahuata, Lafond de Lurcy emploie le terme générique de Noukahivien pour désigner tous les Marquisiens), alerte, et dont les grâces naturelles eussent excité la jalousie d’une Parisienne ; un autre, affectant une gravité comique, essayait de se soustraire aux ardentes agaceries d’une matrone déjà sur le retour ; puis venaient les gestes et les conversations vraiment amusantes avec les Indiens, qui ne les comprenaient pas.
Terre, animaux, fruits, végétaux, n’étaient cependant pas tout-à-fait nouveaux pour nous dans ce pays ; nous ouvrions malgré cela de grands yeux, et les examinions avec l'avidité et la curiosité du voyageur qui cherche à s’instruire. Les indigènes qui vinrent à bord fixèrent mon attention. Le Nouka-Hivien est grand, vigoureux, bien proportionné ; ses mouvements sont rapides ; ses dents blanches et parfaitement rangées ; sa figure ouverte et expressive ; sa poitrine large ; son front assez haut ; son nez bien fait, et ses jambes, qui unissent la force à la grâce, pourraient servir de modèle à nos statuaires. Les pieds et les mains surtout sont admirables de proportions.
La tête du Nouka-Hivien est complètement rasée, à l'exception de deux touffes de cheveux fort longs et roulés en chignons sur le sinciput. Quant au costume, on peut dire qu’il n'existe pas, car il consiste simplement en un morceau d’étoffe grossière d’écorce de mûrier qui entoure les hanches ; mais il est en quelque sorte remplacé par une foule de tatouages bizarres dont les mille réseaux couvrent de la tête aux pieds la peau cuivrée du Nouka-Hivien.
D’innombrables pirogues croisaient en tous sens entre le navire et la côte. Presque toutes ont des balanciers. Il y a aussi des bateaux d’une plus forte dimension, dont se servent les habitants pour les traversées d’une île à l’autre ; la voilure de ces deux espèces d’embarcations est absolument la même, et je pense que sa singularité mérite une description.
Les pirogues et les bateaux sont construits de planches cousues à l’intérieur au moyen des rebords qu’on y laisse et dans lesquels on perce des trous pour y passer la ligature. Cette ligature consiste en une tresse faite généralement avec les fibres qui recouvrent la noix du coco ; les deux joints sont rapprochés avec tant d’art, que la couture n’a pas besoin de calfatage pour empêcher l’infiltration des eaux; on les enduit cependant d’une composition de suif ou d’huile de coco et de chaux, faite de coquillages , destinée principalement à préserver le fond de l‘embarcation des vers qui abondent dans ces mers, vers qui détruiraient promptement les meilleurs bois, si on ne les garantissait par un doublage.
Leurs voiles sont plus longues d’un tiers que le bateau ; elles ont très peu de largeur en proportion de leur élévation ; leur forme, la façon de les orienter et l’aspect qu’elles offrent sont tels, que ces embarcations, vues de loin, ont une apparence qui dépasse de beaucoup la réalité, et que l’on est tenté de leur accorder une importance qu’elles sont loin d’avoir. En effet, à mesure qu’on en approche, l’illusion cesse ; en est surpris de les trouver si petites et de les voir porter une voilure si démesurée.
Cette voile est composée de quatre bandes de nattes, cousues dans leur longueur et auxquelles on en a joint trois autres, qui ont toute leur largeur à l’un des bouts et se terminent en pointe à l’extrémité opposée, d'où résulte un tout plus large du haut que du bas. Elle est supportée par deux vergues de bambou qui viennent se réunir à la pointe, et forment un triangle dont l’angle le plus aigu est en bas ; en outre la voile a environ quarante pieds pour un bateau de trente.
Le mât, qui est double, en forme de chèvre, est placé peu loin de la proue, et la voile est disposée de façon qu’il n’y a environ qu’un tiers de sa longueur en avant du mât. La partie la plus large, et par conséquent la plus considérable, porte sur le derrière.
L’eau est renfermée dans des cocos ou dans de grands bambous dont on a enlevé les séparations intérieures que forment les nœuds. Le pont, qui s’appuie sur la carlingue ou le fond, est fait d’une claie de bambou. Ces embarcations n’ont point de gouvernail ; une pagaye assez forte en tient lieu. Ces bateaux portent très-bien la voile, quoiqu’on ne les expose à la mer que dans les beaux temps ; cependant, ceux de la plus grande dimension exécutent des voyages d'une île à l’autre. Ils sont montés généralement de cinq à dix hommes.
Lorsqu’il s’agit d’entreprendre de longs voyages, les naturels réunissent deux pirogues pour en faire une double. Ils ont des balanciers qui leur servent non seulement à empêcher le bateau de donner une trop grande bande, ce qui le ferait chavirer, mais encore à soutenir leur mât au moyen de haubans attachés à l’extrémité des balanciers. Lorsqu’en veut tenir le vent, en incline la voile le plus qu’il est possible dans le prolongement du bateau : pour aller vent arrière, on lui donne son inclinaison la moins grande, et la voile est presque perpendiculaire. Les bouts de la voile, qui sont sur le derrière, ont leur écoute et leurs bras ; on tient l’écoute au bord du bateau.
Pour virer, ce qui se fait avec beaucoup de prestesse, on cargue la partie basse et en dehors de la voile, de manière à ce qu’elle se prolonge avec le mât. Je crains bien que ceux de mes lecteurs qui sont étrangers à la navigation ne trouvent cette description de bateaux et de pirogues fort insipide ; j’aurais désiré leur épargner l’ennui de tous ces détails du métier qui ne peuvent intéresser que les gens de mer ; mais j’écris aussi pour ces derniers ; je ne puis me dispenser de consigner ici des observations qui peuvent avoir quelque valeur à leurs yeux.
Tandis que les pirogues ne cessaient de nous accoster, une foule de Noukahiviennes, paraissant se soucier fort peu des requins et de leurs terribles morsures, se dirigeaient vers nous à la nage. Presque toutes, tout en fendant l'onde, portaient au bout d'un bâton l’étoffe dont elles comptaient de se vêtir une fois sur notre bord.
Effectivement, nous les vîmes bientôt, s’accrochant à tout ce qui pouvait leur prêter un appui, envahir notre pont avec la prestesse et l’agilité de véritables sapajous, et procéder sur-le-champ à leur toilette, qu’un rigide observateur des lois de la pudeur eût pu trouver, à bon droit, d’une simplicité fort insuffisante. Leurs regards, leurs gestes, leurs agaceries répétées, ne permettaient pas de douter du motif de leur visite ; et les hommes d‘ailleurs se chargeaient aussi de l'expliquer par une pantomime des plus significatives.
Mes marins n’étaient rien moins que disposés à résister à de pareilles avances, et l‘entrepont ne tarda pas à devenir le théâtre de scènes sur lesquelles il est à propos de jeter un voile épais. Une fois les échanges terminés et le navire mis à l’abri de toute surprise, je descendis avec M. Martinés dans un canot monté par huit hommes. J’avais hâte d’examiner la baie plus en détail et de tenter une excursion dans l’île.
Un indigène, qu’à son air de supériorité et aux dessins particuliers qui ornaient son corps nous reconnûmes aisément pour un chef, s’était offert de lui-même à nous servir de guide et nous accompagnait. De son côté, ayant reconnu en moi le commandant du navire, c’est-à-dire un ami digne de lui, il m’avait proposé de devenir son tayo ; on pense bien que je n’eus garde de refuser cette proposition : nous échangeâmes nos noms, il devint Gabriel Lafond, moi Tayofauo (l'ami Fauo), et frottant à plusieurs reprises nos nez l'un contre l’autre, nous nous trouvâmes dès ce moment liés à la vie, à la mort.
La baie de la Madre de Dios, aujourd’hui Vaitahu, est située vers le milieu de la côte occidentale de l’île, au-pied de la partie la plus élevée des terres. Elle gît dans le sud 45" est du monde de la pointe ouest de l’île Hiva Oa, et n‘a pas plus de deux milles d'ouverture sur trois quarts de mille de profondeur. Les deux pointes qui la forment sont dans le gisement du nord 16° est, au sud 46" ouest du monde. Celle du sud finit brusquement par un rocher escarpé, au sommet duquel s'élève un pic adossé à de hautes terres. Une colline d'une pente douce décroît insensiblement vers la pointe septentrionale, qui est terminée par des rochers acores et caverneux, dont la partie supérieure, portée en saillie, forme une espèce de demi voûte. Cette pointe du nord, noire et brûlée, est bien moins élevée que celle du sud ; nous la trouvâmes couverte de grands casuarina, arbres dont le bois dur et lourd est employé à la fabrication des massues et autres armes de guerre (* casuarina equisetifolia, l’arbre de fer « toa »).
À l'exception de deux petites anses qui, l'une et l'autre, reçoivent un ruisseau, et où l'on trouve une grève abordable, le surplus de la baie ne nous offrit que des rochers acores, tout près desquels la sonde indique un fond de corail sur une profondeur de vingt brasses et plus. Les terres du fond de la baie présentent une chaîne de hautes collines légèrement déchiquetées à leurs sommets, et escarpées en plusieurs endroits.
Les deux petites anses dont je viens de parler sont séparées par un cap qui se projette en mer sur un plateau de rocher à bords abruptes, et dont le sommet était couvert d'une herbe qui nous parut s'élever à de mi-hauteur d'homme. Deux vallées bien garnies d'arbres aboutissent à l'anse du nord, et un joli ruisseau, après avoir fertilisé les terres, vient offrir, à son embouchure, une bonne aiguade aux navires. Cette anse est la plus importante sous le rapport de l'étendue et de la population ; et c'est vers elle que nous nous dirigeâmes pour prendre terre, guidés par mon nouvel allié, par mon tayo, qui mettait une complaisance vraiment exemplaire à nous donner, à sa manière, tous les renseignements dont nous pouvions avoir besoin.
Cette complaisance n’était pas tout-à-fait désintéressée ; mais n'anticipons point sur notre récit.
L’île de Tahuata, nommée Santa Christina par l’Espagnol Mendaña, se présente sous l‘aspect le plus agréable ; elle est très élevée, ainsi que toutes les autres îles du groupe. Sa plus grande longueur, du nord au sud, est de sept milles et demi ; quatre milles et demi forment sa plus grande largeur de l’est à l’ouest. La circonférence entière est d’environ vingt milles. Une chaîne étroite de hautes collines se prolonge sur toute sa longueur ; et du rivage partent d'autres chaînes d‘une égale élévation, qui vont se joindre à la chaîne principale. Ces collines sont séparées par des vallées resserrées et profondes, dans lesquelles se précipitent des ruisseaux, ou plutôt de bruyantes cascades. Partout, dans ces vallées, règnent l’ombre et la fraîcheur ; partout, le cocotier, l’arbre à pain, le bananier, le casuarina, le mûrier à papier (morus papyrifera), étalent au loin leurs rameaux, dont jamais l’hiver ne vient flétrir la luxuriante verdure. Après avoir cheminé à travers des sites ravissants qu’égayaient de temps à autre la présence de sauvages curieux et enjoués, nous débouchâmes tout-à-coup dans une vaste clairière où, autour d'un amas de lisons, gisaient çà et là des débris humains.
Je n‘essaierai point de peindre l'horreur qui s’empara de nous à cette vue ; nous restâmes quelques instants sans trouver une parole, immobiles, ne pouvant détacher nos regards des restes affreux qui nous soulevaient le cœur. Quant à notre guide, brandissant son casse-tête d’un air de menace, il se mit à exécuter une espèce de danse entremêlée de cris qui pouvait se traduire ainsi : « À la suite d'une bataille livrée par les-habitants de Tahuata à leurs ennemis acharnés, les naturels de Hiva-Oa, la victoire s’était déclarée pour les premiers, et, selon l’usage de certaines peuplades de l’Océanie, les vaincus avaient été mangés par les vainqueurs. »
Le sauvage, notre ami, termina sa pantomime d’une façon hideusement péremptoire : il se baissa, et ramassant un tibia où pendaient encore quelques lambeaux de chair, il nous fit comprendre de reste qu’il n’avait pas été un des convives les moins actifs dans cet odieux festin. Et cet homme, qui trouvait tout naturel de dévorer son semblable, avait pour moi, qu’il connaissait à peine, des raffinements d’attention dont un Européen n’eût pas été capable ; il prenait à tâche de m’aplanir les moindres difficultés de la route, me soutenant par le bras sitôt qu’un pas embarrassant se présentait ; plusieurs fois même, désirant m’épargner toute espèce de fatigue, il me chargea paternellement sur son dos pour traverser des ravins.
Mais à chacun selon ses œuvres ; l’heure des récriminations est arrivée. Ajoutons donc que, durant notre course, mon estimable tayo prit aussi la peine de débarrasser mes poches d’un mouchoir, d’une boite à cigares et d’un couteau qui s’y trouvaient ; espièglerie, d’ailleurs, qu’il accomplit fort subtilement, et sans doute se fiant à cet adage, qu’entre amis tout est commun.
Du reste, ce fut avec un sentiment de plaisir très vif que nous remîmes les pieds sur ma gentille goélette. M. Martinès surtout paraissait ravi de se voir en lieu de sûreté ; il ne rêvait que chair humaine, cannibales, et festins, où il eût été fort désagréable pour nous, je l’avouerai volontiers, d’être servis en guise de rôti.
CHAPITRE DEUXIÈME.DANS LES ILES MARQUISES
Départ de Tahuata. - Ua Huka. - Arrivée à Nouka-Hiva. - Baie de Taiohae. - Description de l’île. - Mon maître d‘équipage Peters. - Le commandant Porter.
Nous appareillâmes le surlendemain de notre arrivée à la baie de la Madre de Dios, et nous fîmes voile vers Nouka-Hiva, la principale des îles Marquises, et celle qui a donné son nom à cet archipel.
Un vent excellent favorisait notre course, et nous ne tardâmes pas à découvrir l’île Ua Pou, la plus méridionale du groupe nord-ouest. Cette île, que l’équipage du Solide nomma île Marchand, du nom de son capitaine, nous apparut, lorsque nous n’en fûmes plus qu’à six ou huit milles de distance, une terre haute, très-montueuse, surmontée d’aiguilles basaltiques très-déliées et de l’aspect le plus bizarre.
En nous dirigeant au nord-ouest, pour voir de plus près la côte sud-ouest de Ua Pou, nous reconnûmes le rocher signalé par Marchand, qui lui donna le nom de l'0bélisque. La partie sud-ouest de l’île présente quelques jolies anses de sable, sur le contour desquelles, parmi les bananiers, les cocotiers, les arbres à pain, se dessinaient des huttes éparses que les naturels abandonnaient en toute hâte pour accourir sur le rivage et contempler ma goélette, qui s’inclinait gracieusement sous la brise.
L’aspect de l’île, dans cette partie, est aussi agréable que varié. Des collines dont une verdure animée recouvre les pentes douces et les sommets ; des vallées ombragées par de riches plantations ; plusieurs ruisseaux que nous distinguions parfaitement, et qui rendent à la terre desséchée par les feux d’un soleil tropical la fraîcheur et l'humidité nécessaires à la végétation ; enfin une belle cascade dont les eaux écumantes se précipitent dans un vallon ; tous ces objets réunis sur un petit espace attiraient tour à tour et fixaient agréablement nos regards.
De hautes montagnes dont les sommets sont arides et hachés, et qui doivent se refuser à toute espèce de culture, occupent le centre de l‘île ; mais ces montagnes cessent de paraître élevées quand on porte les yeux sur des pics de rochers nus et inaccessibles dont les flèches aiguës semblent appartenir à des clochers pointus et élancés de la renaissance. Sur ces entrefaites, une pirogue pagayée par quatre insulaires accosta le navire, et bientôt l’un d‘entre eux sauta bravement sur le pont. Il examinait tout avec attention et témoignait sa surprise en riant aux éclats. Quand il eut terminé son inspection minutieuse, nous lui offrîmes quelques bagatelles qui parurent lui faire plaisir ; et pour nous prouver à son tour sa générosité, il nous fit don de toute sa défroque : à savoir de quelques plumes de paille-en-queue, fort sales, qui ornaient son chef !
Le cadeau n'était pas ruineux, mais on ne saurait donner ce qu’on n’a pas, et pour l’homme habitué à vivre nu, la moindre des choses vaut un habillement complet, surtout lorsque le tatouage couvre presque toutes les parties du corps. À l'exemple de ses devanciers, le capitaine Marchand crut devoir prendre possession, au nom de la France, de l’île Ua Pou, dont il fit la découverte en juin 1791 ; possession qui entraînait de droit, dans l’opinion reçue, celle des autres îles qu’il pourrait découvrir dans les mêmes parages. Cette cérémonie, dit le rédacteur du voyage de Marchand, se fit en attachant avec quatre clous, contre le tronc d’un gros arbre, une inscription qui indiquait le nom du Solide et de son capitaine, et la prise possession de l’île par les Français.
Les naturels, à qui rien n'échappait de ce que pouvaient faire des étrangers, objet de leur curiosité et de leur admiration, ne se doutèrent certes pas qu’on s‘emparait solennellement de la terre où reposaient les ossements de leurs pères, et qu’on leur donnait ainsi un maître dans un autre hémisphère, à plus de trois mille lieues de distance. Pour plus de sûreté, on transcrivit ensuite cette inscription sur trois feuilles de papier qui furent roulées séparément et renfermées dans trois bouteilles, qu'on boucha et cacheta soigneusement : l'une fut déposée entre les mains d’un vénérable chef ; une autre fut remise à un homme d’un âge mûr ; et la troisième fut confiée à la garde d’une jeune fille. Trois générations semblèrent à peine suffisantes pour répondre d'un dépôt si précieux.
Quoi qu’il en soit, l’île Ua Pou ou Marchand, sera comptée dans le trop petit nombre des îles du grand Océan, dont l’effusion du sang n’a pas souillé la découverte. Le navigateur ne se doutait pas que cinquante-quatre ans plus tard la prise de possession serait accomplie par le gouvernement de son pays.
Les rochers de la baie de Possession où Marchand aborda (* Hakahetau), et ceux qui se prolongent dans la mer pour en former les pointes, diffèrent essentiellement des rochers de la baie de la Madre de Dios de l’île Tahuata, lesquels contiennent des productions volcaniques ou différentes espèces de laves, dont quelques-unes sont remplies de coquilles blanches et verdâtres. La pierre dont sont formés les rochers de la baie de Possession, est grise, de la même qualité que celle de la plupart des carrières de France, et ne paraît avoir subi aucune altération. On distingue, dans plusieurs endroits, des couches parallèles inclinées à l’horizon, dans d’autres, les couches sont horizontales.
Les pics qui dominent les hautes montagnes de l’île paraissent être de la même formation et ont la même couleur que les rochers dont les côtes sont formées. On ne découvre aucune trace de feu, aucun indice de l’effet d’un volcan ; ces masses de rochers, accumulés et inclinés sous différents angles, sembleraient plutôt indiquer que cette île appartenait à une plus grande terre dont les parties basses ont été abîmées sous les eaux, ou que des secousses violentes qu’elle aura éprouvées dans un tremblement de terre auront affaissé le terrain, et occasionné l’éboulement et l’écroulement des rochers qui ferment ses bords. Il est pourtant probable qu’en pénétrant dans l’intérieur de l’île, on découvrira quelques traces d’anciens volcans.
M. Dupetit-Thouars a estimé dernièrement la population de cette île à deux ou trois mille habitants. Sa longueur totale, du sud au nord, est de huit milles marins ; sa plus grande largeur, de cinq milles ; son contour embrasse une étendue de vingt-deux milles. Elle est distante de Hiva Oa de cinquante-cinq milles.
L’officier que j’avais envoyé à terre me déclara qu’il n’avait eu qu’à se louer de la conduite des habitants ; mais n’ayant rien à faire sur cette île, nous fîmes force de voiles pour nous élever dans le nord. Le vent continuait à nous favoriser, et lorsque la nuit nous surprit, les montagnes de Ua Pou étaient déjà bien loin derrière nous.
Au point du jour, des fous, des goélettes, des frégates, des paille-en-queue et une multitude d’oiseaux de différents plumages vinrent voltiger autour de l’Estrella. Nous, vîmes aussi beaucoup d’énormes poissons-volants. Quelques matelots s’étant mis à pêcher, ils prirent plusieurs grosses bonites et de superbes dorades qui furent un délicieux régal pour l’équipage.
À neuf heures et demie du matin, nous pûmes distinguer clairement les côtes de Nouka-Hiva ; Marchand ne l’a pas visitée, mais il l’a nommée île Baux, lui donnant ainsi par reconnaissance le nom de ses armateurs de Marseille.
Nous n'étions pas encore parvenus dans la baie Taiohae, qu‘une flottille de pirogues, chargées de naturels des deux sexes et semblables à celles de la baie de la Madre de Dios, se porta en toute hâte à notre rencontre de différents points de l'île. La goélette était si basse et si petite, qu’elle fut en un clin d'œil couverte, encombrée de sauvages qui, dans l‘impossibilité où nous étions de les surveiller, s'appropriaient tout ce qui leur tombait sous la main. Voyant que leur insolence croissait avec leur nombre, je fis armer de suite cinq soldats de marine que j‘avais à bord, et refoulai sur le gaillard d’avant tous les naturels, tenus en respect par nos baïonnettes ; en même temps, j’ordonnai de lofer à l’est, et nous nous éloignâmes de l'île toutes voiles dehors.
La brise était fraîche, et la goélette filait de huit à neuf nœuds ; aussi, en peu de temps, et malgré les efforts de ceux des insulaires qui tentèrent de nous suivre en pagayant, nous distançâmes de beaucoup les pirogues. Plusieurs sauvages se jetèrent à la mer pour regagner leurs embarcations ou le rivage ; c'était un sauve-qui peut presque général.
Sans craindre les dents meurtrières des requins et des bécunes, qu’elles savent éviter, des femmes, de jeunes filles s’élançaient par-dessus nos bastingages et tombaient dans les flots, qu’elles fendaient joyeusement en développant à nos yeux des grâces inimaginables. Ce spectacle me rappela tout mon savoir mythologique, et je les comparai à des naïades ou à des sirènes se jouant au sein des ondes avec des faunes ou des tritons.
Quand le pont fut débarrassé, je laissai arriver sur la terre. Deux insulaires, qui paraissaient exercer quelque autorité sur leurs compagnons, dont ils n'avaient point partagé la panique, étaient restés près de moi. Je dirigeai leur attention sur une troupe d’oiseaux de mer qui tapissaient une roche, et nous en étant approchés, nous les saluâmes de cinq ou six coups de fusils chargés avec du gros plomb. Une trentaine d'oiseaux tombèrent ; les uns étaient tués ; les autres, blessés seulement, se sauvaient sur les eaux ou cherchaient à se dérober à nos coups par des plongeons réitérés. Je fis un signe ; les naturels me comprirent, et, s’élançant dans la mer avec l‘ardeur et la sagacité du meilleur chien de chasse, ils m’eurent bientôt rapporté jusqu’à la dernière des innocentes victimes de ma cruauté.
Alors je leur montrai les blessures des oiseaux et le sang qui en découlait, leur faisant ainsi envisager la puissance de nos armes à feu. Jusqu’à cette époque, les Noukahiviens n’avaient pas souvent expérimenté les effets meurtriers de la poudre ; les fusils et les canons ne leur étaient sans doute pas étrangers ; mais leur île n’avait guère été visitée que par de forts navires, par des frégates ; des corvettes de guerre ou de grands baleiniers dont la masse leur avait imposé. Inspirer à mon tour de la crainte tel était le but que je devais me proposer, et ce n’était pas chose facile avec une goélette si petite et un équipage composé de trente-cinq hommes environ, y compris les cinq soldats de marine.
Deux grandes pirogues restaient abandonnées des Noukahiviens qui avaient fui à la nage. Je les montrai aux insulaires, et gouvernant sur l‘une, je passai dessus et la brisai. Je fis braquer sur l’autre quatre espingoles des bastingages, chargées à mitraille, et la mis pareillement en pièces.
« Mate, mate » s’écriaient les naturels saisis de frayeur. « Youlpou ! » (* incompréhensible) disaient-ils en tremblant.
Peters, le maître d'équipage de mon bord, qui avait vécu quelques années parmi ces sauvages, leur dit que je paierais aux propriétaires des pirogues le prix qu’ils en demanderaient. Les deux chefs paraissaient à la fois satisfaits et remplis de terreur, touchant nos moyens de destruction.
Je compris à leurs gestes qu’ils comparaient ma goélette au vaillant espadon, qui ne craint pas l’attaque de la baleine colossale, dont il sait éviter les atteintes par la vitesse et la rapidité de ses mouvements. Le but que je m’étais proposé était atteint ; j’avais prouvé que mon navire, aussi bien qu’un plus grand, était en état de se défendre et de réprimer toute espèce d’attaque. Je tenais encore à démontrer que le vent même ne pouvait entraver notre marche. Aussi, dès que nous eûmes doublé la pointe Est de la baie Taiohae, je fis serrer les voiles et armer douze avirons de galères ; deux hommes furent mis à chaque aviron, et mes sauvages prirent à voir la goélette filer ainsi quatre à cinq nœuds et avancer rapidement vers le fond de la baie, où je fus la mouiller.
Une fois ancré, je donnai l’ordre de hisser les filets d’abordage, et je ne permis qu’à un très petit nombre de naturels de monter à bord à la fois pour faire les échanges.
Nous nous nous procurâmes une quantité considérable de noix, de bananes, de fruits à pain et de poissons, ainsi que divers petits meubles et ustensiles, des armes, des étoffes et des ornements à l‘usage des naturels. Nous eûmes aussi à nous garantir de quelques petits larcins, mais lorsque l’objet dérobé était réclamé, le voleur le restituait sans résistance, souvent même en riant.
J’eus plus tard l’occasion de me convaincre que si le vol est pour ces peuplades l’effet d’une passion irrésistible, une espèce de besoin de la nature, que ne manque jamais d’exciter la vue d’objets nouveaux, il n’a rien de dégradant et qui mérite le blâme à leurs yeux ; car je vis souvent des naturels des Marquises porter pendus à leur cou, en notre présence, des objets qu’ils nous avaient dérobés la veille ou le matin même. Je les crois beaucoup plus avisés aujourd’hui. Mais pendant que le commerce de subsistances nous occupait, mes officiers et moi, un commerce d’une autre espèce s’introduisait à bord.
On va comprendre sans peine ce que je veux dire ; à savoir : parmi les naturels amenés par les pirogues, se trouvaient un grand nombre de femmes et de jeunes filles avides de plaisir, qui ne demandaient qu’à échanger contre la moindre bagatelle, ou peut-être même à donner généreusement pour rien la seule chose traficable qu’elles eussent à leur disposition. Mes matelots n‘étaient rien que des Joseph et ils y allèrent au-devant des vœux de ces Putiphar de l'Océanie. Quelques puritains crieront au scandale, ils diront : Les missionnaires méthodistes, dont on a dit de mal n’ont fait qu'empêcher ce dévergondage éhonté.
J’avoue qu'il est rarement permis sur les navires français. Mais pourquoi donc est-il permis sur ceux même de la Grande-Bretagne, et partout et dans toutes les mers, à bord de tous les navires de sa gracieuse majesté la reine Victoria ? « Le besoin, la nécessité de retenir les équipages à bord » vous répondront tous les marins du Royaume Uni.
Mon Dieu ! Tranquillisez-vous, très pieux protestant Lutteroth ; grâces à vos sages instructions, tout se fait maintenant d’une façon plus régulière ; si les femmes de l’Océanie n’ont pas cessé de venir à bord des navires offrir ce qu’elles croient devoir faire plaisir à leurs nouveaux hôtes, dans toutes les parties du monde, les chrétiennes de toutes les sectes ont appris à vendre leur souillure et leur prostitution !!!
Mais détournons nos regards de ces scènes de désordre ; un tableau plus riant et d‘une teinte toute sentimentale, nous est offert d'un autre côté.
J'ai dit plus haut que Peters, mon maitre d’équipage, avait déjà résidé aux Marquises ; c'était lui qui me servait d’interprète, et, placé sur le bastingage, il se chargeait de faire comprendre aux naturels qui avaient terminé leurs échanges ou satisfait leur curiosité qu’ils ne pouvaient demeurer plus longtemps et céder leur place à d’autres. Inutile de dire que, parmi les visiteurs, il reconnaissait à chaque instant d’anciens amis qui lui témoignaient une grande joie de le revoir et s'empressaient d’aller offrir à son nez l’accolade d'usage.
Jugez de la surprise et de l'émoi de Peters !... Tout-à-coup, au milieu 'de quelques naturels qui s'avancent en pirogue, il croit reconnaître sa maîtresse, sa femme, une Noukahivienne qu'il avait laissée enceinte et mère déjà, lorsqu'un navire baleinier l‘emporta loin de ces contrées.
Peters craint de se tromper ; immobile à sa place, il cherche à rassembler ses souvenirs... Mais le doute n'est plus possible ; c’est elle, c'est bien elle ! Accompagnée d'une jolie petite fille de huit à neuf ans et portant dans ses bras un enfant plus jeune de quelques années, une femme vient de se précipiter sur le pont et tombe dans les bras de son amant, où elle s’évanouit de bonheur, Quant au maître d'équipage, c'est avec peine qu'il résiste à tant d’émotions ; ses yeux sont voilés de larmes, et il semble se partager entre les soins à donner à sa fidèle compagne et les caresses qu’il prodigue à ses enfants. Et nous, témoins de cette scène attendrissante, nous pouvions nous écrier avec notre poète favori :
« Des deux objets de sa tendresse,
Qu‘à son riant foyer, toujours environné,
Sa femme et ses enfants couronnent sa vieillesse
Comme de ses fruits murs, un arbre est couronné »
Je raconterai plus loin l'histoire de Peters et de Pafa-Hé, fille d'un des chefs de cette île.
L'île Nuku Hiva offre la même structure géologique que le reste de l'archipel. Une chaîne de hautes montagnes, en général dénuée d’arbres aux sommets, la prolonge dans sa plus grande longueur et descend à la mer par d'autres chaînes escarpées, entre lesquelles se développent les fertiles vallées qui recèlent les cases des habitants. Du reste, l’extérieur de cette terre n’a rien de bien riant ; toutes les beautés naturelles se trouvent confinées dans l’intérieur des baies, dans les sillons formés par les ramifications de la chaîne des monts qui s’élèvent au centre de l’île.
Au dehors, la scène est majestueuse et pittoresque ; au dedans, gracieuse et attrayante ; l’œil, effrayé d’abord par l'apparence stérile des rochers, se réjouit ensuite en contemplant les richesses végétales de l'intérieur des mouillages. Trois baies sont les seules connues sur l’île Nouka-Hiva ; ce sont, en allant de l’Est à l’0uest, la baie de Contrôleur ou des Taipi, la baie Anna-Maria ou Taiohae, et la baie Tchitchagoff ou Hakauì.
Lorsqu‘on vient du large, l'entrée de la baie Taiohae est entièrement cachée, jusqu‘à ce qu’on aperçoive à l’Est un rocher noirâtre, haut, irrégulier, et séparé de la grande terre par un canal très étroit ; les indigènes appellent cet îlot, couvert de quelques arbres rabougris, Mataùa, ce qui veut dire hameçon (* c’est « metau » qui signifie « hameçon » ; le nom de ce gros rocher est « Mataùapuna ») ; à l’Ouest, s’élève un îlot conique d’un aspect grisâtre. À la pointe Est de l’entrée s’étend un long filon blanc qu’on prendrait pour une chute d’eau ; ce n’est qu’en approchant qu’on reconnaît qu’une teinte particulière du rocher lui donne cette apparence.
L’entrée de la baie est parfaitement sûre ; elle forme un canal dont la largeur est d’environ un mille, et la longueur un mille et demi ; des mornes escarpés et souvent taillés à pic le bordent des deux côtés : ils vont rejoindre une chaîne de hautes montagnes qui se dressent majestueusement dans le fond, tandis que, sur des plans plus rapprochés, la baie et la vallée qui l’encadre complètent cet imposant tableau.
Deux plages sablonneuses divisent la haie, de forme circulaire ; elles sont séparées par un morne assez escarpé (* La colline Tūhiva, ancien Fort Collet), sur lequel fut placée la batterie de Porter. Deux mots sur cet intrépide Américain.
Entre 1812 et 1813, dans la dernière guerre des États-Unis d'Amérique contre l'Angleterre, Porter commandait une corvette la marine militaire de l’Union, et croisait dans l’océan Pacifique pour chercher et combattre les ennemis de sa patrie. Sorti d’un des ports du Pérou pour se préparer à ces luttes d’extermination, il était venu à Nouka-Hiva, et il avait construit un fort dans la baie Taiohae, afin de s’assurer un refuge où il pût conduite ses prises, se réparer et se ravitailler en cas de besoin.
Effectivement, aucun endroit mieux fait que cette baie pour couvrir la retraite d’un corsaire ; entrée étroite et encaissée, facile à défendre ; large plage, baie spacieuse, eau, vivres et bois faciles à se procurer ; climat enchanteur, et propre à réparer les fatigues d’équipages épuisés par les combats et les longues navigations ; tout s’y trouvait réuni.
Porter aborda Nouka-Hiva le 25 octobre 1813, et décida que la plage de l’est de la baie de Taiohae lui servirait, à établir un camp. Mais il lui fallut d’abord vaincre la résistance des naturels qui s’opposèrent vigoureusement à sa descente. Dans cette circonstance, notre aventurier eut recours à un moyen fort connu, mais qui manque rarement son effet.
La guerre venait de s’allumer entre les habitants de Taiohae et la tribu des Happas (*Hapaa). Il se mit à la tête de ceux-là et marcha avec eux vers la baie de Contrôleur. Les Happas furent vaincus, et le rusé Corsaire se paya lui-même de son officieux concours, en se déclarant immédiatement souverain de l’île entière.
Mais ce que Porter n’espérait pas, sans doute, rencontrer à Nouka-Hiva, et ce qu’il eut le bonheur d’y trouver, ce fut une maîtresse aimante et dévouée, dans la personne de la jeune et belle Paètini, fille du roi Kiatonui. Toutes les preuves d’amour qu’il reçut de cette femme auraient dû le décider à l’attacher à son sort ; mais d’autres soins appelaient ailleurs l’aventurier, et il abandonna ce noble cœur comme il quitta cet archipel, qui sait ? Peut-être sans une pensée de regret.
Le chagrin de Paetinien se séparant de son amant ne fut point adouci par le titre qui lui fut alors conféré de gouvernante et reine des îles Marquises, et de toutes les tribus réunies sous la loi du commandant Porter. Paetinis’éleva au niveau de sa nouvelle dignité, et d’une jeune fille timide et faible, elle devint une femme pleine d’audace et de courage, et digne sous tous les rapports de commander les marins auxquels Porter avait remis la garde de sa conquête ; à peine Porter eut-il abandonné Paetinisous la garde d’une faible garnison, aux ordres du lieutenant Gamble, que le fort fut attaqué par plusieurs milliers de naturels révoltés. L'esprit de révolte travailla aussi la petite troupe, et Gamble et une partie des siens se sauvèrent avec une des prises de Porter, aux îles Sandwich, où ils furent faits prisonniers par les Anglais. (* Pour un retour à plus d’authenticité, lire l’ouvrage de David Porter référencé en bibliographie).
Quelques Américains restés fidèles à leur drapeau, ne pouvant plus résister au nombre toujours croissant de leurs ennemis, furent massacrés et sans doute dévorés par ces cannibales. Telle fut la fin tragique de l’expédition du valeureux Porter. Toute sa vie, Paetiniconserva l’espoir de revoir son amant ; toute sa vie, elle lui demeura fidèle ; vivant seule, à l’écart, et usant ses yeux à guetter le vaisseau qui devait lui ramener l'objet de sa tendresse (* C’est faux ; Paetiniavait de nombreux maris secondaires qui lui ont survécu à son décès vers 1840). Hélas ! En tous lieux, même en Europe, bien rares sont les Paètini.
CHAPITRE TROISIÈME
Descente à terre – Habitations – Climat – Inondations – Moraï – Tapu – Kikino - Maison d‘un chef - Nature et productions du sol – Animaux – Aliments – Population – Guerres – Gouvernement - Distinctions sociales - Le roi Kéa-Toi est reçu à bord de l’Estrella.
La nuit vint nous surprendre au milieu de nos échanges et ce ne fut pas sans peine qu’on réussit à renvoyer chez eux nos tenaces et curieux visiteurs ; quelques-uns et surtout quelques-unes restèrent sur le gaillard d’avant. Il était environ minuit, et tout l’équipage, des hommes de garde exceptés, se livrait aux douceurs du sommeil, lorsque je fus tout-à-coup réveillé par mon lieutenant. « Un grand nombre de feux, me dit-il, étaient allumés sur la côte, et nous devions nous attendre à une attaque. »
Je montai de suite sur le pont, et ayant reconnu la vérité de son rapport, j’ordonnai le branle-bas général de combat. En une minute, tout le monde fut sur pied, et nous nous disposions à une vigoureuse défense, lorsqu’un examen plus approfondi me fit découvrir l’inutilité de nos préparatifs de guerre.
Bien loin d’avoir à notre égard des intentions hostiles, les insulaires ne songeaient qu’à se livrer au plaisir innocent d’une pêche aux flambeaux, et les feux, objets de nos soupçons, provenaient de torches résineuses placées sur l’avant des pirogues et destinées à attirer le poisson, qui est ensuite percé à l’aide d’une espèce de trident emmanché dans un long bambou. Les femmes sont aussi d’excellents otages à bord, et rarement, ou, pour mieux dire, jamais un navire n’a été attaqué avant un certain nombre de femmes insulaires. Le péril s’était évanoui ; je fus me recoucher, et le reste de la nuit se passa fort tranquillement.
Dès que le jour parut, je descendis à terre avec le capitaine Martinès, Péters, mon maître d'équipage, et quelques hommes bien armés, afin d’explorer l’intérieur de l’île. Nous portions avec nous une petite cargaison de miroirs, de couteaux, de clous, de verroteries, et autres menus objets destinés à nous rendre propices les naturels dont nous pourrions avoir besoin. Les petits cadeaux entretiennent l’amitié, dit-on. Dans les îles de l’Océanie, ils la font naître ; et pour un eustache de six liards (* on pourrait dire : pour une pièce de six sous), un Nukahivien va devenir votre inséparable, votre Pylade (* Dans la mythologie grecque, Pylade est l’ami d’Oreste qu’il n’abandonne pas, même quand il devient fou après avoir assassiné sa mère). Il vous offrira sa femme, sa fille ; et ce qui est mille fois plus précieux, il vous donnera à croquer, soit un des insectes dodus qu’il n’est jamais embarrassé de trouver dans sa chevelure, soit le morceau que ses dents auront trituré à votre intention.
Les maisons, à Nouka-Hiva, longues et étroites pour la plupart, sont bâties sur une plate-forme de pierres sèches élevées au-dessus du sol, de deux à trois pieds. Les murailles consistent tout simplement en cannes de bambous entrelacés de feuilles de cocotier et de fougères. Le toit est à une seule pente et se compose de feuilles sèches. Ces cases ont, en général, neuf à dix pieds de long sur cinq ou six de largeur (* un pied = 30cm) ; elles se divisent en deux parties bien distinctes : l’une destinée au coucher ; l’autre aux repas et aux réunions de famille. Le sol est pavé de grosses pierres, assemblées assez proprement et recouvertes de nattes. Les calebasses, les haches, les instruments de pêche, les armes, les tambours, etc., sont suspendus aux parois et au toit.
Nous remarquâmes aussi, en dehors des habitations, des plateformes dallées avec soin. Peters nous dit que c'était là que les naturels venaient s’asseoir et se livrer à leurs jeux. Brave Peters, chaque pas que nous faisions lui apportait un souvenir ; ici, il avait aperçu pour la première fois sa chère Pafa-Hé ; là, il s’était désaltéré avec elle aux eaux limpides d’un ruisseau ; plus loin, il lui avait proposé de devenir sa compagne, etc. Aussi avions de la peine à le suivre car il déployait en marchant une ardeur que ne pouvaient tempérer ni ses cinquante-cinq ans, ni la chaleur qui était accablante.
L’air sain et robuste des naturels de Nouka-Hiva ne laisse aucun doute sur de salubrité du climat. Durant le séjour que je fis dans cette île, le thermomètre de Réaumur ne s’éleva guère au-dessus des 29° et ne descendit jamais au-dessous de 24°. Aux Marquises, comme dans toutes les régions tropicales, l’hiver est la saison des pluies ; mais elles ne sont ni fréquentes ni continues ; quelquefois même, il s’écoule plusieurs mois sans qu’il tombe une goutte d’eau.
Du reste, les terrasses sur lesquelles les maisons sont bâties, et l’habitude qu’ont les naturels de se servir d’échasses, prouvent assez que l’intérieur des vallées de ces îles est sujet à des inondations. (* On sait, désormais, que les échasses étaient une sorte de jeu qui n’avait rien à voir avec d’éventuelles inondations.) Les Nukahiviens marchent, courent, sautent sur leurs échasses comme ne pourraient le faire les plus agiles des habitants du département des Landes ; dès l’enfance ils s’y exercent et mettent beaucoup de soin dans la confection de ces instruments dont le marchepied est toujours sculpté avec art. J’oubliais de dire que près de tous les villages se trouvent de petits moraï ou cimetières dont on ne s’approche qu’avec le plus profond respect. Peters, notre cicérone (* guide) obligé, nous fit aussi remarquer un grand nombre de cocotiers aux troncs desquels était attachée une bande blanche de l’étoffe appelée tapa dans le pays. Ces arbres, nous dit-il, avaient reçu la consécration du tabou, c'est-à-dire qu’il n’était plus permis à personne d’y porter la main ; les chefs même, qui sont tabou de naissance, ainsi que toute leur famille n’osent enfreindre cette interdiction. Il n’appartient qu’aux prêtres de prononcer un tabou général ; mais le premier venu a le droit d’en attacher un à sa propriété ; il lui suffit de déclarer pour cela que l’esprit de n’importe qui y repose, et voilà la propriété bien gardée. Un drapeau blanc indique un lieu tabou et interdit à la multitude ; il en est à peu près ainsi dans toute la Polynésie ; Toutes espèces de choses, d’ailleurs, des maisons, des moraï ou cimetières, des pirogues, des arbres, etc., peuvent devenir tabou, et malheur au kikino, c'est-à-dire à l’individu assez imprudent pour violer cette consécration ! Plus de salut pour lui ! À lui les coups ! À lui la mort dans la bataille ! Tel est le sort qui l’attend, et les prêtres savent s’arranger pour qu’il ne manque jamais de s’accomplir dans toute sa rigueur.
Peters marchait, marchait toujours... Il avait hâte, disait-il, de nous présenter aux parents de sa femme. Je m’expliquai sans peine un pareil empressement : quand on a pour beau-père un homme considérable, un des plus puissants chefs d’une île, on aime à le produire ; c’est-ce qui arrivait ici, et mon maître d'équipage tenait fort à nous convaincre que, s’il était descendu jusqu'à une Noukahivienne, du moins n’était-il pas entré dans une famille de basse extraction. Vanité des vanités, tout est vanité !
Enfin nous arrivâmes au palais de sa majesté non chrétienne. Ce palais consistait tout bonnement en une grande case d’environ vingt mètres de long sur quatre ou cinq de large ; il était situé au bord d’un frais ruisseau et sous l’abri protecteur d’une forêt de grands arbres. Cette case, comme toutes les autres dans cet archipel, était construite sur une plateforme de pierres un peu élevée au-dessus du sol ; sa direction principale s’étendait du Nord au Sud.
Du côté de l’Est, s’élevait perpendiculairement jusqu’au faite du toit un mur fait en bambous qui se touchent et interceptent l’air. Ce mur pouvait avoir de six à sept mètres de haut. Le côté de l’Ouest était fermé par le toit à une seule pente qui tombait sous un angle très aigu, presqu’à un mètre de la plateforme. Les deux extrémités de la case et la partie de l’0uest qui joignait de tous la plateforme étaient closes par des murs construits en bambous rapprochés, mais qui ne se touchaient pas et permettaient à l’air de circuler. Quant aux portes, elles se trouvaient du côté de l’Ouest ; s’il est permis, toutefois, d’appeler portes d’étroites ouvertures par lesquelles on ne peut passer qu’en se baissant beaucoup ; cette disposition des maisons est due aux vents d’Est, qui soufflent plus généralement dans ces parages ; Pafa-Hé, la femme de Péters, nous avait devancés, et ce fut elle qui se chargea de nous introduire dans la résidence peu royale de l'auteur de ses jours.
À l’intérieur, un seul appartement, dont les deux extrémités, plus élevées que le reste de la case, me parurent exclusivement réservées au chef. La partie intermédiaire de la chambre était divisée, dans le sens de la longueur, en deux parties à peu près égales ; celle du fond était jonchée d’herbes sèches, sur lesquelles on étendait des nattes pour se coucher ; c’était un dortoir commun à tout le monde. La partie antérieure servait d’officine ; et rien n’y recouvrait les pierres du sol ; c’est là que sont relégués les vases et ustensiles nécessaires à la préparation des aliments.
Sitôt que nous eûmes pénétré dans ce singulier palais, le chef vint au-devant de nous et me présenta gravement à sa femme et à ses nombreux enfants ; parmi lesquels je distinguai p1usieurs jeunes filles vraiment charmantes.
Le monarque Noukahivien, dont la prestance, malgré son âge, était encore remarquable, me parut avoir fait quelques frais de toilette à notre intention : il était revêtu d’un grand manteau d’écorce de tapa (morea papireus), une espèce de diadème de tresses de coco, garnies de nœuds de perles ceignait sa tête, et d’énormes pendants ovales, en dent de baleine, ornaient ses oreilles ; ses hanches étaient entourées d’un chapelet de chevelures, trophées glorieux arrachés aux crânes de ses ennemis ; un collier de coquilles du plus beau poli pendait à son cou, et complétait ce costume qui ne laissait pas d’être porté avec une certaine élégance. La figure, les mains, les pieds et tout ce qu’on pouvait apercevoir de la peau de Keatoi, disparaissaient sous une triple couche de tatouages dont l’explication eut fort embarrassé un amateur d’hiéroglyphes.
La femme et les filles du roi étaient enveloppées dans de grandes pièces de tapa, et en face d’elles, bon nombre de curieux accroupis sur les pierres, ne perdaient pas un seul de nos mouvements. La reine avait les mains, les jambes et les pieds nus et élégamment tatoués. Keatoi me fit par l’entremise de Peters, beaucoup de questions sur mon pays, sur son souverain ; sur sa population, sur ses usages. Puis il me fallut devenir son tayo et changer de nom avec lui ; dès ce moment, Keatoi n’eut plus rien à me refuser, j’étais le maître de ses biens, de sa maison, de son royaume en général, et de son épouse en particulier. Lecteur ; plaignez-moi, madame Keatoi était âgée de cinquante printemps pour le moins, et je la voyais disposée à exiger de son mari « par intérim » le rigoureux accomplissement des devoirs de sa charge, charge est le mot ; mais j’eus le bonheur d’esquiver cette bonne fortune.
Je fis au roi quelques présents, et l'ayant engagé à venir me rendre visite sur mon bord, nous nous quittâmes très satisfaits l’un de l’autre. J’avais l’intention de traiter avec lui d’un objet très important de mon voyage, la cession d’une contrée, d’une baie ou d’une partie de l’île où l’on pût fonder un premier établissement (*pénitentiaire) ; mais après m'en être entendu avec Martinès, nous ne voulûmes rien arrêter sans avoir visité Tahiti.
Nous trouvâmes tous les cantons que nous parcourûmes dans notre course couverts d’un riche terreau ou terre végétale, et la roche que cette terre recouvre nous offrit partout des traces de révolution volcanique. Du reste, les Marquises ne renferment aucun volcan en activité et ne paraissent pas sujettes à des tremblements de terre. Les habitants les plus anciens n’ont connaissance d’aucune perturbation de ce genre, ce qui tendrait à faire croire que ces îles, sont d’une origine déjà très reculée. Les forêts épaisses qui ombragent les vallées, les arbres répandus sur les collines et la verdure qu’on voit régner jusque sur flancs escarpés de quelques-unes, tout annonce la fécondité.
Le cocotier, le roi des palmiers, si utile à tous les habitants des tropiques ; l'arbre à pain, au tronc svelte, à l'écorce lisse et blanche, aux énormes fruits dorés, dont la pulpe est si savoureuse, la Providence enfin des peuples polynésiens ; le bananier aux fruits sucrés ; l'ananas si parfumé ; la douce pomme de Cythère, le citronnier odorant, croissent sans culture. À côté des arbres à fruits on remarque : l'arbre des Banians, qui abrite l'indigène de son large feuillage ; le triste casuarina, qui incline ses rameaux vers la terre et qui fournit à l'insulaire ses lourds casse-têtes ; l'hibiscus, la famille des artocarpus, qui fournissent aux naturels des bois pour construire leurs maisons ; le papayer aux doux fruits, symbole des pays tropicaux ; le mûrier à papier, qui lui donne ses vêtements ; le dracæna aux fleurs étincelantes, etc. .
Parmi les végétaux : l'utile canne à sucre, originaire de ces îles et aussi belle que celle d'O'Taïti, cultivée aujourd'hui aux quatre coins du monde ; des fougères gigantesques ; la racine dont la fécule nourrit sans fatigue les estomacs les plus faibles ; les jolies ronces et convolvulus, dont les graines rouges et grises et les calices violets se marient avec tant de grâce dans les chevelures noires des jeunes Nouka-Hiviennes.
Le cotonnier aux globules blancs et le café à pulpe rouge viendront bientôt mêler leurs rameaux à nos arbres fruitiers et à nos plantes potagères, dont je trouvai aussi quelques plants épars ; des pommes de terre, des choux, des laitues, des oignons, des melons, des citrouilles, mais en très-petite quantité, provenant de graines apportées par les baleiniers.
Dans toutes les îles de l'archipel on rencontre beaucoup de cochons ; ils sont libres et courent dans les montagnes, où ils se multiplient à l'infini ; leur chair est très-savoureuse. Les habitants en élèvent aussi près de leurs habitations, ainsi que des poules ; mais ils prennent peu de soin de ces dernières et n'en font de cas que comme moyen d'échange, et pour les plumes dont ils composent leurs parures. Le cochon, le chien et le rat étaient les seuls quadrupèdes connus dans toute la Polynésie avant l'arrivée des Européens. Les Nouka-Hiviens ont dû à la bienveillance de quelques navigateurs la naturalisation de plusieurs animaux utiles ; mais il n'y a guère que le chat qui se soit propagé chez eux. Il est certain que les animaux d'Europe s'acclimatent très-bien entre les tropiques ; mais que les naturels les ont exterminés pour en avoir la peau et les os. Ont-ils eu tort ? Je n'en sais trop rien. Un sol fertile leur offre spontanément une nourriture plus saine, plus appropriée au climat et à leur genre de vie, que celle qu'ils eussent pu tirer du règne animal. Et, à examiner la question sous le point de vue philosophique, il ne saurait être bien malheureux pour ces peuples que les Européens ne soient pas invités par trop de facilités à leur faire des visites fréquentes. La prise de possession les rendra-t-elle plus heureux ? Non, sans doute, car la civilisation écrase l'homme de la nature, comme le blé étouffe l'herbe qui croît à son pied.
La nourriture principale des habitants des Marquises consiste dans la popoï (* popoi), qui est une préparation fermentée de l'arbre à pain ; dans le taro, les ignames, les patates, les cocos, les bananes et le poisson. Les indigènes ont un excellent moyen pour manger le poisson toujours frais : ils le dévorent cru et tout vivant, au sortir de l'eau ; ils commencent par la tête, et bientôt tout y a passé, les petites arêtes comprises.
La popoï se prépare en enterrant ensemble une certaine quantité de fruits de l'arbre à pain ; lorsqu'ils commencent à pourrir, on les retire et on en fait une pâte avec laquelle on forme des pains qui sont ensuite cuits au four. La pâte ainsi préparée, et mêlée avec du fruit nouveau de l'arbre à pain et de l'eau, se nomme la popoï. C'est une bouillie épaisse et de couleur jaunâtre, qui jouit de la réputation d'être très-saine et très-agréable au goût ; cependant je dois à la vérité de déclarer que, malgré la meilleure volonté du monde, il ne m'a pas été possible d'en manger la moindre parcelle. Pour cuire leurs aliments, les Nouka-Hiviens creusent un trou dans lequel ils allument du feu pour chauffer des pierres ; dès qu'elles ont atteint le degré de chaleur convenable, on nettoie le trou, que l'on garnit au fond de ces mêmes pierres échauffées; on place dessus des feuilles de l'arbre à pain ou de bananier, puis le mets que l'on veut cuire, puis des feuilles, puis des pierres, et enfin de la terre; après un certain temps, on retire tout cela, et le mets se trouve cuit à point. Les viandes surtout acquièrent par ce mode de cuisson une saveur parfaite ; de petits cochons cuits entiers et dont le ventre a été rempli de plantes aromatiques font des mets qui ne seraient point indignes d'une table européenne.
Auprès de chaque habitation, on voit toujours un ou plusieurs trous revêtus de pierres et recouverts de branches et de feuilles d’arbres ; c'est là que les Nouka-Hiviens placent leurs provisions pour les conserver ; c'est leur garde-manger.
L'Ile Nouka-Hiva, quoique la plus considérable de l'archipel, n'est pas aussi peuplée que Hiva-Oa ; sa population, à l'époque où je la visitai, pouvait être de cinq à six mille habitants. On estime aujourd'hui la population totale des Marquises à vingt-cinq mille âmes environ.
Les Nouka-Hiviens ne connaissent aucune forme de gouvernement ; ils suivent la loi naturelle, c'est-à-dire que chez eux, comme dans beaucoup d'autres pays, très-civilisés d'ailleurs, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Les tribus vivent indépendantes les unes des autres et se disputent entre elles les vallées les plus fertiles, les bois les plus riches et les ruisseaux les plus abondants. De là des guerres continuelles et acharnées qui ont toujours été un obstacle à l'accroissement de la population. Ces guerres, d'ailleurs, sont conduites sans aucun ordre, sans aucune tactique ; chacun agit à sa guise ; lorsqu'une demi-douzaine d'individus sont tués dans un combat, on considère ce nombre comme très-grand, et il l'est en effet, si l'on a égard au nombre des combattants et à la fréquence de leurs batailles. D'ordinaire, les tribus belligérantes se placent sur le penchant de deux collines opposées, laissant entre elles un espace assez étendu. Quelques guerriers en grande tenue s'avancent en dansant, et au milieu d'une grêle de pierres et de lances, vers leurs adversaires, qu'ils provoquent au combat. Aussitôt, un parti de guerriers rivaux se lancent à leurs trousses, et si quelqu'un, dans la retraite, tombe atteint d'un projectile, on l'achève à coups de lance ou de casse-tête, pour le porter ensuite en triomphe. Si les habitants des Marquises se battent souvent, en revanche ils sont fort poltrons ; j'eus l'occasion de m'en convaincre. La seule circonstance où ils montrent du courage, c'est lorsqu'un des leurs tombe au pouvoir de l'ennemi ; alors, mort ou vif, il faut le reprendre, l'honneur le commande, et honte sur le lâche qui fuirait.
Quant aux prisonniers, on les assomme généralement avant de les faire rôtir pour les manger ; mais quelquefois aussi on les place tout vivants sur un brasier ardent. Les vainqueurs font cercle et attendent, en chantant et en dansant autour de la victime de leur infâme cruauté, l'instant où ils pourront la dévorer. Une fois les vaincus cuits à point, ils se jettent dessus comme des bêtes féroces, les coupent, les taillent et les dépècent. Au chef d'abord le morceau le plus friand, la tête ; puis celui-ci s'empare d'une cuisse, celui-là saute sur une jambe, un autre sur une autre partie du corps ; enfin c'est une boucherie infernale dont le souvenir seul fait frissonner d'horreur et de dégoût. Les femmes se contentent de regarder ; elles ne demanderaient pas mieux peut-être que de participer au festin, mais on le leur défend expressément. Ceci est une superstition qui doit sans doute son origine aux appétits gloutons de ces cannibales, qui craignent de voir diminuer leur part de curée. Les Nouka-Hiviens s'imaginent que si leurs femmes mangeaient de la chair humaine, ils perdraient infailliblement la première bataille qu'ils livreraient ensuite.
Chaque tribu possède un ou plusieurs villages fortifiés, espèces de citadelles bâties sur les montagnes les plus inaccessibles ou à l'entrée des défilés, ressemblant aux pahs de la Nouvelle-Zélande. Ces fortifications sont faites de gros troncs d'arbres assujettis entre eux. Derrière ces murailles s'élève une espèce de plate-forme protégée par un parapet, d'où les assiégés lancent leurs projectiles. Il faut vraiment de l'artillerie pour forcer ces citadelles.
Depuis un grand nombre d'années, l'île Hiva-Oa a été plus troublée qu'aucune autre de l'archipel des Marquises. Tantôt la guerre y existe d'une vallée à une autre ; tantôt les habitants d'une même vallée se divisent en partis hostiles et se disputent vivement les terres où ils ont vécu de longues années dans la plus parfaite harmonie. Aujourd'hui, presque toutes les populations des Marquises sont pourvues d'armes à feu, qui sont devenues, ainsi que la poudre, les articles les plus recherchés dans leurs échanges. L'argent commence à exciter leur convoitise ; mais ils n'en connaissent pas encore la valeur réelle. Hélas ! la civilisation leur aura bientôt fait perdre cette précieuse ignorance.
Nous avons dit que les Nouka-Hiviens ne connaissent aucune forme de gouvernement ; le seul titre de distinction civile est celui d'ariki, qui correspond au titre de chef ou de roi. Ceux des ariki qui, par leurs qualités personnelles, par leurs succès dans la guerre, ou par la réunion d'un plus grand nombre de partisans, obtiennent une supériorité réelle sur leurs compatriotes, ceux-là, dis-je, reçoivent la dénomination d'ariki-noui, c'est-à-dire grand chef ; il en existe quelquefois plusieurs dans une même vallée. Ces chefs ne reçoivent ni services ni tributs ; mais leur opinion a un grand poids dans les circonstances importantes, et aucun tabou général ne peut être prononcé sans leur participation.
J'avais engagé papa beau-père, comme l'appelait plaisamment Péters, c'est-à-dire Kéa-Toï, qui était un des ariki les plus influents de l'île, à venir me rendre visite à bord de l'Estrella. Le lendemain, je le vis effectivement arriver. Sa femme, en toilette d'une certaine recherche, l'accompagnait. Une espèce de turban de toile blanche très-fine couvrait ses cheveux, où l'âge avait déjà semé quelques frimas, quoique les cheveux blancs ou gris soient fort rares, et un grand manteau de lapa était jeté négligemment sur ses épaules et ne voilait qu'à demi ses charmes quinquagénaires. De plus, on devinait, à la blancheur de sa peau, qu'elle avait été récemment soumise à un épais badigeonnage de suc de papa. Tout cela ne laissait pas de me donner de sérieuses inquiétudes. Est-il besoin de dire pourquoi ? Les devoirs et les obligations du tayo me revenaient à l'esprit, et je me voyais dans la triste alternative ou de faire à sa majesté féminine un affront que les femmes ne pardonnent guère, ou de mériter son estime par un acte dont les plus hardis marins, après une navigation de plusieurs mois, ne se seraient pas assurément sentis capables. Et pourtant, on le sait, les marins ne sont pas difficiles, et toujours pour eux
« La première Philis du hameau d'alentour
Est la sultane favorite,
Et le miracle de l'amour. »
Le roi, dans sa visite, se montra très-convenable ; il n'était ni gauche ni ridicule, examinait tout avec calme et attention, et paraissait surtout craindre de rien faire qui pût nous déplaire. Entre les insulaires curieux, pillards, importuns, qui nous avaient déjà visités, et Kéa-Toï, la différence était immense ; on reconnaissait sans peine, dans celui-ci, le chef révéré, l'ariki élevé par son intelligence au-dessus de ses semblables, étrangers, la plupart, à la réflexion, que remplacent chez eux les instincts brutaux.
Le roi me témoigna le désir de voir manœuvrer mon artillerie, et je lui procurai cette satisfaction. Je fis aussi mettra en ligne tout mon équipage et mes cinq soldats de marine, et je commandai l'exercice du fusil, auquel sa majesté voulut bien accorder son entière approbation. Comme une goélette appareille avec facilité, je fis lever l'ancre, et j'évoluai dans la baie, virant de bord et tirant des coups d'espingole à tribord et bâbord ; mais lorsqu'on déchargea ma pièce de vingt-quatre sur pivot, ses majestés et leurs suites tremblèrent de tous leurs membres.
L'heure du dîner était arrivée ; j'engageai mes hôtes à partager mon repas : ils acceptèrent, et se conduisirent pendant toute sa durée avec beaucoup de décence. L'usage que je faisais de ma fourchette parut seul les surprendre infiniment, car ils se contentaient de leurs doigts pour porter les aliments à leur bouche. Un couvert en étain était placé à côté de Kéa-Toï ; je lui en fis cadeau, espérant que la possession de ces instruments l'habituerait tôt ou tard à s'en servir ; mais, trompant mes prévisions, il se passa immédiatement la fourchette dans une oreille et la cuiller dans l'autre en guise de pendants (* De nos jours, la fourchette se dit « okaoka » qui est une répétition du mot-base « oka » signifiant « introduire »… origine du mot à méditer… »). À Nouka-Hiva, l'oreille est un réceptacle où se fourrent toute espèce de choses, trouvées, données ou volées, peu importe ; on a vu des individus se pavaner en portant des baguettes de fusil suspendues à leurs oreilles, et on sait ce que pèse une baguette de fusil de munition.
La nuit, par son approche, vint donner à mes sauvages le signal de la retraite, et je fis saluer leur départ d'une décharge de toute mon artillerie, attention qui parut chatouiller très-agréablement l'amour-propre du roi tatoué. Une vieille paire d'épaulettes dont je l'avais gratifié entrait aussi pour beaucoup dans son contentement. Madame Kéa-Toï non plus ne partait pas les mains vides ; une robe de chambre à ramages lui donna un air de souveraine, et le couple royal descendit à terre fort satisfait du tayo.
CHAPITRE QUATRIÈME
Religion. - Prêtres. - Origines. - Missionnaires. - L'allumeur des feux du roi. - Traditions religieuses. - Mœurs. - Costumes. - Industrie. - Agriculture. - Pêche. - Tatouage. - Sociétés infâmes. - Musique. - Chant. - Danse. - Langage. - Funérailles d'un chef. - Histoire de Péters et de Pafa-Hé. - Le capitaine Bruat, gouverneur-général des îles Marquises.
Comme la plupart des peuplades répandues sur les îles du vaste océan Pacifique, les aimables habitants des Marquises adorent une foule de divinités dont la forme et les attributions sont des plus variées. Celles-ci président au foyer domestique : ce sont les dieux lares des anciens ; celles-là ont la triste spécialité des moraïs ou cimetières ; d'autres consistent tout simplement en petites figurines faites d'os humains et qu'on se suspend au cou en guise d'amulettes. Il est encore des dieux plus vulgaires, qui veulent bien se contenter de la place qui leur est accordée sur les éventails, sur les échasses et sur les armes, où ils sont sculptés grossièrement. Quant aux crânes et aux ossements des ennemis tués dans un combat, ils ont une valeur très-précieuse et constituent ce qu'il y a de mieux porté en fait de reliques. Il n'est pas rare de voir ces insulaires accroupis des heures entières, en chantant et en battant des mains, devant de petites idoles logées dans des maisonnettes à peu près semblables aux chapelles en miniature que les enfants construisent chez nous dans le mois de mai. Les maisons destinées au culte ne diffèrent pas des autres ; l'ameublement en est le même ; seulement, la porte s'ouvre large et haute pour les fidèles.
Souvent, au milieu d'un bosquet de cocotiers, de casuarinas et d'autres grands arbres, sur une plate-forme pavée, s'élève une divinité en bois de la hauteur d'un homme et de l'aspect le plus difforme. Ses yeux et ses oreilles sont grands, sa bouche large, ses bras et ses jambes fort courts. À côté, se trouvent plusieurs autres idoles plus petites. Des faisceaux de roseaux se dressent près de là ; de longues banderoles blanches voltigent dans l'air, accrochées à leur extrémité supérieure, tandis qu'à leurs pieds sont déposées des têtes de cochons et une foule d'autres offrandes, près desquelles pourrissent toujours quelques cadavres de malheureux immolés à la divinité de ce temple en plein air.
Voici pour le culte ; passons à ses desservants.
Dans toutes les cérémonies des Nouka-Hiviens, on remarque des individus au costume étrange, à l'air inspiré, qui paraissent communiquer avec le ciel, en exécutant des danses, accompagnées de grimaces et de contorsions à désespérer le mime le plus exercé. Grande est l'influence de ces prêtres, de ces devins, de ces sorciers, comme vous voudrez les appeler, sur la population, qu'ils savent très-bien exploiter à leur profit. Divisés en plusieurs classes plus ou moins importantes, plus ou moins révérées, ils s'arrogent la distribution générale des tabous ; pour prononcer un tabou particulier, ils n'ont qu'à vouloir ; mais s'il s'agît d'un tabou général, il faut l'assentiment des chefs, qui sont, d'ailleurs, trop intéressés à les ménager pour le leur refuser jamais. Le tabou est, en quelque sorte, la seule loi d'institution divine qui soit connue et obéie, et malheur à qui la viole ! Inutile de dire que ces prêtres, dignes émules des oracles de l'antiquité, connaissent à fond toutes les inventions ingénieuses, toutes les jongleries, tous les tours de passe-passe par lesquels on peut en imposer aux esprits ignorants et crédules.
Quoi qu'il en soit, chez tous les peuples de la Polynésie on retrouve ce dogme si ancien d'un dieu unique, universel, qui donne la vie et l'intelligence à tout ce qui existe ; d'un dieu en même temps créateur et créature, source infinie de toute vie, de tout mouvement et de toute action. Parmi les idées qu'ils ont sur la création des êtres animés, on remarquera qu'ils croient l'homme né de la terre.
Mais il paraît certain que les promesses de la religion ne vont pas, pour eux, au-delà de la vie présente. N'ayant qu'une idée très-vague d'une existence à venir, et n'admettant généralement ni peines ni récompenses à recevoir après la mort, presque tous meurent sans crainte comme sans espoir.
L'origine de ces insulaires est inconnue ; quelques traditions, infidèlement transmises d’âge en âge, sont tout ce que j'ai pu recueillir à cet égard. Oataïa, leur père commun, et Oranava, sa femme, sont venus, disent-ils, d'une île nommée Vavao, et située quelque part à l'ouest de Nouka-Hiva (* Vavaù, aux îles Tonga). Ils apportèrent avec eux différentes espèces de plantes, dont leurs quarante enfants, excepté un, reçurent les noms. En réfléchissant à la position de la plus grande des îles Tonga, qui porte le nom de Vavao, et dont les productions diffèrent peu de celles des îles Nouka-Hiva, on ne saurait refuser quelque vraisemblance à ce récit ; cependant, il faut faire attention que les vents de sud-est qui règnent dans ces parages ne permettent pas de penser que des pirogues eussent été jetées de l'ouest à l'est.
À différentes époques, des missionnaires espagnols, américains et anglais, ont cherché à s'établir aux îles Marquises. C'est vers la fin du dix-huitième siècle que l'on essaya pour la première fois d'y faire pénétrer les lumières du christianisme. Toutes ces tentatives sont demeurées, jusqu'à présent, sans résultat, et pas une conversion sincère n'a été obtenue. Espérons que les missionnaires déposés dernièrement par M. Dupetit-Thouars seront plus heureux que leurs devanciers et verront enfin les Nouka-Hiviens se ranger sous l'oriflamme de la foi chrétienne, comme ils ont déjà adopté les couleurs de notre drapeau.
Vous raconterai-je l'histoire tragi-comique de ce pauvre diable de missionnaire qui descendit, en 1797, à la baie de la Madre de Dios et eut l'insigne honneur d'être promu à la dignité d'allumeur des feux du roi ? C'est-à-dire que, pendant l'absence du monarque, il devait le remplacer en tout et partout, même auprès de son épouse.
Or, si Harris avait fait vœu de chasteté, la reine ne se piquait point de pratiquer cette vertu, et, fatiguée de ne pas voir l’allumeur entrer en fonctions, elle en vint à concevoir des doutes sur la nature de son sexe, dont elle voulut s'assurer par elle-même. Surpris, durant son sommeil, par cette princesse et par ses femmes, l'infortuné missionnaire fut soumis à une perquisition des plus outrageantes pour sa pudeur, et dont les conséquences l'effrayèrent tellement qu'il s'enfuit dans les bois, où il faillit périr de misère et de faim.
(Voir le récit authentique de cet épisode en suivant le lien : http://www.te-eo.com/index.php/menu-histoire/recits-anciens-menu/item/364-01-1797-william-wilson-extrait-de-a-missionary-voyage-traduction-inedite
Les Nouka-Hiviens attribuent à un dieu la naturalisation chez eux des cochons et des oiseaux. Ils ont une tradition à peu près semblable sur l'origine du cocotier, qui leur fut, disent-ils, apporté d'une île appartenant à un archipel situé à l'ouest du leur. Cette croyance est tellement enracinée dans leur esprit, que souvent des naturels des deux sexes se sont lancés, dans leurs pirogues, à la recherche de ce nouvel Eden. Mais on n'a jamais rien su du sort de ces émigrants, et probablement, hommes et canots, la mer a tout englouti ! N’est-il rien de plus triste et de plus touchant à la fois que la conduite de ces sauvages qui quittent leur riante et douce patrie pour s'aventurer follement à la recherche de terres imaginaires ? Besoin de l'inconnu, qu'on vienne après cela nier ta puissance !
Les Nouka-Hiviens, dit Porter, ont été stigmatisés du nom de sauvages ; jamais expression n'a été plus faussement appliquée, car ils occupent une place élevée dans l'échelle de l'espèce humaine, soit qu'on les considère sous le rapport physique ou moral. Nous les avons trouvés braves, généreux, honnêtes, bienveillants, fins, spirituels, intelligents ; la beauté de leur corps répond à la perfection de leur âme. Ils sont généralement au-dessus de la taille moyenne ; leur visage et leurs yeux sont d'une beauté remarquable ; leurs dents, blanches et plus belles que l’ivoire ; leur figure, ouverte et expressive, reflète toutes les émotions de leur âme ; et leurs jambes, qui unissent la vigueur à la grâce, pourraient servir de modèles à la sculpture. La peau des hommes est d'une couleur cuivre foncé ; celles des jeunes gens et des femmes n'est que légèrement brune. Les femmes sont inférieures aux hommes en beauté ; leurs bras et leurs mains sont admirables ; mais d'un autre côté leur taille est peu gracieuse et leurs pieds sont déformés par l'habitude qu'elles ont de marcher sans chaussure. Du reste, elles se montrent rusées, coquettes, et se piquent peu de fidélité. Le premier de ces défauts prouve un esprit délié et susceptible de culture ; le second n'appartient pas seulement aux Nouka-Hiviennes ; quant à la fidélité, elle ne leur semble pas nécessaire, et leurs maris les en dispensent. Cependant, pénétrez dans leurs demeures, et vous serez témoin de l'affection sincère qui unit entre eux femmes, maris et enfants. Au-delà, on se regarde comme parfaitement libre ; tous les liens paraissent brisés, et chaque femme dispose aussi librement de sa personne que les enfants de leurs actions.
Ce portrait, tracé par Porter, est assez vrai ; mais on peut dire qu'il tend, chaque jour, à perdre de son exactitude. Comme la plupart des indigènes de la Polynésie, les Nouka-Hiviens sont loin d'avoir gagné dans leurs rapports avec les Européens, et aujourd'hui la violence et l'abus de la force ne sont pas plus inconnus chez eux qu'ailleurs. Pourtant, ce serait se tromper que d'arguer de l'habitude d'anthropophagie des habitants des Marquises pour prouver leur férocité, et je vois plutôt là un vice d'éducation qu'une marque de férocité. Il en est de même du vol, que les habitants des Marquises considèrent sinon comme une vertu, du moins comme une action qui n'implique, pour celui qui la commet, aucune idée coupable ou honteuse.
Chez les Nouka-Hiviens, pas de convention plus simple que le mariage, d'ordinaire environné, chez les autres nations, de tant de réserves et de précautions. Une jeune fille vous convient-elle, vous vous rendez, muni de quelques présents, chez ses parents ; vous faites votre demande, et si vous avez le bonheur d'être accepté, vous emmenez immédiatement l'objet de votre flamme ; à moins que vous ne préfériez profiter de l'hospitalité qui ne manquera pas de vous être offerte, et passer la première nuit de vos noces chez votre beau-père. Puis, si vous tenez à bien faire les choses, vous conviez quelques parents et amis à un repas, dont un cochon cuit à point et dûment arrosé de kava, infusion de la racine mâchée du kava (piper metisticum), fera les principaux frais, et tout est dit. La religion n'a rien à voir là ; sa sanction est jugée tout-à-fait inutile. Du reste ce mariage, si facilement conclu, peut se rompre avec la même facilité dès que l'envie en prend à l'un des deux époux. On se quitte à l'amiable, et chacun s'en va de son côté, parfaitement libre de contracter une nouvelle union. Jamais de bruit, de contestations ; les enfants même ne font pas obstacle à la séparation, car, par une convention générale, dès sa naissance un enfant appartient au père ou à la mère, et il suit par conséquent l'un ou l'autre quand ils viennent à briser des chaînes qu'ils renoueront peut-être plus tard. Mais ne vous hâtez pas de conclure qu'aux Marquises l'hymen est un lien charmant... et sachez que les époux y trouvent rarement chez leurs femmes certaine particularité physique dont l'absence chez la sienne ferait le désespoir et la honte d'un mari parisien. Dans toute l'Océanie, les jeunes filles vivent fort librement et jugent inutile de se sevrer des plaisirs autorisés par le mariage. Une fois sous puissance d'époux, il est rare qu'elles se conduisent mieux ; mais peut-être est-ce la faute des hommes, qui se montrent fort peu exigeants à cet endroit et se font même un devoir de les prostituer au premier venu.
On a vu que le costume des Nouka-Hiviens est, à très-peu de chose près, celui de la nature, et que portait sans rougir notre père Adam avant qu'il eût cueilli la pomme fatale. Quant à leurs coiffures et à leurs ornements, ils sont des plus variés ; un volume ne suffirait pas pour les décrire tous. Les uns ont le sommet de la tête rasé ; d'autres, les tempes seulement ; ceux-ci portent les cheveux lisses ; ceux-là se les font crêper ; les dandys, les beaux les rassemblent sur les pariétaux et en forment deux espèces de cornes qui constituent le suprême bon genre.
La barbe se porte aussi de différentes manières assez semblables à celles en usage chez nos lions à tous crins du boulevard de Gand, à cela près toutefois que ceux-ci n'ont pas encore, comme les Mendoçains (* Appelées îles Marquises de Mendoza, elles portaient aussi le nom d’îles Mendocines, et leurs habitants, de Mendoçains), l’habitude d'y suspendre des coquillages, des grains de verre coloré, des morceaux d'os, des dents de requin, voire des dents d'homme, et autres bagatelles plus ou moins agréables à l'œil de la fashion (* sic) nouka-hivienne. Lors de mon voyage aux Marquises, le rasoir et ses bienfaits y étaient ignorés, mais on le remplaçait sans trop de désavantage par une dent de requin, une coquille ou un morceau de fer suffisamment affilé.
Au premier abord, les femmes paraissent porter plus d’habillements que les hommes ; mais si elles sont mieux parées, elles ne sont pas mieux vêtues.
Une espèce de jupon de mûrier entoure leurs reins et descend à peine à la moitié des cuisses, quoique sa destination soit d’atteindre jusqu'au genou ; un autre morceau d'étoffe, jeté négligemment sur les épaules et assez long pour tomber jusqu’aux talons, enveloppe tout le corps, de telle sorte que l’imagination la moins vive et la moins vagabonde n’a pas de peine à se rendre un compte exact des contours voilés par la draperie.
À quoi bon, d’ailleurs, ces semblants de vêtements ! Comme de véritables amphibies, elles passent dans l’eau la plus grande partie de leurs journées, et y paraissent aussi à l’aise que les requins, au milieu desquels elles se jouent sans ressentir la moindre crainte.
Mieux initiées que les hommes aux règles du beau, elles ne se rasent point la tête, et laissent flotter au gré des vents leur noire et belle chevelure. Quand elles sont exposées à l’air, une large feuille de palmier leur tient lieu de parasol et garantit leur teint de la trop grande ardeur du soleil. Quelquefois, et surtout lorsqu’elles sortent de l’eau, elles s’enveloppent la tête dans un coin de l’étoffe qui est censée les couvrir. Quoique leurs oreilles soient percées comme celles des hommes ; on en voit très peu qui porte des pendants ; mais elles se plaisent à y suspendre toutes les bagatelles qu’on leur donne.
Une coutume générale parmi elles est de se frotter tout le corps d’huile de coco ; elles communiquent, par ce moyen, à leur peau, un lustre qui passe pour une grande beauté. Les plus fringantes, ainsi que la fleur des dandys, s’oignent le corps de suc de papa, qui est analogue, pour les résultats, au blanc de perle, composition à laquelle des trois quarts de nos héroïnes de coulisses doivent la blancheur de leur teint.
Voulez-vous combler un Noukahivien de joie ? Voulez-vous le voir sauter, trépigner comme un mendiant ; que vous rendriez, tout-à-coup, possesseur d’un trésor inestimable ? Donnez-lui une dent de cachalot ! Aucun bijou, fût-il d’ivoire, d’or, de diamant, ne vaut pour lui cet objet, apanage exclusif, aux Marquises et aux Îles Fidji, des gens comme il faut. Comment cette coutume est-elle la même dans ces deux groupes ?
L’éventail joue aussi un grand rôle dans la parure de ces sauvages. Il est fait d’ordinaire de feuilles de palmier, et pourrait lutter pour la délicatesse avec des produits du célèbre Duvelleroy.
Quatre figures de dieux, adossées deux à deux, composent les quatre faces du manche, qui est en bois de santal, en ivoire, ou fait d’os humains, et toujours sculpté avec beaucoup d’art.
Les armes de guerre, les casse-têtes, les lances, les frondes, les berceaux pour les enfants et les cercueils creusés dans un tronc d’arbre, les coupes, les jattes, etc., sont de même travaillés fort habilement.
Les étoffes de tapa en papyrus (* en réalité, en liber de mûrier à papier) se fabriquent toutes au moyen du foulage, et ce sont les femmes qui se chargent de ce soin, sans employer d’autres outils qu’un bloc de bois rond et un battoir.
En fait d’agriculture, les Noukahiviens sont fort arriérés. Le seul instrument aratoire dom ils se servent est un pieu aigu avec lequel ils remuent la terre, mère prodigue qui ne demande presque rien en échange des biens dont elle comble ses enfants.
La pêche se pratique de différentes manières, soit au harpon, soit au filet, ou à l’aide d'hameçons ingénieusement fabriqués en nacre de perle et imitant les poissons volants. Les indigènes ont encore une autre manière de prendre le poisson ; elle consiste à répandre au fond de la mer, coupée par morceaux, la racine d’une certaine plante dont l'effet sur les poissons est tel, que bientôt ils remontent à la surface, presque morts, et se laissent facilement saisir.
Un bon métier, aux Marquises, et qui ne chôme jamais, c’est celui de tatoueur. Dès qu’un individu a atteint l’âge de dix-huit à vingt ans, il se met entre les mains de cet artiste en piqûres, qui commence à lui zébrer le corps de mille dessins appropriés à sa tribu et à l’influence qu’il exerce sur elle. L’opération se fait au moyen d’une espèce de peigne d’écaille ou d’os, dont on trempe les dents dans une teinture noire et qu’on fait pénétrer dans la peau en frappant légèrement dessus avec une baguette de bois dur. Pour les femmes, le tatouage ne va pas au-delà des mains, des bras, des pieds, des lèvres et des oreilles. Les prêtres, les guerriers, les chefs, sont tatoués de la tête aux pieds ; impossible de trouver sur leur peau le plus petit coin où le peigne du tatoueur n'ait pas incrusté ses indélébiles hiéroglyphes. Tout cela ne se fait pas sans douleur pour le patient, dont l’épiderme reste souvent enflammé plusieurs jours ; mais on ne peut se soustraire à l’usage, et puis il faut bien souffrir pour être beau. Plusieurs voyageurs l’ont dit avec assez de justesse, le tatouage est un costume, et un homme tatoué n’est jamais tout-à-fait nu.
Les Noukahiviens sont-ils propres ? Voilà une question que les récits des différents navigateurs qui ont visité ces peuples ne tendent nullement à éclaircir.
Jugeant tous sur des exemples isolés et sans appel, les uns penchent pour la propreté ; d’autres, au contraire, ne craignent point de délivrer un brevet de saleté à l’archipel pris en masse. Quant à nous, nous ne trancherons pas la difficulté ; seulement, nous dirons qu'aux Marquises nous avons trouvé des gens fort propres et d‘autres fort sales ; là, comme partout, les goûts sont partagés.
Paresseux avec délices, les Noukahiviens ne montrent d’ardeur que pour le plaisir.
Ils ont de nombreuses fêtes dont il serait assez difficile de connaître l’origine, et qui sont pour eux l‘occasion de véritables saturnales. Ils se réunissent alors par bandes de quarante à cinquante et se confluent dans des maisons tabouées, où les membres de leur société seuls sont admis. D'autres fois, ils s’embarquent et vont passer le temps de leurs orgies dans quelque île voisine. Chaque compagnie emmène avec elle une femme qui devient celle de tous et ne regarde pas comme un mince honneur d'avoir été choisie pour reine de ces désordres sans nom. Les divertissements ordinaires consistent en chants et en danses, si l’on peut appeler ainsi des cris fort peu mélodieux et des sauts perpétuels accompagnés de mouvements de bras en haut et en bas, dont notre chorégraphie ne saurait donner aucune idée.
En fait d’instruments de musique, les Noukahiviens n’ont guère que le tambour ; il y en a d’énormes et dont le son serait capable de faire fuir un sourd.
La langue a la plus grande affinité avec celle des îles de la Société, ou plutôt c'est la même langue, ce qui prouve que les peuples des deux archipels doivent avoir une commune origine, quoiqu’ils ne puissent pas, avec leurs pirogues, entretenir entre eux des rapports et franchir les deux cent soixante lieues de mer qui les séparent. Ce dialecte emploie cinq voyelles et seulement huit consonnes, parmi lesquelles notre « r » ne figure pas, et quoiqu’il soit rempli d’aspirations, il ne manque pas d'une certaine douceur.
Le système de numération est décimal, et les mots qui expriment les dix premiers chiffres cardinaux ne diffèrent point de ceux des autres archipels de la Polynésie.
Le jour et la nuit règlent la manière de compter le temps ; le jour se divise en matin, en milieu du jour et en soir. Le retour des pleines lunes compose des périodes de temps qui ont des noms particuliers. Les treize mois lunaires forment à peu près l'époque qui sépare le commencement des pluies de la saison de chaque année ; c'est sans doute à ce phénomène périodique ou à la floraison de quelques plantes que ces sauvages ont fixé le commencement de chaque année.
Aux Marquises, comme dans toute la Polynésie, les maladies les plus communes sont les affections cutanées, les abcès, les ophtalmies, auxquelles il faut joindre les inflammations des organes respiratoires, l‘hydropisie, une espèce d'éléphantiasis nommée « hopi », etc. Les scrofules abondent aussi. Je vis maintes fois à Nouka-Hiva des malheureux couverts d'ulcères dégoûtants ; les enfants surtout sont très-sujets aux pustules et aux éruptions.
Les maladies causées par le libertinage viennent encore compliquer et aggraver celles-là ; cependant je dois dire qu'après un libre contact avec la population de Nouka-Hiva durant le séjour que j'y fis, aucun cas ne se manifesta à mon bord. Et Dieu sait si mes matelots avaient mérité qu'il en fût autrement ! Dans un pays où les maladies sont regardées comme le résultat de maléfices, l'exercice de la médecine doit être nécessairement du ressort des prêtres, et c'est aux tau’a (* tauà) ou prêtres de la deuxième classe qu'il appartient. À eux de chasser l'esprit malfaisant par leurs injonctions mystiques ; à eux aussi la réduction des membres fracturés et toutes les opérations chirurgicales. On dit même, mais je ne garantis pas ce fait, qu'avec une dent de requin, ils vont jusqu'à exécuter l'opération du trépan. Toujours est-il que la haine de ces Esculapes (* Esculape : dieu gréco-romain de la médecine) sans diplôme se satisfait sans crainte, et le malheureux qui l’a encourue peut compter qu’à la première occasion ils s’arrangeront pour l'envoyer sans retard dans l’autre monde.
Ce n’était pas là le cas de mon vénérable tayo, du vieux Kéa-Toi, qui s’éteignit doucement sous le poids des années quelques jours avant mon départ de Nouka-Hiva. Belle avait été la carrière de ce chef, qui comptait par douzaines, suspendues dans sa demeure, les chevelures arrachées aux crânes de ses ennemis vaincus ; aussi sa mort fut elle suivie d’un deuil général et au-dessus de toute description. Pendant deux jours ce ne fut que cris, hurlements, plaies, blessures et sang ruisselant à flot sur le corps du défunt ; on semblait, en se mutilant, se disputer à qui donnerait les marques de la plus vive douleur. Personne ne pouvait faire du feu ou manger avant la nuit, et dès qu’elle était venue les femmes se réunissaient pour chanter des hymnes de mort. Pendant ce temps, on s’occupait à dresser dans le moraï de la famille un autel où le mort devait être placé immédiatement après l’accomplissement des cérémonies intérieures. C’était une sorte de petit échafaud monté sur quatre piliers et supportant un toit destiné à mettre le corps à l’abri des injures de l’air.
Quand le mort, dûment embaumé, fut placé dessus, ses parents et tous les membres de sa tribu vinrent recommencer leurs lamentations, augmentées cette fois des démonstrations plus éclatantes de douleur d’un pleureur sacré, qui devait visiter pendant plusieurs semaines le corps de l’illustre Kéa-Toi, près duquel on lui servirait ses repas.
Mais, à propos de Kéa-Toi, j’allais oublier de vous dire l’histoire que je vous ai promise de sa fille Pafa-Hé et de mon maître d’équipage Peters. Heureusement il n’est pas trop tard pour réparer ma faute, et je ne veux pas terminer ce chapitre avant d’avoir prouvé que je sais tenir ma parole.
Péters, Anglais d’origine, et né de parents assez pauvres, était une de ces organisations aventureuses et hardies dont un homme de génie, Daniel de Foe, a immortalisé le type dans son Robinson Crusoé. Comme celui-ci, de bonne heure, il fut tourmenté du désir d’aller sur mer, désir que tendait encore à augmenter la conduite de son père, qui se montrait fort sévère à son égard, et semblait n’avoir d’affection que pour son fils aîné.
Aussitôt après la mort de sa mère, qu’il aimait tendrement et dont la présence seule avait retardé son départ, Peters disparut, sans mot dire, de la maison paternelle, et s’achemina vers le port le plus voisin. Un navire se préparait à mettre à la voile ; c'était un bâtiment anglais qui couvrait du prétexte spécieux de la pêche la contrebande qu’il allait tenter sur les côtes du Chili et du Pérou. Notre adolescent n’eut pas de peine à s’y faire admettre, et il commença sa première campagne en qualité de mousse.
Loin que son ardeur aventureuse se ralentit, Peters prit chaque jour plus de goût au métier, et il fit plusieurs voyages qui augmentèrent sensiblement son petit pécule ; mais une circonstance imprévue l’obligea tout-à-coup de renoncer à la contrebande, dont il promettait de devenir l’un des plus actifs et des plus courageux soutiens.
Entre autres talents, Peters, qui était d’ailleurs le meilleur homme du monde, possédait celui de buveur, querelleur et boxeur très-adroit. Il était second à bord d’un navire qui faisait la contrebande sur les côtes du Chili et du Pérou. Les lauriers ou plutôt les pampres de l’officier finirent par troubler le sommeil du capitaine, brute fieffée s’il en fut, et toujours ivre du matin au soir, quoiqu’il eût la sotte prétention de se croire le plus intrépide buveur des trois royaumes. Un jour, pendant une relâche sur la côte du Chili, Peters est mandé dans la chambre du capitaine.
« Il parait, Peters, lui dit celui-ci, que tu veux me faire concurrence. » « Comment cela, capitaine ? » « Oui, tu passes pour le meilleur buveur du bord et pour le plus fort boxeur. » « C'est vrai, capitaine, répond modestement l’interpellé. » « Six mois de la paye contre cette pile de quadruples que je t’enterre ! » « Je le veux bien, capitaine. » « Tiens, voici deux verres et deux pintes d'eau-de-vie, nous allons boire du grog à ta santé ! »
Un verre est avalé, puis un second, puis un troisième. Peters demeure ferme sur les étriers, mais le capitaine commence à chanceler. Un quatrième presque sans eau, puis une douzaine y passent, et le capitaine glisse sous la table. « Goddam ! » grommela-t-il en tombant, « ce drôle m’a gagné ».
L'amour-propre blessé ne pardonne guère... Quelque temps après la scène que nous venions de rapporter, le capitaine s'autorisait d’une faute insignifiante pour s'emporter contre Peters et le frapper au visage. Notre homme, qui ne pratiquait point le pardon des injures, sauta tout d’abord sur son supérieur, et joua si bien des poings qu'en moins de rien, il le mit dans la triste nécessité de garder le lit pendant quinze jours.
Après cet exploit, Peters fut saisi, garrotté et mis aux fers, avec l'assurance qu’il n’en sortirait que pour payer de sa vie son infraction aux règles immuables de la discipline. Le capitaine voulait attendre qu’il pût jouir du spectacle de Peters, de son vainqueur en l’art de battre et de boire, attaché par les deux pieds à une barre de fer clouée sur le pont du navire. Mais il n’eut pas cette satisfaction ; car pendant la nuit le prisonnier, aidé de matelots, qui l’aimaient parce qu'il était brave, juste et sévère, fut assez heureux pour briser ses fers, et gagner la côte sans encombre ; il s'enfonça dans les terres, et ne s'arrêta que dans l'Araucanie, appelée par les Espagnols « estado indompto », pays indompté.
Les Araucaniens, essentiellement nomades et guerriers, n’ont ni huttes, ni villages, ni villes. Comme les Patagons, ils vivent dans un mouvement perpétuel ; toujours montés sur de rapides coursiers dont la multiplication fait à peu près leur seule industrie, ils dévorent l’espace, s'arrêtent quand le repos leur est nécessaire, et plantent leurs tentes où ils se trouvent. Peters était jeune et paraissait malheureux ; il fut accueilli avec intérêt par ces hommes de fer dont les habitudes n’étaient pas sans charmes pour une organisation comme la sienne, et il prit part avec eux à plusieurs expéditions contre les possessions espagnoles du Sud. Son courage et sa présence d'esprit dans le danger ne tardèrent pas à le faire remarquer d’un puissant chef ou toqut, qui conçut une vive amitié pour lui et l’attacha à sa personne avec un titre équivalent à celui d’aide-de-camp. La patrie est partout où l’on est bien, dit le proverbe.
Peters regrettait peu son premier métier ; il était devenu Araucanien de la tête aux pieds, et probablement il n’aurait jamais songé à quitter un peuple chez lequel il avait trouvé la plus cordiale hospitalité, si le sort, qui semblait s’acharner après lui, ne l’eût un jour fait tomber au pouvoir des troupes royales. Voilà donc notre aventurier de nouveau menacé de la mort, sur laquelle il put méditer à loisir dans les prisons de la Conception, où on l’enferma en attendant l’heure de son jugement.
Le commandant Porter, dont nous avons déjà eu l’occasion de parler, venait alors de relâcher dans le port de Tascaouana. Peters, en désespoir de cause, eut l’idée de se réclamer de lui. L’audacieux corsaire comprit tout le parti qu’il pourrait tirer d’un pareil homme dans ses croisières contre les Anglais, et il travailla sans retard à son élargissement, qu’il n’obtint qu’avec des peines infinies et en payant une assez forte somme en guise de rançon.
Un peu plus tard, nous retrouvons Peters parcourant en tous sens l’océan Pacifique sous les ordres de son nouveau maître ; puis enfin nous le voyons aborder avec lui à Nouka-Hiva et figurer au nombre des hommes qui, sous le commandement du lieutenant Gamble, furent chargés de veiller au maintien dans l'île de la souveraineté américaine.
Mais après le départ de Porter, les indigènes, à l’instigation d’un Anglais nommé Wilson, qui était naturalisé parmi eux, se révoltèrent et refusèrent de payer le tribut convenu. D'un autre côté, l’insubordination éclata parmi les compagnons de Gamble, et plus d’une fois son autorité fut méconnue.
Après un mois de continuelles alarmes, la révolte dressa tout-à-fait la tête, et jetant leurs officiers à fond de cale, les matelots hissèrent le pavillon anglais et appareillèrent. Deux navires et dix soldats fidèles restaient encore à Gamble, qui défit d’abord les naturels ; mais bientôt, craignant d’être accablé sous le nombre, il brûla un de ses vaisseaux, s’embarqua sur l’autre avec sa petite troupe, et réussit à gagner les îles Hawaii, où il fut pris par six bâtiments anglais. Quant aux Américains abandonnés dans le fort construit par Porter dans la baie Taiohae, ils avaient été tous massacrés par les sauvages, à l’exception d’un seul homme qui parvint à s’échapper dans les montagnes : cet homme, c’était notre héros, c’était Peters.
Peu de jours après, une cérémonie importante se préparait dans une des plus riantes vallées de l’île Nouka-Hiva. Les populations accourent ; l’air retentit des sons vibrants du tam-tam, et cinq ou six naturels dans la force de l’âge se relayent pour faire résonner plusieurs tambourins de diverses grandeurs.
Dans de larges fosses, sous la pierre et la cendre cuisent des porcs tout entiers, partie fort importante de la fête, et près d’idoles en bois, grossièrement sculptées, deux troncs de cocotiers fichés en terre supportent un cadavre.
Pâle, défait, presque nu, un homme, jeune encore, est attaché à un poteau. Sa figure expressive a le type européen ; aucune ligne de tatouage ne zèbre son corps, et la foule fixe sur lui des yeux avides et curieux. Ce prisonnier, c’est Peters, dont la retraite a été découverte, et qui va être immolé aux mêmes d'un chef tué dans un combat. Déjà s’avance majestueusement le grand-prêtre, vêtu d'un manteau blanc de tapa et coiffé d'un diadème de plumes coloriées ; il est armé d'un casse-tête richement sculpté et va porter le coup fatal. Pas un mot, pas un cri ne part de l‘assemblée ; on n’entend d‘autre bruit que celui des tambours qui résonnent sous les coups précipités des musiciens et semblent sonner le hallali funèbre. Tout-à-coup, une femme, jeune, belle, à demi-nue, s’élance ; elle enlace le prisonnier dans ses deux bras, écarte avec respect le ministre de la mort, et fait signe qu'elle prend le prisonnier sous sa protection et saura bien le garantir de toutes les attaques. C’était Pafa-Hé, dont le cœur n’avait pas été insensible à la bonne mine de Peters. On pouvait difficilement refuser quelque chose à la fille d'un aussi puissant chef que Kéa-Toi, et elle finit par obtenir la grâce du prisonnier, qui acquitta, peu de temps après, la dette de la reconnaissance en devenant son époux. On naturalisa Peters en le tatouant à double et triple couche, et il passa ainsi plusieurs années le plus heureusement du monde, vivant avec sa femme dans l’union la plus parfaite et offrant aux indigènes l’exemple, si rare parmi eux, d’un ménage où la fidélité était réciproque.
Comment Peters put il se séparer d’une famille adorée pour aller de nouveau affronter les hasards de la navigation ? Voilà de ces problèmes que nous laissons à analyser à de plus habiles que nous. Toujours est-il qu’il disparut un beau matin de Nouka-Hiva, comme autrefois de la maison paternelle, sans rien dire à personne. Le ciel devait un avertissement à Peters : il le lui donna. Le bâtiment qu’il montait fit naufrage ; obligé de gagner la terre la plus voisine dans les embarcations, presque tout l’équipage périt, et lui-même faillit perdre la vie. Un baleinier qui faisait voile pour l’Amérique le recueillit, et il arriva sans encombre à Lima. Mais plusieurs années se passèrent avant qu’il trouvât l’occasion de regagner Nouka-Hiva, qu’il brûlait de revoir et où je le laissai. Il n'a plus été tenté depuis d’abandonner cette île, et probablement une forte et nombreuse lignée est là maintenant pour perpétuer le souvenir et la race de Peters, l’Anglais-Nouka-Hivien.
Nous ne quitterons pas cet archipel sans consacrer quelques lignes au capitaine Bruat, qui vient d’être nommé gouverneur-général des îles Marquises… ( … )
BIBLIOGRAPHIE
*- Lafond de Lurcy, Gabriel : « Voyages autour du Monde et Naufragés célèbres », tome III, Paris, 1844
E-book gratuit et PDF téléchargeable dans le bouton paramètre de Google en suivant le lien :
*- Porter, Commodore David, « Nukuhiva, 1813-1814 ; le Journal d’un corsaire américain aux îles Marquises », éditions Haere Pō, Tahiti 2014.
Publié par Jacques Iakopo Pelleau le 07/08/2020 à Taiohae, Nuku Hiva.
Mis en conformité avec la graphie académique marquisienne le 27/08/2022.